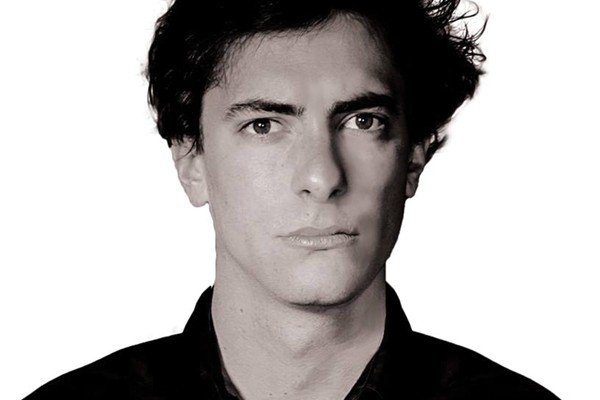Explorations de L’envers et l’endroit du métier d’écrire avec Albert Camus et Le livre de ma mère d’Albert Cohen.
Alger. La mer, et surtout le soleil. La misère, et surtout l’enfance. Marseille. Le soleil, et surtout la mère. Le deuil, et surtout l’enfance. Camus, ta mère est muette. Cohen, ta mère est morte. Elles n’ont pas de voix. La poésie a cela de commun avec la vie qu’elle commence là où le langage échoue.
J’ai souvent pensé qu’écrire était un acte salvateur de contrôle de soi, qu’enserrer sa vie dans l’ordre grammatical permettait de se tenir debout, et de maintenir intègres une identité et un monde qui courent sans cesse vers leur désintégration. J’ai souvent pris le crayon pour un scalpel déchirant le corps afin de tracer droit les sillons de la raison. Un acte de glaciation, un acte de mortification. J’avais peur de la vie, j’avais peur de l’émotion. Et puis un jour, la parole est arrivée au bout, mon corps s’est soulevé. Sa rébellion, c’est l’ineffable, c’est le cri. Sous la douche, j’ai pleuré à m’en étrangler, seul, couvert par le bruit tautologique de l’eau qui tombe. J’ai pleuré comme le plus petit des enfants, tas de morve mouillé, tremblant, agité, replié dans le moins d’espace possible, petit monticule dégoulinant qui cherche, dirait-on, à se dissoudre dans la flotte qui tombe du pommeau pour finir dans la bonde. Dans le cri, dans les pleurs, j’ai découvert le silence. Et la possibilité d’une écriture nouvelle, celle qui n’absente pas le réel dans un arrière-monde spectral, celle qui n’abstrait pas, mais celle qui crée de la présence, qui venant de la chair du réel y retourne.
« On l’a descendue dans un trou et elle n’a pas protesté, celle qui parlait avec tant d’animation, ses petites mains toujours en mouvement. Et maintenant, elle est silencieuse sous la terre, enfermée dans la geôle terreuse avec interdiction d’en sortir, prisonnière et muette dans sa solitude de terre, avec de la terre suffocante et si lourde inexorablement au-dessus d’elle dont les petites mains jamais plus, jamais plus ne bougeront. » La terre, elle est aussi dans ta bouche, Cohen. Celle qui entrave ta parole, celle qui oblige ton écriture à n’être que suffocations. Celle qui tremble et renverse toutes tes certitudes. Quelque chose de proprement impossible est arrivé : ta mère est morte. Que fais-tu ? Un mausolée de mots pour célébrer l’« amour biblique » d’une mère à son fils, toi qui te repends de t’être échappé dans le « pêché de la vie » ? Je ne le crois pas. Tu fais un travail hautement plus important que l’érection d’un monument, tu fais ton deuil. Tu dévores et digères, tu métabolises le corps maternel. Cohen, tu es un asticot qui crée la vie avec la mort.
Ta mère n’est pas morte seule. Avec elle, ton enfance est morte. « Pleurer sa mère, c’est pleurer son enfance. L’homme veut son enfance, veut la ravoir, et s’il aime davantage sa mère à mesure qu’il avance en âge, c’est parce que sa mère, c’est son enfance. J’ai été un enfant, je ne le suis plus et je n’en reviens pas. » Elle est finie, la nuit fantasmée de l’enfance. Le système a explosé, tu es libre. Plus de miroir qui te dit que tu es. Plus de gram-mère. La grammaire est le Dieu de la langue et la langue est maternelle. Mère et Dieu, c’est la même chose. Dieu est mort, il s’est tu. Vos mères aussi, les Albert. Que dire quand le premier mot babillé, imposé, social n’est plus soutenu par une réalité, que « maman » ne veut plus rien signifier ? Mes pauvres enfants, dans votre désarroi, votre liberté, inventer la langue.
« Va, plume, redeviens cursive et non hésitante, et sois raisonnable, redeviens ouvrière de clarté. » Un nouveau jour se lève. Ouvriers, tirez sur les ténèbres, qu’elles redescendent sous la surface de la mer, travaillez vos fantômes, qu’ils deviennent l’humus fécond qui gît au cœur de votre crypte intérieure, formez les mots inconnus qui vous ramènent à la vie, qui remaillent votre tête à votre corps, votre blessure à la source intacte, les absents à la réalité d’un monde jaillissant d’autrui à aimer.
« Chaque artiste garde ainsi, au fond de lui, une source unique qui alimente pendant sa vie ce qu’il est et ce qu’il dit. » Quelle est la source Camus ? « Je mettrai encore au centre de cette œuvre l’admirable silence d’une mère et l’effort d’un homme pour retrouver une justice ou un amour qui équilibre ce silence. » Je ne crois pas au silence génétique. Je crois en l’invasion pernicieuse des signes. C’est contre la logorrhée d’un monde bavard jusque dans l’intime que l’écrivain lutte. Alors pourquoi ne pas se taire et rejoindre ta mère ? Pour ce que tu dis : « une justice ou un amour ». Ta véritable source, on le sait, c’est le soleil. Le silence maternel et la misère t’ont poussé vers le soleil. Sur les plages et sur la peau, le soleil dépose sa lumière sans philosophie et sa chaleur sans distinction. Monde rêvé du sentir, du contact avec la vie même. Paradis muet entre le sable, l’eau et le ciel, l’enfant est à sa place exacte. Je repose donc ma question : pourquoi écrire ? Peut-être pour ne pas parler. L’homme a été rattrapé par les verbiages d’un monde. Comprenons que deux mondes coexistent. Celui du soleil et celui de l’ampoule électrique. Le monde des usines, des marchandises, des nations, des guerres, des discours, des représentations qui vient couvrir le monde inaccessible des entrailles de la terre, de la sève des végétaux, de la lumière des étoiles, du fond des mers et des cœurs. L’un enseveli sous les mots crasseux de l’autre. Écrire pour dire au monde des mauvaises paroles : ôte-toi de mon soleil ! Écrire pour faire sonner des mots justes qui en retrouvant un rapport subjectif au réel redonnent à chacun la possibilité de renouer un lien avec l’indicible.
Qu’est-ce qu’écrire ? C’est vivre, c’est aimer. Qu’est-ce que vivre ? Qu’est-ce qu’aimer ? C’est ne pas écrire. C’est écrire pour atteindre le non-écrire. L’écrivain est prisonnier de ce paradoxe. Nous avons perdu, si cela a existé, la pureté d’un monde sans mot et sans image. Un monde nu. Et que faisons-nous, comme pour espérer faire revenir cet état sans bruit ? Nous déversons des coulées de mots : tous les mots, les beaux, les tristes, les raisonnables, les froids, les crus, les perfides, les faux. Nous fabriquons des mensonges. Dans ce tas d’immondices, de langages chiés, l’écrivain plonge les mains et comme l’orpailleur, il lave cette boue, en extrait les paillettes d’or et les constelle en une voix nouvelle. De la merde jusqu’au ras de la bouche, le poète tend un peu le cou et chante une hypnose qui, seule, d’écho en écho peut rouvrir la terre, faire tressaillir les corps des misérables et retentir des cœurs en quête d’un sens qui menace perpétuellement de s’échapper.
Mères silencieuses, mères sous la terre, vous êtes comme elle, comme la matière, comme la chair. Vous nous portez, nous vos enfants éternels qui à chaque seconde devons recommencer l’acte de vivre, qui devons renaître libres dès que vacille le lien si fragile entre notre être, l’être de l’autre, et l’être du monde. Libres d’être différents malgré un bain d’uniformité. Libres d’être parcourus d’émotions dissonantes malgré une éthique de l’anesthésie. Heureux de pleurer tout ce qui meurt pour donner la vie. Heureux de posséder la faiblesse des vaincus, de déposer les mots du pouvoir pour accoucher des mots révoltés qui se propagent horizontalement. Heureux de déserter les cieux pour mettre genoux à terre et murmurer, têtes baissées, que la transcendance est à nos pieds et entre nos humaines mains.
Tu peux vain Atlas cesser de ployer sous lui, et venir folâtrer en son sein. Le monde ne se disloquera pas davantage si nous osons pleurer, si nous osons aimer, si nous osons vivre. Peut-être même s’en portera-t-il mieux. C’est la leçon de l’écriture vraie, de la vie vécue. Cimer Albert(s) !