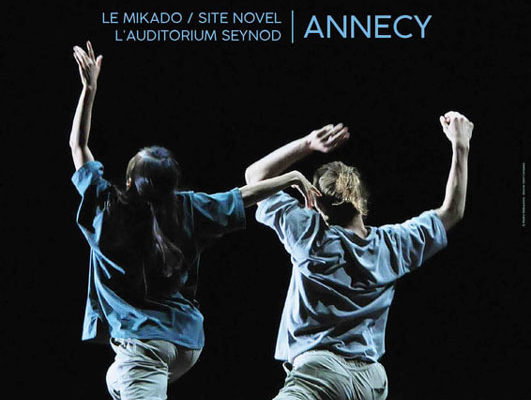Envers et contre tout, nécessaire parce que vital ; les artistes posent des jalons pour ceux qui acceptent d’ouvrir les yeux sur le monde.
Ils étaient là, plantés parmi nous, les badauds, ou nous parmi eux. Le regard fixé sur nous qui les regardions. Mais chacun d’entre eux avait la bouche bâillonnée. Image forte. Tout était dit dans cette impossibilité à parler. L’artiste réduit au silence. La liberté dans les fers. Et le théâtre continue à payer son tribut très lourd à cette violence. Nombre de ceux qui œuvrent pour cet art sont condamnés à se taire, se terrer ou succomber à la terreur dans tous les endroits où règne la pensée unique, ouvertement ou insidieusement. Rares sont aujourd’hui les espaces de dialogues vrais, de vrais débats, de libre parole, débarrassés de toute entrave extérieure ou intérieure, mus simplement par le projet de faire avancer l’homme, la pensée, le vivant.
La confrontation à la censure.
Le théâtre se doit d’être le lieu de la parole contradictoire, subversive, qui aborde justement, soit frontalement, soit de biais, tout ce qui met à mal la liberté de l’homme. Pour un artiste, être libre c’est oser, oser se confronter à tout ce que nous imposent la société, la morale et l’ordre établis. Oser ouvrir des espaces d’étonnements, de questionnements toujours aux aguets. Ce que ne supporte pas, ou mal, une autorité prescriptive ou frileuse. Dans les cas extrêmes, la réponse est radicale et mène à l’élimination pure et simple de toute velléité d’émancipation. La censure sait encore s’armer du couperet. Bien sûr, rien de tel dans nos sociétés dites démocratiques, éclairées. Mais si nous savons que sous la forme oppressive, l’institution de la censure a fait long feu, nous savons aussi que l’artiste de théâtre n’en a pas fini avec cette entrave à la création. Sa liberté est soumise à diverses mesures d’approbations avant même l’épreuve du public. Combien de projets avortés ou tronqués, au profit d’œuvres plus consensuelles, l’histoire du théâtre recèle-t-elle ?
La censure officielle, bien qu’ayant sensiblement évolué depuis le XVIIème siècle, maintient encore des approches désuètes, voire rétrogrades dans un rôle de garant des bonnes mœurs, exécuteur de l’« ob-scène » (ce qui doit rester en dehors de la scène). Le théâtre se retrouve alors art sous contrôle, soit par interdiction totale, soit par imposition de coupes à l’intérieur du texte à représenter. Les artistes sont confrontés à une alternative : céder ou refuser de renier sa liberté au risque d’être réduit au silence. De célèbres cas d’interdiction ont marqué l’histoire récente du théâtre – Les paravents de Jean Genêt, quatre ans après la guerre d’Algérie, ou Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès, là où le traumatisme lié au fait divers était encore vivace.

Sur le concept du fils de Dieu, Romeo Castellucci © Klaus Lefebvre.
La transgression des règles.
Le théâtre subit encore la contrainte prégnante d’une ancienne règle instaurée par les Grecs : interdiction de traiter d’évènements de l’actualité immédiate ou trop récente, pour ne pas réactiver chez les spectateurs les souffrances réellement vécues ; obligation d’une distance d’au moins une génération, sans parler des risques du politiquement incorrect. Règle très gênante pour les artistes dont la sensibilité créatrice est foncièrement ancrée dans la réalité de leur temps. Règle que les dramaturges ont su contourner par la fable, la métaphore, la distance géographique ou historique, tels Shakespeare, Hugo, Musset dans leur drames historiques où ils peuvent se ménager un espace d’expression libre. Et nul aujourd’hui n’est dupe de ces artifices. Nous savons lire entre les lignes. D’autant plus que le théâtre s’est sensiblement affranchi de ces reculades et que nous sommes pleinement imprégnés d’une mouvance de l’art de la scène, comme de toute forme d’expression artistique, qui nous plonge au cœur d’une activité brûlante. Bien plus, nous ne pouvons qu’être reconnaissants envers ceux qui font le choix risqué de représenter, en dépit des pressions politiques, économiques ou autres, une pièce comme 11 septembre 2001 de Michel Vinaver.
Au moment même où se produit l’accablant spectacle de l’image médiatique, réducteur et appauvrissant, Michel Vinaver nous livre un contrepoint poétique sous forme d’oratorio. Loin d’instrumentaliser le public, il le replonge dans une démarche de libre-pensée nécessaire pour pouvoir évaluer le monde qui est le nôtre. Cet évènement, considéré comme le traumatisme primitif de notre siècle a d’ailleurs donné lieu à des réactions très divergentes, au théâtre comme au cinéma : autocensure chez certains artistes ; maintien de leur projet et refus d’en rabattre chez d’autres au risque de réactions de rejet agressif. Car les artistes ont parfois bien du mal à défendre leurs choix et préserver leur liberté de création face à une censure de ceux à qui ils destinent leurs œuvres : le public. Censure d’autant plus rude qu’elle pourra être relayée par l’institution ou par des organisations plus ou moins obscures ou intégristes. Cette censure, ou « sensure » selon le mot d’un critique, peut prendre des formes plus brutales que la violence ou l’obscénité incriminées par le public. Les exemples ne sont pas rares dans le théâtre contemporain, de ces occasions où une partie du public, de la presse, se mobilisent pour crier au scandale et demander la tête de l’artiste.
Ainsi, les spectacles de Rodrigo Garcia, Angélica Liddell, Anéantis de Sarah Kane, Sur le concept du visage du fils de Dieu de Roméo Castellucci sont dans les mémoires. Chacun à sa façon transgresse les cadres reconnus du visible et du transmissible. Chacun représente un geste de liberté qui outrepasse les conventions d’un théâtre ordinaire et rassurant. Il s’agit bien de scandale ; « celui qui cherche à produire un effet de transgression d’une norme politique, morale et / ou esthétique. »

Sarah Kane © Jane Brown.
La création émancipée.
Le théâtre est un endroit où la sensibilité du créateur et de ceux qui l’accompagnent, s’exprime dans une pleine adéquation entre liberté de pensée et liberté d’expression artistique. Et l’on peut suggérer que les réactions excessives à leur encontre sont souvent la résultante d’un malentendu, voire d’une ignorance ou d’une confusion. Ces spectacles qui poussent le geste jusqu’à exposer dans sa nudité l’immontrable : violence ordinaire, violence de la guerre, de la torture, de la consommation, de la morale, de la religion… sont une réponse imaginaire à la violence réelle qu’elle stigmatise et qui est souvent plus violente encore et scandaleuse que celle représentée. Et Sarah Kane avait raison de s’offusquer de ce que la représentation d’un viol provoque plus de fureur que le viol réel ou que la presse choisisse « de se mettre en colère, non pas face à l’existence d’un cadavre, mais face à l’évènement culturel qui avait attiré l’attention sur lui ». Nous touchons là à un point essentiel : celui de la responsabilité de l’artiste qui se doit de défendre son intégrité et sa liberté. « Je ne veux pas être la représentante d’un groupe biologique ou social auquel je me trouve appartenir. Je suis ce que je suis. Quand on se perd soi-même, qu’est-ce qu’il reste encore à quelqu’un ? »
Ces propos existentiels énoncés par la dramaturge anglaise posent clairement la question de la liberté, particulièrement sensible au théâtre, domaine où l’artiste s’expose dans tous ses états. Aussi n’est-il pas prêt à se laisser enfermer dans des règles de formes et d’organisations rassurantes et calibrées. Même s’il dépend d’une structure, un metteur en scène comme Rodrigo García revendique sa pleine et entière liberté d’action. S’il sentait la moindre tentative de brimer son travail de création, ou de le formater, il irait faire du théâtre ailleurs, dans la rue, dans un autre pays.
Autant d’exemples qui nous amènent à prendre conscience qu’aller au théâtre n’est plus l’occasion d’assister de l’extérieur à un événement, mais de partager une expérience qui nous mette en jeu. La représentation aujourd’hui non seulement manifeste la volonté des dramaturges et des metteurs en scène de transgresser les tabous, mais fait aussi état d’un art en rupture qui s’est peu à peu affranchi des règles et normes ancestrales.
L’histoire du théâtre du XXème siècle, prolongée aujourd’hui, se présente comme un immense chantier, marqué par des temps forts, quasi révolutionnaires pour extirper l’art scénique de ses chaînes, pour l’ouvrir à une représentation émancipée en phase avec le monde et la réalité qui le suscitent. Et pour que cette représentation accède au plus haut degré de la réalisation souhaité, il faut que tous les acteurs, toutes les composantes du spectacle sachent mettre en commun leurs énergies pour ouvrir tous les champs libres à la création. L’art de la scène n’est plus ce voyage organisé circonscrit par les conventions et normes qui le contraignent dans une simple fonction d’illustration ou d’imitation. Il est au contraire l’occasion pour les metteurs en scène, les acteurs, les scénographes, d’activer des endroits parfois même insoupçonnés, ces « divagations » chères à Claude Régy.
Créer, c’est inventer, écrire ou réécrire en osant l’impertinence, voire l’irrespect. Et ce faisant, les artistes d’aujourd’hui ouvrent ces espaces souvent troublants de nouvelles libertés où peuvent coexister des modalités d’expression sans stigmatisation. Au-delà de leurs choix et partis pris différents, ce qui peut les réunir, c’est leurs refus de tout immobilisme, leur démarche qui tend à s’affranchir des normes socioculturelles paralysantes.
Photographie à la Une : Primera carta de San Pablo a los Corintios, Angélica Liddell © Alain Walther.