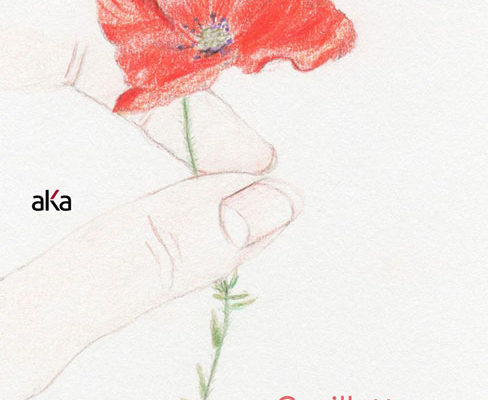Il est une chose réjouissante par-dessus tout, quant au bonheur : c’est qu’il n’existe pas de recette. Nulle part.
Des discours, oui ! Des théories, plein ! De la surenchère lexicale, à foison ! Des « moi je sais parfaitement ! » tant qu’il vous plaira. Mais, du mode d’emploi, non ! Pas de stages de formation où glaner des recettes pour mieux manger, mieux courir, mieux enseigner, mieux penser…
Mieux, mieux… « Ah, vos têtes, vos pauvres têtes de candidats au bonheur » faisait dire Anouilh à Antigone, la révoltée contre le bonheur comme un os à ronger que lui tend la main du pouvoir représentée par Créon. Que de suspicions planent au-dessus de la thématique du bonheur en tant qu’elle témoigne du rapport de l’homme au monde. Or « tel qui rit vendredi, dimanche pleurera » ou bien « vérité en-deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». Le bonheur serait donc, comme toute valeur humaine, sujet à caution de relativité et de fluctuation dans le temps. Il n’y a pas si longtemps, l’idéal de bonheur, cet état de plénitude de tous les sens, loin des tracas du monde, se confondait volontiers avec les images paradisiaques de bords de mer ou autres paysages exotiques. Qui aujourd’hui oserait faire abstraction de la réalité actuelle et des textes d’auteurs dénonçant les horreurs du monde ?
Distributeurs de bonheur.
Il existe un business du bonheur particulièrement pervers. Il rôde tout autour de nous, nous mitraille de ses messages lénifiants, et le théâtre n’y échappe pas. Ce bonheur à consommer (sur place ou à emporter) se distille par distributeurs automatiques en tous genres. Selon le nombre de pièces que l’on est apte à sacrifier, on se retrouvera face à une formule avec plus de ceci, moins de cela… Métaphore facile, affligeante de médiocrité et pourtant si parlante qui ravale le bonheur au rang de « bien » à consommer. Elle est négation du collectif quand elle prétend le servir, alors qu’elle consacre l’individualisme ; négation de la justice quand elle sert l’inégalité (petites pièces, vous n’aurez que le bas de gamme qui attaque votre santé physique et mentale) ; négation du vivant quand elle ne distribue que stéréotypes et formules figées. Et le théâtre apporte sa contribution en ce qu’il arrive de véhiculer des propositions scéniques représentatives de notre société consumériste.
Ce fameux distributeur automatique emblématique d’une société et d’un monde « cling-cling » est sur le plateau. On l’a vu, récurrent dans la jungle des signes mortifères scénographiés par Vincent Macaigne, de Au moins j’aurais laissé un beau cadavre à récemment dans Je suis un pays. Il participe alors d’un monde marqué par la décrépitude et le péril. Il est donc bien difficile (impossible ?) au bonheur, quelque soit la définition à laquelle on adhère, de frayer son chemin au milieu des squelettes, fœtus en formol, effigies des « grands » dirigeants. Dans l’univers de Rodrigo Garcia, tous les indices Mickey, Ikea, Nike, McDo, nous cernent et nous pénètrent. Et bien sûr, ces mondes, instruments du risque de déshumanisation généralisée, sont voués à la destruction non moins généralisée sur les plateaux du spectacle vivant. « Si vis pacem, para bellum » (« si tu veux la paix, prépare la guerre ») dit l’adage. « Si tu veux donner une chance au bonheur, parle des malheurs de notre monde ». Autrement dit, et tellement mieux chez Pablo Neruda dans Résidence sur la terre : « Et vous allez me demander : mais pourquoi votre poésie / Ne vous parle-t-elle pas du rêve, des feuilles / Ou des grands volcans de votre pays natal ? / Venez voir le sang dans les rues / Venez voir / Le sang dans les rues, / Venez voir le sang / Dans les rues ! ».
Microcosme en naufrage.
Nous voilà donc aux prises avec ce paradoxe : réfléchir au bonheur dans la représentation scénique contemporaine, c’est être amené à scruter surtout les malheurs et turpitudes du monde. Si le bonheur rime avec harmonie, satisfaction, plénitude, ou bien troubles et tracas handicapants, le théâtre a l’art de redistribuer les cartes. Par exemple, depuis l’aube de cet art, le thème du bonheur participe du jeu du théâtre avec le réel dans lequel il s’agit de « caillasser les certitudes ». Le cercle familial est alors une cible privilégiée ou un microcosme et la façon dont il se délite sur le plateau donne à penser le monde comme il va et les relations interpersonnelles telles qu’elles s’embrouillent.
Magistral condensé de cette histoire du bonheur aux prises avec les versants obscurs des histoires familiales dans Ibsen Huis (La maison Ibsen) mis en scène par l’australien Simon Stone. Le coup de maitre de ce metteur en scène est de s’être penché sur les voies ouvertes par Ibsen dans son théâtre pour mettre en boîte à portée de mains du spectateur, les pseudos bonheurs bourgeois et les mener à l’effondrement, rongés qu’ils sont par les traumatismes, les non-dits. Façon de dire qu’aujourd’hui comme du temps d’Ibsen, les rêves de bonheur ne peuvent résister aux urgences du monde et des illusions fracassées. Ce théâtre des êtres désemparés réunit trois générations dans un microcosme infernal, telles des mouches épinglées aux parois de verre d’une « maison-naufrage ». Est-ce à dire à tous les étages la difficulté, voire l’impossibilité de vivre simplement le monde, a fortiori d’y construire le bonheur ? S’il est un thème où intime et collectif s’imbriquent, se frictionnent ou se répondent, c’est bien le bonheur et les questions corolaires à celui-ci : la liberté, la vérité, la justice…
De la joie, du triste, des sensations.
Le théâtre fait souvent de chacune de ces quêtes le moteur de bien des dramaturgies. Ainsi du théâtre de Tchekhov qui anime toute une constellation de personnages de toutes appartenances en butte avec un monde en mutation. Tous aspirent à leur bonheur. Notion antinomique avec leur ici et maintenant, à l’image de ces trois sœurs qui projettent « à Moscou » ce qu’elles sentent voué à l’endormissement et à l’échec dans leur province familiale : la vie, la possibilité d’être heureuses. Situation tchekhovienne par excellence qui voit l’idéal du bonheur porté par les personnages comme produit par l’imagination nourrie par la promesse d’un avenir meilleur. Et lorsque l’imagination prend définitivement le dessus sur la raison, nous faisons face à ces personnages récurrents dans le théâtre de Shakespeare : les fous. Folie qui leur donne accès à un monde imaginaire et subjectif dans lequel ils peuvent évoluer en plein « bonheur ». Ne parle-t-on pas des « imbéciles heureux » ? Et chez Shakespeare, ceci n’est pas un jugement péjoratif mais le signe d’un renouveau ou retour à l’innocence. Magnifique interprétation de cette « joie » dans la mise en scène du Roi Lear de Jean-François Sivadier. À l’empêchement du « triste » est réduit à l’inaction face aux trahisons et violences de son entourage, il oppose un temps de « joie » du Roi dans sa folie en le lançant dans un jeu plein de grâce. Et bienfait collatéral : quand le bonheur du spectateur jaillit du bonheur des acteurs, il est à retrouver le bonheur des jeux d’enfants.
La référence au monde de l’enfance à laquelle on se rapporte si souvent lorsqu’il est question de l’univers du jeu nous amène tout naturellement à évoquer les « bonheurs de théâtre », bonheurs éprouvés par les spectateurs. Jouissance de ce lieu, où le mot « bonheur » non seulement supporte, mais appelle le « -s » du pluriel. Émotion de « bien-aise » éprouvée devant ces spectacles qui échappent à toute catégorie étouffante, à toute contrainte réductrice. Où le plateau déploie toute la magie, la liberté, l’inventivité, l’intelligence qui nous transportent, nous, nos perceptions, sensations, émotions… et dont nous sortons grandis. Inutile de les citer ; chacun peut reconnaitre les siens ! Et chacun en théâtre est responsable et maitre de ses bonheurs. Tout est alors une question d’appréciation, de regard que l’on est disposé à porter sur le spectacle vivant. Est-on prêt à dépasser certains états du regard qui empêchent d’accéder à ces endroits où le monde incarne de nouvelles possibilités de vie et d’appréciation de l’humain ?
Divertir le plaisir, ouvrir le regard.
Il en est de la quête du bonheur comme de toute autre quête humaine : elle exige lucidité et discernement. Et si le théâtre témoigne si souvent de la difficulté de cette quête, s’il parle essentiellement du malheur et de ses avatars, n’est-ce pas en réalité de bonheur dont il est question ? Intensément, même si a contrario. Pas seulement parce qu’au regard de la réalité du mal et de la souffrance il serait déplacé ou criminel de faire croire en l’évidence aisée du bonheur. Mais surtout pour se libérer des illusions trompeuses et des faux-semblants. Il faut aiguiser son regard. Ainsi sera-t-il susceptible de reconnaitre et dépasser les souffrances et malheurs ou du moins les erreurs et préjugés.
C’est pourquoi le théâtre qui sacrifie au plaisir mimétique d’un espace codé, conventionnel, se référant, parfois jusqu’à la caricature, au monde réel dont il est question, a peu de chance de nous amener « si haut ». Bien sûr dans cet espace, on peut s’adonner aussi au plaisir du jeu, plaisir de la prouesse d’acteur, du visuel. Et même au plaisir du texte à entendre… Mais, dans ce théâtre (dont celui qu’il faut bien appeler bourgeois), l’objectif est souvent d’accumuler les couches pour obéir au « plaisir », au contentement, au « divertissement » du spectateur. Mais « divertir » signifie détourner, dévier du vrai but. Plaisir n’est pas bonheur. Le bonheur est plus exigeant et demande à l’art non pas de se détourner du plaisir mais de l’impliquer dans un réseau significatif beaucoup plus complexe qui fasse sens. Et pas sens unique. Mais un ensemble de significations possibles au sein desquelles le spectateur fait son chemin. Le sens n’est alors pas saturé (y compris si la mise en scène, elle, peut jouer sur la saturation des signes scénographiés), mais ouvre à des parcours multiples. Au-delà du plaisir spectaculaire, le bonheur du spectateur entrera en vibration avec sa conscience, l’autre, le monde. Pour ce faire, le regard du spectateur doit s’engager, refuser d’être frileux, au risque d’aller à contre-courant de ce qui est considéré comme la norme usuelle. À l’image des acteurs qui, loin de se contenter d’une conformité à ce qui leur est demandé, osent s’exposer sur une scène. L’audace semble vraiment être une composante nécessaire pour franchir les niveaux de regard, du plus commun, banal au plus aiguisé. Certains motifs récurrents dans le spectacle contemporain s’avèrent particulièrement sensibles à ce processus d’élaboration du regard. On peut penser par exemple à ces spectacles en danse ou théâtre qui présentent (exhibent selon certains) des corps nus sur scène et en particulier la nudité de groupe de plus en plus fréquente (Tragédie d’Olivier Dubois, Bestie di Scena d’Emma Dante, ¿ Qué haré yo con esta espada ? d’Angélica Liddell).

Tragédie mis en scène par Olivier Dubois © François Stemmer (2012).
Le spectateur a le choix du regard qu’il porte, donc de l’émotion qu’il en éprouvera et donc du rapport qu’il établit avec le spectacle proposé. À regard anecdotique (appréciation de l’apparence physique, comparaisons des nudités…), perception « primaire » peu élaborée. À regard moralisateur, porteur de jugement (« c’est un scandale »), vision réductrice et manichéenne qui risque toujours de tomber dans les pièges de l’apparence. Courtes vues donc des deux côtés. Une fois dépassées les barrières de ces deux approches, la possibilité de « voir » vraiment, au sens de celui qui est voyant, qui atteint un stade autre pouvant ouvrir vers ce bonheur recherché ! C’est alors le regard conscient qui sait voir, derrière les formes, la véritable poésie. Et dans la poésie, le lien avec le monde, la beauté, le pouvoir. De là surgit la joie par l’avènement de son dieu, Dionysos, en lieu et place de la tristesse générée par les deux premiers regards.
Des mondes à reconstruire.
Le bonheur est donc bien une question de point de vue, et une question de discernement. « Dans la république d’où je viens, dit Lydie Salvayre dans Contre, les hommes sont éteints mais ils se disent gais. Le monde leur est dur, mais ils le disent doux. Ainsi survivent-ils à ce qui les défait. Mais lorsque d’aventure s’annonce une vraie joie, ils passent à ses côtés sans reconnaitre son visage ». Alors, ne tombons pas dans ces travers et emboîtons le pas à Thomas Jolly qui prône un théâtre « curateur pour triompher de la nuit ». Et sans aller peut-être jusqu’à penser que le théâtre serve à rapiécer la société, envisageons qu’au théâtre, la lutte pour le bonheur puisse s’exprimer en creux dans la présence sur scène de tout ce qui peut entraver son avènement. De même que l’éloge du sublime ou de l’idéal peut se camoufler derrière la critique explicite de la banalité la plus médiocre. En tous cas, nous adhérons aisément à la conception de Myriam Marzouki, metteure en scène, directrice artistique et philosophe pour qui le théâtre sert à conjurer les passions tristes. Artiste atypique, elle scrute de près tous les paradoxes et contradictions pour y voir plus clair et révéler ce qui est censé être dissimulé. À ces conditions tout en dérangeant, le théâtre peut produire de l’humain.
Comme le dit Krzysztof Warlikowski, metteur en scène polonais, « il faut un équilibre entre la lumière et les ténèbres, lorsqu’on parle […] de la maladie en général de la société d’aujourd’hui et de toutes nos questions, nos doutes, du sentiment de se perdre de plus en plus, d’être déraciné. » La création contemporaine rend bien souvent compte de ce double mouvement qui manifeste le désir primordial de se sortir de toutes les oppressions, toutes les morales et vérités imposées pour libérer les forces et valeurs, l’énergie créative indissociable du concept du bonheur. Être sur le plateau, jouer pour « halluciner des mondes » dit Marie Payen, actrice française au parcours d’une forte sensibilité qui « s’attache » à libérer le jeu, le corps, la parole et le texte en créant des formes spectaculaires « émancipées ». Ainsi Je brûle, spectacle « sans père, sans origine, donc sans metteur en scène pour dicter son pouvoir », spectacle sur la mémoire avec carte (presque) blanche laissée à l’improvisation (pas de texte à apprendre pour « parler » de la mémoire !) crée ses fictions mémorielles. Ce spectacle prend place dans la lignée de ces propositions qui font état d’une destruction derrière laquelle il faut mettre en place un nouvel ordre du monde.
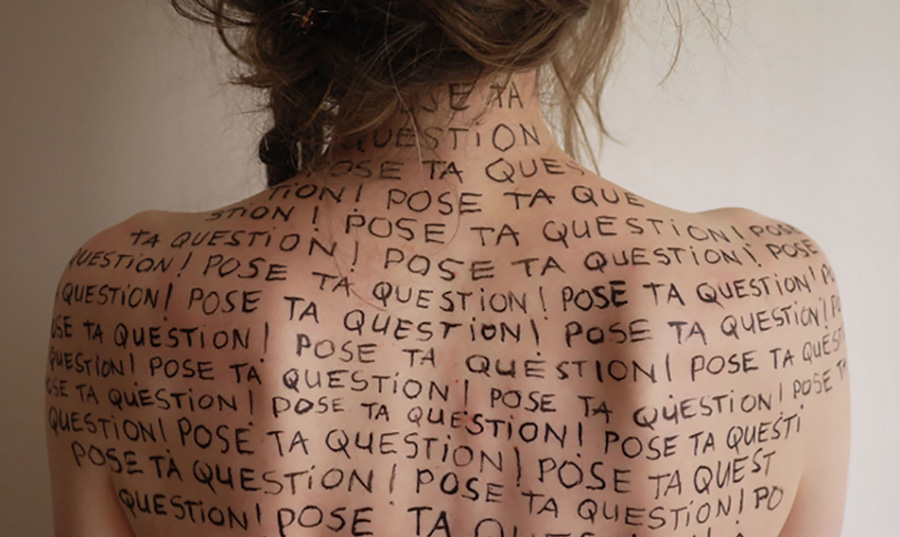
Je brûle mis en scène par Marie Payen © Céline Gaudier (2014).
Ainsi d’une société sortant exsangue d’un conflit dans un monde au lourd passé dont les bases anciennes ont été sapées. Tout est à reconstruire, de nouvelles valeurs sont à inventer puisque les anciennes ont échoué. Et pour que la quête du bonheur qui tisse en filigrane l’enjeu de ces pièces puisse s’effectuer, il faut d’abord que tous les mensonges, trahisons, mauvaises fois soient révélés. Là est bien le message envoyé par l’auteure Biljana Srbljanovi dans sa pièce Sauterelles. Trois générations, de l’enfant au grand-père, vivent « ensemble » repliées sur leurs mesquineries et rancœurs après les années Miloševi. Et même si l’on rit, car les situations sont souvent cocasses, et heureusement, sinon le propos ne serait pas si porteur, le monde drainé par ce groupe est mortifère et ne laisse pas de place au bonheur, si bonheur suppose harmonie du lien entre l’homme et le monde. Il y a donc à agir et inventer ce « nouveau monde » à usage des jeunes générations. Nous étions à Belgrade, le cadre historique évoqué est celui des années quatre-vingt-dix marquées par la guerre en ex-Yougoslavie après les années de plomb. Importance de l’art et des artistes pour redonner espoir et énergie vitale à un moment figé. Les mondes à reconstruire sont toujours là et les figures de pouvoir qui ont droit de vie et de mort, qui sont empêcheurs d’espoir et de bonheur humain sont encore légion. On les connait depuis longtemps via le théâtre, des plus inquiétants aux plus burlesques. Ils ont noms : Néron, Richard III, Ubu, Arturo UI… et multiplient l’image de la « bête immonde ». Ceux-là sont rois, empereurs ou chefs de gangs. Mais la figure se décline aussi dans les fictions de théâtre, au sein de la sphère privée. Il n’est que de se référer au théâtre d’Ibsen ou de Thomas Bernhard entre autres.
En tout état de cause, sphère privée et sociale ou politique se croisent pour dire les épreuves et obstacles auxquels se heurte la quête du bonheur. Et en point d’orgue de cette quête de la question du bonheur au théâtre, revenons à l’un de ses hérauts : Vincent Macaigne. Remarquable et tonitruant dans Je suis un pays qui revêt toutes les « armes » du théâtre pour secouer nos petits conforts et certitudes, nos petits bonheurs trompe-la-faim, quand il s’agit de désigner et traquer tout ce qui nous projette vers un avenir de cataclysme. En vrai Jupiter, lui, il convoque son Aréopage diabolique, mascarade politique et sociale, toutes les émotions humaines, du rire au frisson. C’est pour dire (crier, gueuler) qu’il faut se réveiller, réagir, vite, mais que c’est possible, que le bonheur n’est pas complètement étouffé, ensablé, noyé… puisqu’il est bien possible d’investir le plateau à tous les niveaux, pour, en fin de (règlement de) compte, boire un coup ensemble, artistes, techniciens, spectateurs, en piétinant allégrement les décombres. Que du bonheur ! Chapeau l’artiste !
Photographie à la Une © Mathilda Olmi, Je suis un pays mis en scène par Vincent Macaigne (2017).