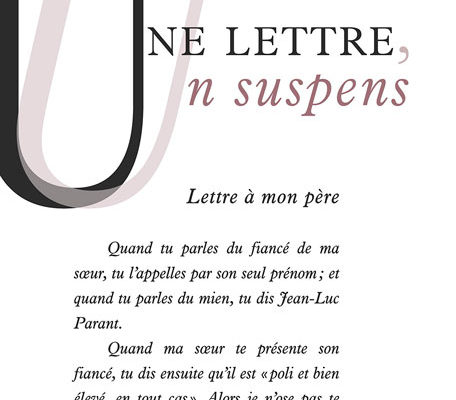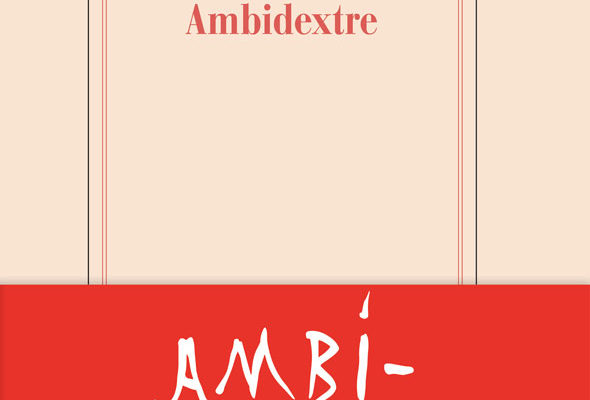Lucie était une enfant méchante. Elle avait attrapé le mal comme elle aurait attrapé le sexe de son père un matin sous la douche, par inadvertance. Elle le tenait de sa mère, ou plutôt de sa grand-mère. Il y a des maladies qui se transmettent par le ventre des femmes, de mère en fille.
La grand-mère de Lucie était ce qu’on appelle aujourd’hui une « personnalité toxique », qui se laissait enfermer depuis des années dans une sorte de dépression, comme en un cloître sordide et délirant. On eût dit qu’elle était habitée par une chose épouvantable, un mal, sans aveu possible et sans espoir de pardon, dont elle conserverait le secret dans son ventre comme elle aurait conservé un enfant mort qui, en se décomposant, empoisonnerait son sang.
« C’est ainsi que Dieu me punit », gémissait-elle parfois ; mais la vérité, c’est qu’elle avait décidé, seule, de sa faute, du châtiment et du mode d’administration des peines. Dieu lui-même aurait-il voulu la sauver qu’il en eût été incapable. Mais – comme c’est souvent le cas pour les personnalités de cette sorte – la réalité étant précisément ce qui lui paraissait le plus insupportable, de sa faute et des souffrances qu’elle en éprouvait, elle en accusait le monde et faisait peser sur son entourage, son mari et sa fille unique, la petite Manon, une insidieuse tyrannie.
Sans doute, cette étrange et déconcertante stratégie de vie lui permettrait de s’acheminer vers la mort dans le confort relatif d’un certain déni (ou d’un déni certain), mais au prix d’un délabrement psychique irréversible et potentiellement contagieux.
Sur la petite maison des D., le secret de la mère pesait comme une menace invisible ou comme un étouffement constant. Mais dans un village, comme celui où se déroule notre récit, où tout le monde connaît tout le monde et où tout finit par se savoir inexorablement, un secret n’est jamais réellement un secret, mais circule ostensiblement comme des choses qui se disent.
Or, des choses, il s’en disait.
On racontait par exemple que le père n’était pas le père et que la mère était allée se faire engrosser ailleurs par on ne sait qui ou par on ne sait quoi ; car, à en juger l’évolution du mal qui semblait ronger « la pauvre vieille », on en vint à supposer que ce fut le démon en personne. Mais l’enfant qui était venue au monde et qui avait grandi depuis, cette petite gamine pleine de vie toujours fourrée dans les pattes de son père quand il était au bistrot avec les copains et que tout le monde adorait, n’avait jamais présenté de caractère démoniaque. L’on abandonna l’hypothèse farfelue, mais la certitude première persista.
Par grâce, nul ne songeait à se moquer du pauvre monsieur D., qui avait toujours été un bon et brave camarade, et qui ne devait pas avoir des nuits faciles avec ces histoires. Le mari n’était pas un imbécile et, si l’on ne peut pas dire qu’il partageait, avec elle, le secret de sa femme, du moins en supportait-il le poids et les conséquences, aussi silencieusement qu’une tombe. Pour des raisons morales évidentes, parce qu’il était un homme et qu’il avait le sens de l’honneur, qu’il lui importait de ne pas perdre la face, mais aussi pour des raisons sentimentales et affectives – non pour sa femme, dont il avait admis depuis longtemps le caractère incurable de la maladie, mais pour l’enfant qui était là, qui n’avait rien demandé à personne et qu’il aimait malgré tout –, il consentit à vivre dans le mensonge, à maintenir vivante une illusion. Il ne fit sans doute que retarder les effets destructeurs de ce qu’il s’efforçait de contenir, et peut-être qu’au fond de lui, il en avait conscience, mais il avait fait ce qu’il avait pu, avec ses moyens, ce qui lui avait semblé juste. Et qu’aurait-il pu faire d’autre ?
Manon passa donc son enfance entre les cruautés insidieuses d’une mère faussement malade, aux yeux de laquelle l’enfant ne fut jamais qu’un objet de honte et de ressentiment, et un père pour lequel elle éprouva toujours une réelle affection, mais qu’elle ne parvint jamais à considérer autrement que comme un étranger.
Dans ses tripes, dans son âme, par les tréfonds de sa chair, mieux que quiconque elle savait ce qui devait ne jamais être su, mais ce savoir ne parvenait jamais totalement au jour de sa conscience.
Pour cette raison, elle noua avec sa mère une relation paradoxale.
D’un côté elle se montra l’être le plus dévoué, prenant soin de ses désirs, remuant le ciel et la terre pour exaucer ses caprices, même les plus extravagants ; elle faisait preuve d’une excessive tolérance face aux crises que « la vieille folle » lui opposait lorsque celle-ci ne trouvait pas d’autre recours à ses mensonges que la plus exécrable mauvaise foi. Elle ne se plaignait pas, n’opposait pas de résistance et, s’il pouvait lui arriver de soupirer ou de lever les yeux vers le ciel, elle n’exprimait jamais au-delà sa colère, son dégoût ou sa tristesse.
De sa servitude, elle avait fait son devoir.
Mais d’un autre côté, elle voua pour cet être une rancune tenace, en rien comparable à ce que les adolescents éprouvent d’ordinaire à l’égard de leurs parents ; une haine, qui nourrissait en elle les violences imperceptibles d’une pensée mauvaise, dont elle niait qu’elle pût être la sienne, qu’elle dissimulait, s’efforçant de la contenir entre les bornes d’un refoulement acceptable. Elle attendait, dans une certaine angoisse, le jour où son bourreau serait enfin emporté, avec son mal, dans le fond de sa tombe. Elle attendait ce jour comme celui où son calvaire prendrait fin, où elle vivrait enfin libre de ses poisons. C’était son espérance, sa promesse. C’était toute la vengeance qu’elle s’autorisait à éprouver.
Très tôt, pour se protéger des attaquesincessantes de sa mère et sans savoir exactement ce qu’elle faisait, son instinct lui commanda une conduite à laquelle elle s’appliqua comme à la raison supérieure de sa survie. À force d’habitude et de répétition, cette organisation défensive devint progressivement la forme de sa volonté, comme une force de loi à laquelle elle finit par soumettre l’intégralité de sa vie sociale et consciente. Ce fut comme une immense toile d’araignée que son esprit tissa sur le monde, un faux-voile d’illusions, qu’elle s’efforça de faire correspondre à la réalité, à seule fin de contenir sa propre vérité, qui n’était déjà plus le mensonge de sa mère, comme la flamme vacillante où le foyer de ses enfances et de sa vie future s’était donné des raisons d’exister.
Car les araignées, qu’un certain cinéma nous a habitués à voir comme des êtres monstrueux assoiffés de sang, sont en réalité des animaux craintifs. Ce que Manon craignait le plus – en cela jamais suffisamment consciente de sa lucidité, c’était que le mal ne (re)surgisse, en dehors de tout contrôle, et que les conséquences en fussent désastreuses. En épousant Michel Janvier, en s’engageant à construire avec lui une vie de famille, en mettant au monde leurs deux enfants, Manon n’eut jamais à l’esprit d’autre pensée que de protéger son foyer des souillures dans lesquelles elle s’était débattue une bonne partie de sa vie. C’est ainsi que son organisation défensive passa dans l’éducation de ses enfants.
Michel Janvier fut pour Manon le mari parfait. Dernier né « par hasard » d’une veuve dont les autres enfants avaient déjà quitté le nid à l’heure où lui-même faisait ses premiers pas, on eût dit qu’il avait été élevé spécifiquement pour être ce « mari », attentionné, loyal, bienveillant, docile et qu’il était devenu en grandissant ce que sa mère en avait fait, un homme mûr pour le matriarcat. Manon chérissait en lui cette vertu qu’elle avait reconnue chez son propre père : l’ignorance qui le protégerait. Sans jamais chercher à savoir, à creuser, à comprendre, Michel se contenta de remplir son rôle, ajustant sans arrêt sa volonté aux désirs de sa femme, il consentit et adopta pour lui-même le code de Manon. Mais leurs enfants, qui, plus encore que leur père, étaient éloignés de la « violence fondatrice », n’eurent pas le choix, quant à eux, d’accepter ou de ne pas accepter, sans jamais comprendre de quoi exactement les angoisses de leur mère étaient censées les protéger (quant à leur grand-mère, on se limitait à l’explication : « Mamie est malade, elle a toujours été comme ça, personne ne sait ce qu’elle a, il faut être gentil avec elle », et personne ne prit jamais la peine d’aller fouiller plus loin).
À de nombreux embranchements, dans le courant des routes que nous empruntons, il nous est donné de reconduire nos « modèles » et les conditions de leur puissance, ou de les subvertir en exposant au jour leur illusion fondatrice. On pourra se demander longtemps ce qu’il en eût été si Manon, au lieu d’inscrire son organisation défensive comme loi fondatrice de son foyer, s’était saisie du courage et du risque, face à son père et sa mère, à son mari et à ses enfants, face à elle-même enfin, de briser l’ordre du secret. La suite ne nous l’enseigne pas.
Par une étrange ironie de l’histoire, le mal dont Manon Janvier était parvenue à se protéger et dont elle s’était efforcée de protéger sa famille, s’était faufilé à travers les mailles de son filet et s’insinuait déjà dans le cœur de sa fille, où il attendit des années comme en sommeil, ainsi que le font certains parasites, que les conditions de son surgissement fussent advenues. Manon regardait derrière son épaule, redoutant que le mal ne surgisse de quelque part d’ombre de son passé, mais ne voyait pas que les ombres étaient passées devant et qu’elles encombraient dorénavant le ciel de l’avenir.
C’est dans le cœur de Lucie que les mémoires refoulées de Manon retrouvaient leur nœud primordial. Et lorsque la fille appliqua avec une rigueur mimétique déconcertante les organisations défensives de sa mère autour de la naissance de son premier enfant, c’est en réalité le « secret métaphysique », dont nous avons situé l’origine dans le ventre de la grand-mère (mais notre généalogie est certainement incomplète), le germe empoisonné du « mensonge ontologique » et ses logiques d’enfermement qui avait pris racine dans son ventre, qui s’éveilla et se manifesta pour la première fois sous sa forme la plus dangereuse.
C’est avec la naissance de son premier enfant que le mensonge se donna de nouveau des moyens d’existence. Mais cela, c’est une histoire que j’ai déjà racontée.
Photographie © Alexis Lavorel.