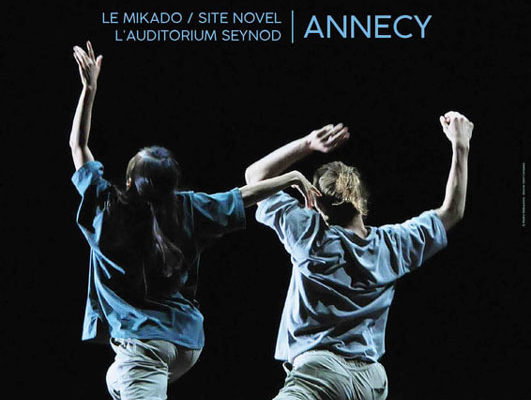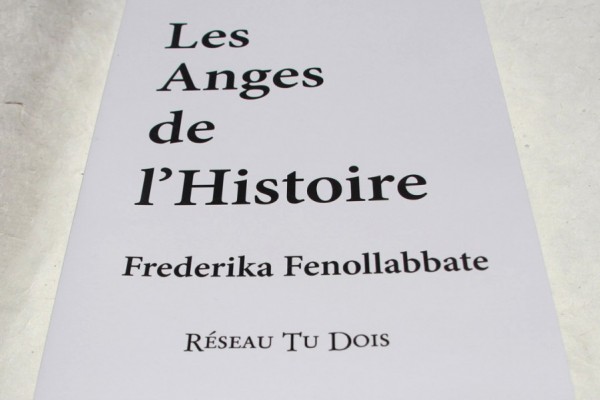Comme tant d’autres faits humains dont le théâtre est le relais, la folie s’alimente des aléas d’une histoire aux visages fluctuant, voire contradictoires.
Folie. Diabolisée lorsque l’observation de la raison, ou autre diktat dominant l’emporte sur les passions que l’on veut réprimer ou refouler. Encensée lorsque sont mis en lumière l’enthousiasme créateur et sa capacité à faire bondir ou rebondir le génie humain. Donc à faire sauter les verrous des univers trop étriqués. Mais dans ce cas, la folie créatrice et sa reconnaissance sont rarement concomitants. Il faut un laps de temps plus ou moins long pour que nous prenions la vraie mesure de ce que la folie, soi-disant, d’un Rabelais, d’un Goya, d’un Artaud, d’une Kane, nous a ouvert en approfondissement ou mieux en plongée dans la connaissance de nous-mêmes, du monde, de ses délices et de ses supplices. Alors que, de leur vivant, cette même folie a mené ces artistes vers l’enfermement – réel via l’asile à Rodez pour Antonin Artaud – ou la mort pour tous – par suicide pour Sarah Kane et peut-être même l’assassinat pour Rabelais. La folie a l’art de distiller l’inquiétude car elle génère de l’étrangeté au sein de l’univers des faits et des choses qui nous sont familiers. Étrangeté qui peut – et elle le fait souvent au théâtre – déboucher sur un espace tragique nourri d’un désespoir intensifié, face au monde tel qu’il va. La folie, de près ou de loin, a toujours quelque chose à voir avec une mise à mort, réelle ou fictive, symbolique ou sacrificielle.
Au-delà des normes établies.
Aller au théâtre voir Hamlet, Le Misanthrope ou Tartuffe, ce n’est pas, ce ne devrait pas être, pour confirmer que nos classiques ont la vie dure et que décidément, Shakespeare ou Molière sont vraiment universels. Non, cela nous le savons ; nous connaissons cet alibi sans surprise. D’autant plus s’il s’agit de servir une sempiternelle antienne de valeurs, conformes de préférence, que ces chefs-d’œuvre sont censés receler. En revanche, si c’est pour découvrir quels monstres on va me révéler cette fois ; par quel monde, quels affects les corps furieusement présents sur scène vont être traversés et me traverser en retour, alors je me relie à ce dialogue sans fin, sans cesse renouvelé que fabrique le théâtre et dans lequel la folie fait son lit. Et dans ce lit, les personnages qui ne sombrent pas dans les supplices souvent grotesques de ce monde où la folie se substitue à la raison, sombrent dans la mort et l’anéantissement. « La folie, c’est le déjà-là de la mort » dit Michel Foucault dans son Histoire de la folie à l’âge classique où, entre autres pistes sur les rapports conflictuels et polémiques des fous et de l’ordre social, il démontre très clairement le lien qui doit être établi entre la folie et le sentiment d’anéantissement, l’anticipation de la fin inéluctable. Et le théâtre du monde – en peinture ou sur scène – déroule sur tous les tons, de la tragédie la plus noire et cynique au rire le plus énorme, le fil de l’errance humaine dans la perte de soi aux confins de la mort et de l’oubli.
De ses origines antiques à aujourd’hui et sans doute pour encore de longues périodes, le théâtre ouvre son espace à la déflagration que provoque la folie sur scène. La scène comme l’espace pictural chez les artistes de la folie, est alors le lieu où se manifeste et s’exerce l’emprise des symptômes les plus violents, cruels et douloureux des comportements marqués au coin de l’altération, la démesure, l’excès débordant les frontières des normes établies, comportements proscrits de l’espace social.
Transgresser la raison.
Cette folie qui a partie liée avec la morbidité, met face à l’insoutenable, l’insupportable, l’insensé et prend une dimension de violence qui peut mener au désespoir ou pire. Alors l’art en général, le théâtre surtout, se doivent de faire éclater au grand jour les pulsions les plus dévastatrices qui nous effraient depuis toujours. En renvoyant sur scène l’image de la folie, c’est à la fonction cathartique du théâtre que le plateau sacrifie. Il multiplie à l’envie des figures chaotiques qui, dans l’imaginaire collectif, représentent ces êtres qui versent sur l’autre côté du monde avec toutes les conséquences fatales qu’ils drainent derrière eux. Ces êtres qui nous fascinent autant qu’ils nous effraient, car le plus souvent, leur folie n’est que la traduction des mouvements de folie qui secouent les sociétés.
Comment une société peut-elle mieux saisir ce qui la traverse dans ses recoins les plus obscurs qu’au travers de ces personnages que le théâtre, selon Antonin Artaud, se doit « d’afficher et de mettre au monde ». Et le théâtre de dérouler, sous les yeux ébahis, révulsés ou compatissants des spectateurs, l’infini cortège des figures et situations porteuses d’une humanité hors normes. Marquées au coin, non du bon sens, mais de la déraison, du délire, ces situations nous entrainent dans une descente aux enfers ouvrant la voie aux désirs, pulsions, instincts les plus obscurs, les plus obscènes. Frisant souvent la déshumanisation ou tombant carrément dans l’animalité, les personnages de fous rongés par les pensées obsessionnelles, prisonniers d’une conscience qui s’est détachée de la réalité, transgressent toutes les limites et mettent constamment sous tension le rapport entre la folie exhibée et les exigences de la raison.

Deux Bacchantes et un taureau – Origine romaine inconnue © Musées du Vatican, Rome.
Aux prises antiques.
Poussée à l’extrême, ce dont témoignent les œuvres picturales – Francisco de Goya avec Le préau des fous ou Saturne dévorant un de ses fils, épouvantable tableau de la période dite « noire » du peintre – ou théâtrales – Les Bacchantes d’Euripide ou Thyeste de Sénèque, la folie apparait liée aux formes suprêmes du scandale et du mal. La tragédie antique en particulier s’intéresse de près à toutes les manifestations de la fureur. Cette forme de folie consacre la domination des hommes par des forces – celles de Saturne ou Bacchus – qui les livrent à l’outrance et la perte de tout jugement critique. Toutes les limites marquant les frontières entre l’humain et l’animal peuvent être franchies.
Le délire comme punition ou le délire au détriment de la vie s’expriment dans les aveuglements furieux d’Oreste, Achille, Médée, Ajax, Agavé, Atrée et tant d’autres. Et derrière, autant d’histoires de cruautés, de vengeances, de haines, de jalousies, de pouvoirs. Autant d’histoires d’infanticides, matricides, parricides, régicides… Et dans la foulée, autant de récits de démembrements, écartèlements, ingestions, anthropophagies. Face à l’acte de création, la folie est un moteur pour mener les personnages, bien au-delà ou en-deçà de leur identité normale, à pulvériser tous les verrous, convier sur le plateau, livrées à l’imaginaire collectif, toutes les violences, les horreurs de notre histoire. La parole du fou au théâtre n’est-elle pas souvent une parole forte, brutale, libre, qui dit à voix haute ce qui est censé être tu, occulté ? Une parole de déconstruction ou mieux de dé-création destinée à faire scandale.
Atrée chez Sénèque, comme Médée ou Agavé dans Les Bacchantes viennent nourrir la lignée de ces personnages parvenus au paroxysme de la cruauté et de ses jouissances. Et chez chacun des dramaturges au sein de leur poétique, il s’agit non seulement d’explorer des situations extrêmes (infanticide, cannibalisme) où le désir de vengeance brouille la raison et justifie la démesure, mais aussi d’excéder les limites de l’imaginable et du dicible. Chez Sénèque ou Euripide, le crime et sa préparation puis sa réalisation donnent lieu à des détails qui poussent très loin l’art de l’exagération. Telles les Bacchantes, dans la fureur provoquée par le Dieu Bacchus. Et à leur tête, Agavé, mère de Penthée, écumante, révulsée, possédée, ne reconnaît plus son fils et le démembre. La tragédie antique regorge de ces personnages monstrueux, qui par ailleurs ne sont pas fous à priori mais sombrent dans la démence, l’extravagance, le délire. La liste pourrait s’allonger à l’infini de ces exemples de « théâtre de la cruauté » et de la démence. Est-ce à dire qu’il n’y a que dans ce temps-là que le théâtre se fait relais et miroir de comportements irrationnels ? Certes non. Cela voudrait dire que nous ne sommes plus que raison, santé « luxe, calme et volupté »… !
La folie est toujours partie prenante de la création théâtrale et des dramaturgies du XXème et du XXIème siècle. Et comme par le passé, c’est la folie du monde et en particulier ce qui relève de ses faces obscures, de sa cruauté, de ses manques, de ses crises et de ses aberrations qui projette sur le plateau les figures et situations emblématiques aujourd’hui. Les pièces, les spectacles multiplient la présence de ces êtres porteurs d’une énergie hors cadre de l’humaine condition ordinaire. À la différence des personnages monstres de la tragédie grecque ou latine, eux ne sombrent pas dans la folie par punition divine ou nécessité politico-religieuse. Les dieux aujourd’hui ont perdu leur pouvoir de distribution de la folie ou de la santé mentale. Le monde, l’histoire, la politique, la société s’en chargent maintenant.
Le côté obscur.
Le plus souvent les personnages ne perdent pas leurs facultés mentales et le rapport rationnel ou réel sous le coup d’une péripétie. La folie a déjà pris possession de leur être. La catastrophe a déjà eu lieu avant le début de la pièce. La présence de fous ou de personnages considérés comme tels n’est pas prétexte à gloser sur les notions de victimes, de martyrs ou de boucs émissaires associées à la nature humaine. Mais elle est, et parfois au premier plan d’une œuvre, signe d’un monde qui est donné à penser. Et par sa faculté d’inquiéter et de déranger, elle est la force de subversion qui permet aux dramaturges et metteurs en scène de creuser très profond au cœur d’une réalité si complexe en particulier dans les périodes inquiétantes de menaces sociales, politiques, morales.
Le fou est celui qui échappe aux impératifs en cours qui tendent à museler paroles et gestes. Il est le personnage d’une parole libérée, une parole forte qui peut se dresser face à la parole du pouvoir et son alliée, la raison. Pour reprendre les mots de Jean-Louis Martinelli à propos de Lars Norén – auteur de Kliniken ou de Le 20 novembre sur le passage à l’acte d’un jeune lycéen dans un établissement scolaire, Sébastien Bosse dit : « C’est quelqu’un qui donne de grands coups de pied au cul de la marche du monde ». Et Lars Norén dont le théâtre se frotte justement aux comportements hors norme et aux univers des misères et tragédies de nos sociétés et des oubliés de ces mondes est bien placé pour témoigner « avec une économie de moyens qui génère une poétique surprenante ». Poétique non moins surprenante chez Angélica Liddell qui dresse dans Que ferai-je, moi, de cette épée ? – un tableau halluciné et hallucinant des instincts cannibales et homicides de notre monde à travers des faits particulièrement brûlants emblématiques de formes de démence : les attentats de Paris de novembre 2015 ou l’histoire de l’étudiant japonais qui tua une étudiante et la mangea.

Que ferai-je, moi, de cette épée ? d’Angélica Liddell © Luca del Pia.
Autant d’exemples auxquels on peut rattacher bien d’autres dramaturges ou gens de théâtre comme Thomas Bernhard qui multiplie, tout au long de son théâtre et avec une préférence affichée pour une parole d’imprécation et de ressassement délivrée par des personnages souvent obsessionnels ou monomaniaques, les accusations à l’égard de l’Autriche. À travers ces accusations, c’est à une constante mise en garde contre les menaces qu’il ressent, toujours vivaces d’idéologies nazies, qu’il nous invite. Alors, où est la folie ? Chez ses personnages qui cherchent obsessionnellement à perpétuer un temps atrocement fou dans des rituels de commémorations ou de fêtes et festins absurdes ? Chez ceux qui, ayant perdu tout lien avec l’action véritable, et représentatif d’une humanité en pleine perdition et errance mentale, s’enferment dans un isolement qui les mène au suicide ou à la mort ? Ou bien, la véritable folie se trouve-t-elle non dans la logorrhée ou les ingestions outrancières, ou les gestes et paroles automatiques incessamment réitérés (typique des asiles d’aliénés), mais dans le vrai monde, celui des 27% obtenus en Autriche par l’extrême-droite en 2000 et son entrée dans le gouvernement ?
Faire face au monde.
À l’image du théâtre de Thomas Bernhard lui-même nourri du théâtre de l’absurde de Samuel Beckett, la folie, dans tous ses états, du tragique au grotesque, de l’angoissant au dérisoire, oscillant entre le sublime et le ridicule, est une matrice à laquelle puisent bon nombre de grands créateurs. Au bout du compte, elle renvoie à une forme de lucidité à avoir sur le monde, sa vanité, ses horreurs, ses aspects tragi-comiques ou franchement épouvantables. Grâce à elle, le théâtre – comme toute forme d’art – s’affranchit des limites, se permet toutes sortes de violation des normes sociales ou morales. Ce qui peut expliquer certaines réactions de rejet radical, au nom de la bienséance, du bon goût. Il s’agit peut-être alors d’une frange de public qui n’est pas prête à accueillir les œuvres qui drainent tout un imaginaire monstrueux. Alors que ces artistes font spectacles de la folie pour la capacité qu’elle offre, entre autres, de faire scandale, de produire un choc. Et de ce choc ils font une arme de réflexion et d’éveil. C’était déjà le cas chez Shakespeare, grand chantre dans ses tragédies, de ces personnages aux prises avec toutes les formes de lubies, impulsions ou déviances plus ou moins meurtrières. Pensons à Richard III, à Caliban l’anthropophage, Lady Macbeth… Mais à chaque fois l’œuvre ne peut que nous amener à nous interroger nous-mêmes sur notre propre rapport aux monstres, à l’horrible. Elle ouvre à une réflexion sur le pouvoir, la domination, le rapport bourreau-victime, l’esclavage. Autant de thèmes traités largement par le théâtre européen, mais aussi africain, du XXème ou du XXIème siècle.
À travers ses multiples facettes, l’intérêt du thème de la folie au théâtre n’est pas dans l’illustration d’un processus de victimisation, mais dans la force de révélation qu’il ouvre. Il participe de la mise en lumière susceptible d’ouvrir nos consciences, de nous détourner des alibis et faux-semblants, de nous rapprocher de la lucidité. Lorsque le monde est fou, le fou est l’accoucheur de la folie dont nous avons besoin pour exister mieux et faire front.
Tant que le théâtre aura cette capacité de regarder de biais et de tous les angles possibles le réel, il nous sera possible d’espérer. Nous nous raccrocherons avec un plaisir toujours renouvelé à toutes les nefs des fous qui occupent les scènes qu’elles subliment par les forces de résistance et de refus, mais aussi de proposition et de poésie qu’elles recèlent. Nous nous réjouirons de l’humanité qui se dégage des corps des acteurs, danseurs, performeurs qui incarnent des personnages hors-normes en toute vérité et générosité.
Image à la Une © Saturne dévorant un de ses fils – Francisco de Goya (1819 – 1823), Musée du Prado, Madrid.