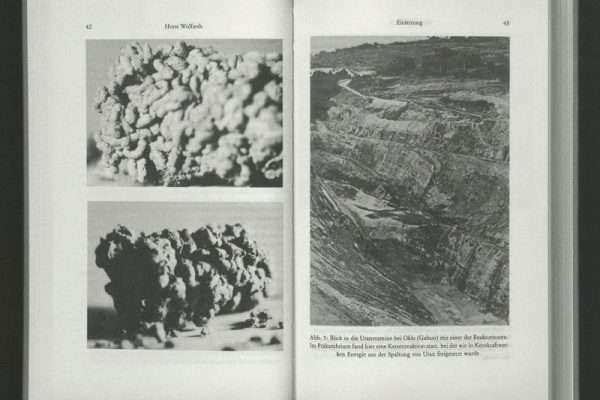Un musicien, ça dérange, ça s’impose, ça emmerde. Génie ou maladie ? Qui est le plus fou : le censeur ou le chanteur ?
C’est bien connu, un fou a des visions ou entend des voix. Cela fait partie de ces critères bien reconnaissables qui permettent de conclure tout diagnostic sans plus tergiverser – avoir des hallucinations, ce n’est généralement pas bon signe. D’une certaine manière, c’est pourtant indispensable pour un artiste. Un compositeur entend continuellement des voix dans sa tête ! Ce n’est pas chez lui signe de folie mais d’une activité créatrice intense. En effet, créer une œuvre requiert une dose formidable d’imagination et l’imagination, bien sûr, ça se passe dans la tête.
Bien sûr que ça se passe dans la tête, mais pourquoi faudrait-il en conclure que ce n’est pas réel ?
Quand le compositeur imagine sa future création, il imagine des sons. Certains existent dans le monde réel – il entend par exemple clairement des violons sur tel passage – mais d’autres sont uniquement le fruit de son cerveau dérangé. La création musicale consiste alors à inventer de nouveaux sons en essayant de recréer celui, merveilleux, qui n’existait jusqu’alors que dans la tête du créateur. Ces sons peuvent être mis en œuvre en utilisant des combinaisons d’instruments inédites, qui vont créer un timbre nouveau. Ainsi, dans la musique orchestrale, il est courant de faire jouer un thème par deux pupitres différents, hautbois et violon par exemple, pour obtenir une texture nouvelle. Si aujourd’hui cette méthode est plus qu’éculée, elle a permis aux compositeurs qui ne disposaient pas encore de l’électricité (les pauvres) d’innover quand même un peu. Ils pouvaient également se rapprocher de leur luthier favori et imaginer ensemble de nouveaux instruments. C’est de cette manière qu’Adolphe Sax a développé au XIXème siècle toute la famille des saxhorns et des saxophones, qui a ouvert une palette de timbres entièrement nouvelle avec le succès que l’on connaît (et si vous ne connaissez pas, allez écouter Charlie Parker). Pour Hector Berlioz, c’est plus simple : « tout corps sonore mis en mouvement par le compositeur est un instrument de musique ». Ainsi, c’est l’orchestre symphonique dans son ensemble qui est un instrument sous les doigts du chef, pas la peine de s’embêter à en inventer de nouveaux (c’est sympa pour tous les instrumentistes qui du coup comptent un peu pour du beurre).
Le synthétiseur, cet instrument magique.
À partir de la deuxième moitié du XXème siècle, on passe à la vitesse supérieure. À la faveur de l’industrialisation et du développement technologique, de nouveaux instruments sont inventés : les synthétiseurs. Plutôt que de faire avec un instrument existant et d’éventuellement lui apporter des modifications pour trouver de nouveaux sons (comme c’est le cas avec le piano préparé), le musicien part de l’onde sonore et la travaille pour créer le son dont il a envie. Il a à sa disposition une multitude de potentiomètres permettant d’agir sur des paramètres tels que le nombre d’harmoniques, leur répartition dans le spectre, la forme de l’onde et l’enveloppe du son. Le réglage était si complexe qu’il fallait souvent être ingénieur pour s’y retrouver. Ajoutez à cela le fait que ces instruments occupaient une pièce entière et l’on comprend mieux pourquoi les pionniers de la musique électronique passaient pour des savants fous !
Par ailleurs, si l’on peut en théorie recréer le timbre de n’importe quel instrument acoustique sur un synthétiseur, le fait est que ce qui en sortait était souvent étrange et déroutant. Ces sons venus du futur permettaient parfaitement d’illustrer un film d’anticipation tel qu’Orange mécanique de Stanley Kubrick (musique de Wendy Carlos), ce qui a contribué à associer les synthétiseurs à la science-fiction et aux événements étranges dans l’imaginaire collectif. Il est également significatif que l’on entende un thérémine dans la bande originale de Vol au-dessus d’un nid de coucou (Miloš Forman), qui se déroule dans un hôpital psychiatrique. Cet instrument composé de deux antennes reliées à un boîtier est un des tout premiers instruments de musique électronique mais également un des rares que l’on joue sans y toucher. Cela lui confère une dimension surnaturelle qui, combinée à son timbre aérien proche d’une scie musicale ou d’une voix humaine (au choix), convient particulièrement à l’expression de la folie.
Folie dépensière.
On le voit, l’invention de nouveaux instruments, particulièrement dans les musiques électroniques, a permis l’apparition de sons nouveaux dont les compositeurs se sont emparés. Ceux-ci ont longtemps fait partie de l’avant-garde. Les pionniers de la musique électronique – Luigi Russolo, Luciano Berio, Pierre Schaeffer puis Pierre Boulez, Pierre Henry, Karlheinz Stockhausen et Michel Magne – œuvrent surtout dans le domaine de la musique contemporaine. Mais ils ne sont pas les seuls à être branchés sur l’expérimentation. Des groupes tels que les Beatles ou Grateful Dead sont à l’écoute de leurs œuvres et puisent dans leurs inventions de quoi faire entrer le rock dans une nouvelle ère. Alors que le moment de l’enregistrement, pour des groupes de pop et de rock, consistait jusque dans les années 1960 à graver les versions des chansons jouées en concert, les Beatles appliquent les expérimentations issues de la musique concrètes à leurs séances. Avec eux, le studio devient un laboratoire où l’on peut jouer avec les bandes magnétiques pour trouver de nouveaux sons. Les albums Revolver (1966) et Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967) sont une révolution pour le monde du rock et l’industrie du disque, qui hallucine d’avoir laissé les fous s’emparer des studios ! À ce titre, la chanson Tomorrow Never Knows fourmille d’inventions. Alors que quelques jours suffisaient pour enregistrer un album dans des conditions live, les expérimentations des musiciens font grimper le coût de séances qui peuvent prendre plusieurs mois. La chanson Good Vibrations des Beach Boys, qui sera un de leurs plus grands succès, a nécessité quatre-vingt-dix heures d’enregistrement réparties sur six semaines, pour un budget de cinquante mille dollars. Le procédé de composition par tâtonnement et collage permet de réunir des idées éparses en un ensemble à la fois cohérent et original qui n’aurait pas pu voir le jour autrement et est d’ailleurs la plupart du temps impossible à reproduire en concert. Ce mode de composition deviendra la norme dans les années 70 pour le monde du rock.

Fantaisie militaire d’Alain Bashung © Laurent Seroussi.
Quand les drogues s’en mêlent.
Cette recherche de nouveaux timbres s’accompagne donc de nouvelles méthodes de composition qui prennent appui sur le développement technologique ayant cours au XXème siècle, notamment par l’usage des synthétiseurs et des bandes magnétiques. Mais plus largement, l’expérimentation s’accompagne d’une remise en cause des valeurs capitalistes. Le courant du rock psychédélique qui s’épanouit sur la côte ouest des États-Unis à partir de 1965 revendique l’usage de drogues diverses (cocaïne, marijuana, LSD, amphétamines, etc.) pour atteindre un niveau de conscience supérieur. Grateful Dead en fait sa marque de fabrique. Les concerts et disques du groupe sont basés sur des improvisations sous acide. Cette méthode risquée, puisque la plupart des membres du groupe y perdront leur santé, leur permet de créer sans se soucier des barrières entre les genres et les amène à fusionner blues, musique concrète, country, rhythm’n’blues ou raga indien. La prise de drogues est tellement courante dans le monde du rock qu’elle en est presque indissociable. La devise « Sexe, Drogue et Rock’n’roll » le résume bien. Tout ce qui est prohibé dans la vieille Europe comme l’Amérique puritaine est ici revendiqué. Pour la génération née après-guerre, le rock devient une façon d’échapper au modèle terne proposé par les adultes en prônant des valeurs telles que le partage (fais tourner le oinj !) et l’hédonisme. La mort par overdose de musiciens entrés dans la légende est hélas monnaie courante dans l’histoire de ce mouvement mais elle renforce la mystique entourant la prise de drogues.
Quasiment dès leur apparition, les drogues deviennent illégales et les gouvernements mènent une politique répressive féroce qui renforce la marginalisation des individus qui en consomment. Ajoutez à cela l’instabilité financière caractéristique de la vie de musicien et il n’est pas étonnant qu’il faille être un peu fou pour vouloir faire ce métier ! La pauvreté, l’errance, l’usage excessif de drogue et d’alcool ne sont bien sûr pas le lot de tous et sont loin d’être l’apanage des seuls artistes. Cependant, le fait de devoir partir régulièrement en tournée est souvent éprouvant, ce qui amène beaucoup d’entre eux à consommer drogues et alcool pour tenir le coup.
Faire face à la pression.
Par ailleurs, la création artistique oblige à l’introspection et au dépassement de soi. Cette mise à nu de l’individu, l’exigence liée à l’envie que chaque album soit meilleur que le précédent, les attentes grandissantes du public quand vient le succès et les pressions diverses exercées par les maisons de disques peuvent être difficiles à vivre. Alain Bashung, qui a connu le succès en 1980 après quinze ans d’errance professionnelle, est sonné. Il vivra deux crises majeures qui nécessiteront isolement et repos ainsi qu’une cure de désintoxication drastique en 1986 après des années de tournées trop arrosées. Dans sa chanson Au pavillon des lauriers (1998), il relate le mal-être qu’il éprouve en clinique psychiatrique : « Des toges me toisent / Des érudits m’abreuvent de leurs fioles (…) / Je veux rester fou ». Ces crises épisodiques sont certes marquantes mais elles ne prennent pas le dessus sur sa carrière. Ce n’est pas le cas pour Brian Wilson, des Beach Boys, qui manifeste des signes de troubles mentaux à partir de ses vingt-deux ans. Il renonce à partir en tournée dès 1964 mais continue à composer et enregistrer pour le groupe, accouchant de l’excellent Pet Sounds (1966) avant de sombrer pendant plus de vingt ans dans la dépression et la léthargie.
Ces musiciens, qu’ils soient cliniquement malades ou connaissent seulement quelques crises, nous amènent à reconsidérer la frontière ténue entre santé mentale et folie. L’originalité de leur démarche artistique et de leur personnalité les éloigne parfois du grand public mais ouvre également à celui-ci des fenêtres vers la fantaisie. L’image de la chanteuse Brigitte Fontaine est à ce titre parlante. Excentrique, elle fait souvent le clown sur les plateaux télévisés et joue de son originalité. Son premier album, déjà, associait son inventivité à une certaine forme de folie – le titre Brigitte Fontaine est… ? (1968), est souvent complété par le mot « folle ». Pourtant, elle souffre de cette image qui lui colle à la peau, allant même jusqu’à répondre aux moqueries dans la chanson Folie dans l’album Rue Saint-Louis en l’île (2004). Le groupe de rock Feu ! Chatterton propose quant à lui un rapport plus apaisé à la folie. La peur de devenir fou est source d’images venues d’une conscience altérée par la prise de drogues dans le titre Fou à lier dans l’album Ici le jour a tout enseveli (2015) : « Que les voix se taisent / Après la tempête / Je flotte dessus mes hantises / Dessus la peur d’être fou à lier / Marteau comme ici les requins / Que j’ai dans la coloquinte / Au fond du bocal / Fêlé ».
Accepter le fou qui dort en nous, le laisser sortir quand la vie manque de fantaisie mais ne pas le laisser nous dominer, tel est peut-être l’enseignement que l’on peut tirer de tout cela. Car après tout, comme dit Michel Audiard, « Heureux soient les fêlés, ils laisseront passer la lumière. »
Photographie à la Une © The Beatles © Richard Avedon.