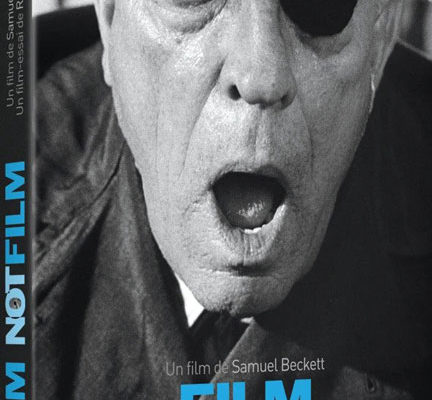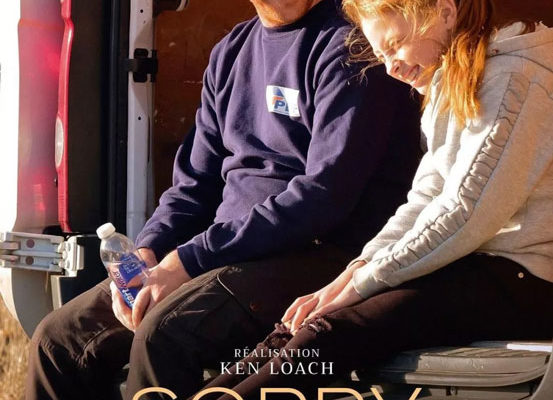Un genre pas assez noble, la comédie ? Il n’en est rien, car chaque comédie entend changer le monde. Pourtant, et ce depuis quelques années, le rire tend à s’évanouir dans le vide.
À l’époque de sa création, le cinématographe servait à capter le réel, en restituant fidèlement le temps et l’espace. Ce n’est qu’après que des cinéastes s’en sont servi comme moyen pour raconter leurs fabuleuses histoires et fonder leur propre imaginaire. Ce fut peut-être la période la plus créative et innovante de l’histoire du cinéma car tout était devant les artistes, il fallait tout inventer. Ils étaient des milliers mais seulement les meilleurs sont restés car ils ont été les plus grands inventeurs de forme.
Le cinéma s’est créé sur deux fondements distincts mais indissociables : l’un intellectuel, expérimental donc élitiste et l’autre populaire. C’est ne pas connaître le cinéma que d’oublier que le cœur de celui-ci, c’est la blonde séductrice, le pistolet qui détonne et le clown qui fait rire. Sur le modèle du théâtre, le cinéma s’est donc construit sur cette veine populaire en se divisant en deux voies distinctes, le drame incarné par les films de Griffiths et la comédie burlesque. Cette division a donc été le fondement des normes, des fondations sur lesquelles les deux genres vont peu à peu s’émanciper jusqu’à des sous-genres, voire des films expérimentaux. Si l’on imagine le cinéma comme art du temps et de l’espace, l’ère comique a été riche d’une certaine liberté filmique en la matière, le burlesque étant basé sur une construction minutieuse du gag et de l’impact de ce dernier sur la forme du film. Il faut rappeler que les cinéastes du muet ont tout inventé ; mais pas le cinéma parlant, puisqu’ils savaient qu’ils n’en avaient pas besoin, que toute pensée et tout langage se trouvaient dans la forme de leur film. Keaton, par exemple, savait à peine écrire et parler ! Parler le décevait, alors il a dû trouver un moyen de communiquer avec le monde. Serge Daney était venu le voir à la fin de sa vie, et il raconte que Malec était capable de se souvenir de chaque gag et du contexte de sa création, tel un amoureux qui se souvient de son premier « je t’aime ».
Selon André Bazin, les premiers films burlesques sont basés sur un « comique de l’espace, de la relation de l’homme aux objets et au monde extérieur » où, en plan large, les divers éléments du gag se trouvent en présence les uns des autres. Les metteurs en scène arrivaient à organiser leur film de façon à ce que le mime recrée le langage entre les individus et le rapport de ces derniers avec l’objet. C’est l’incompréhension du personnage face à ce qui lui arrive, cette appréhension progressive de l’environnement qui crée le rire chez le spectateur car le film se débarrasse de tout superflu du langage qui ne ferait que rajouter de la confusion au gag construit. Le film se retrouve ainsi épuré jusqu’à sa matière première qu’est la mise en scène.
Et puis le parlant est arrivé, et le cinéma a peu à peu perdu de sa capacité comique et d’émerveillement. Le mouvement des corps laisse place au mouvement de la parole, le langage s’essouffle, tournicote et les personnages deviennent des fantômes. L’âge d’or du burlesque repose sur trois metteurs en scène indispensables. Il est évident et presque décevant de devoir citer le duo phare Chaplin et Keaton, auquel on rajoutera Tati, qui interviendra plus tard, mais pour mieux digérer le cinéma de ses aînés.
Dans Le Mécano de la « Général », Buster Keaton est un cheminot à la poursuite de son train volé et de sa fiancée. Le film est ancré en pleine Guerre de Sécession et face à cet entre-déchirement, Buster Keaton va user de son seul corps dont l’élasticité va moduler le monde et l’objet extérieur ; ainsi, le gag le plus fameux du film sera une partie de mikados géante pour tenter d’arrêter le train lancé à toute vitesse. Le film est en mouvement perpétuel à l’image du mouvement du monde et de la guerre. Face à quoi, Keaton court, s’essouffle mais ne s’arrête pas : il réussira à retrouver ses deux amours, son train et sa fiancée. Quand on lui demandait comment il avait fait, avec ce qui est pourtant une comédie et pas un film historique, pour montrer une guerre civile qui fasse plus vraie que Naissance d’une Nation, film pourtant très sérieux, Keaton répondait : « Ils se sont référés à un roman pour leur scénario. Moi, je me suis référé à l’Histoire. ». C’est la réponse géniale d’un artiste génial qui avait compris que l’Histoire est source nourricière de l’histoire du cinéma, et que rien ne peut être plus ontologique ou historique qu’un film et donc, qu’une comédie.
Comme Buster Keaton, Charlie Chaplin se retrouve face au monde qu’il va changer grâce à sa seule volonté physique et morale. Il a quelque chose de beaucoup moins physique mais plus volontaire que Keaton. Dans Les Lumières de la Ville, il devient boxeur, ramasseur de crottin avec peu de succès avant de finalement trouver l’argent pour soigner l’aveugle dont il est amoureux. Le rire tient au ralentissement de l’action dans le film, savant mélange entre le gag et le pathos. Le film est donc en deux temps, car Charlot est un vagabond dont personne ne veut, il va essayer de prouver pendant tout le film que lui aussi a sa place. C’est « je me cogne » et « je m’excuse même si j’ai raison ». Ce n’est jamais un rire aux dépens de lui mais avec lui ; car Chaplin a raison, Chaplin est bon et quoiqu’il puisse lui arriver, il fera triompher son idée du bien.
Tati commence à faire des films bien plus tard que ses prédécesseurs mais aura une influence déterminante sur le cinéma de son époque. Lui aussi crée un personnage mais surtout il ne parle pas, chose étonnante dans les années 1950 où le cinéma est devenu entièrement parlant ! Comme ses prédécesseurs, il balade son personnage dans le monde, non pas en critiquant son industrialisation et sa déshumanisation progressive, mais plutôt en tentant de voir comment l’homme s’inscrit dans les nouvelles perspectives architecturales de la ville et des choses modernes et comment celles-ci peuvent devenir une nouvelle esthétique. À l’époque du parlant où certains se vautrent dans la harangue contre le monde, réactionnaires de bas étage, usant de la parole comme ceux qu’ils prétendent combattre, Tati, lui, montre le monde, le filme et se tait. Il l’appréhende avec le spectateur et se trompe, gaffe, trimballe sa carcasse enveloppée de son grand imperméable gris et on rit parce qu’emmitouflé comme ça, il nous fait penser à nous. L’esthétique des films de Tati trouve une résonance particulière avec Mon Oncle, sorti un an avant la Nouvelle Vague, et Playtime, sorti un an avant mai 68. C’est le propre des géants, ceux qui ne vont pas démontrer le monde en usant de leur toute puissante stature d’artiste pour nous imposer leur vérité, mais ceux qui vont user de leur talent, comique ici, puisque Hulot fait rire grâce à sa pantomime pour construire des variations esthétiques, des blocs d’espace et de temps qui vont contenir le sens de l’œuvre. En ce sens, Tati est bien plus dans son époque que l’on ne pourrait le penser et pourrait se voir comme le pendant comique de Michelangelo Antonioni. D’autres très grands comédiens ou metteurs en scène vont prolonger le cinéma de ces trois grands, on pourra ainsi citer Lloyd et Linder dans les années 1920. Les Marx Brothers représentent une transition avec le deuxième âge de l’ère comique entre burlesque et nouveau langage entre individus. À noter que Peter Sellers, héritier de cette transition, jouera dans le dernier grand chef d’œuvre burlesque The Party sorti en 1968 qui raconte la destruction d’une soirée hollywoodienne par un acteur indien gaffeur. In fine, la satire est détournée car la maison où se déroule la soirée est un microcosme d’Hollywood, où au détour d’un couloir se trouve l’acteur neuneu, le producteur véreux et la figurante maltraitée.
Apparaît ensuite la comédie de boulevard, fortement inspirée des codes du théâtre et marquée par l’évolution des mœurs de l’époque. La relation objet / individu évolue vers la relation individu / individu et l’incompréhension de la langue d’autrui. Cela donne lieu à un cinéma très écrit où l’impression de quelque chose qui se perd devient peu à peu perceptible ; déjà des poncifs apparaissent et seuls les plus esthètes survivent, ceux qui doivent filmer sous peine de mourir, en vrac : Edwards, Tashlin, Mc Carey, Hawks, Capra, Wilder ou Cukor. L’histoire du cinéma est jonchée de cadavres d’acteurs comiques talentueux qui n’auront jamais été réellement filmés, les metteurs en scène se reposant sur leur potentiel comique pour faire le film, ce qui fait qu’aucune mise en scène ne vient incarner la gestuelle et la parole du pauvre clown. Cela a permis la conquête du cinéma, ce qui creusera lentement sa propre tombe. La comédie de mœurs laisse bientôt place à une troisième période : la comédie culturelle. Dans les années 1990, le cinéma amorce sa lente transition d’un art superbe vers un loisir de luxe. La comédie est le premier genre à en pâtir car dans la logique, ce qui est drôle divertit forcément. Elle ne va plus répondre à des codes artistiques comme pouvaient le faire le burlesque ou la comédie de mœurs mais à des critères commerciaux. Cette comédie de caniveau est facilement identifiable. On pourrait l’analyser de façon schématique, en prenant en compte deux grands pays producteurs de films comiques, la France et les États-Unis.
La comédie américaine cheap va se calquer sur des modèles de vulgarité, de misogynie et de machisme sous couvert de l’argument générationnel sans lendemain. Il y a une foison de petites starlettes qui vont trouver ici l’incarnation de leur débilité. On trouve cependant une chose commune aux deux : le cinéma comique sert de tremplin aux humoristes à succès. Que ce soit le Saturday Night Live ou bien Canal+, Jamel Debbouze ou bien Kristen Wiig, une chose est sûre : le cinéma n’est jamais loin. Ce qui donne lieu à des choses extrêmement curieuses, l’immondice et l’innommable Les garçons et Guillaume, à table ! était vendu comme le succès de l’année 2013 plusieurs mois avant sa sortie en salle ! Chose qui n’étonnait plus au visionnage du film et qui au moins a le mérite de représenter tout ce qui cloche aujourd’hui en France dans la comédie et in fine dans le cinéma : le film n’est qu’une succession de vignettes illustrées de leurs gags les plus populaires. Il faut imaginer Gallienne à la rédaction du scénario, se voyant déjà aux Césars « Ah merde, j’ai oublié le gag du lavement anal, les gens étaient morts de rire hier à l’Olympia ! ». Aucune mise en scène, même pas la moindre pauvre idée, rien n’est pensé, si ce n’est raconter sa pauvre vie d’homophobe petit bourgeois. Il est de bon goût de faire des films pour exorciser ses propres démons ; le problème étant que ceux de Gallienne sont tout sauf angoissants ou terrassants et relèvent du déballage privé. Et cela calqué au fait qu’ils doivent faire rire à tout prix en usant de clichés tellement grossiers qu’ils en deviennent honteux et criminels, telle la scène dans la boîte de nuit gay. Dans le monde de Guillaume Gallienne, les homosexuels sont arabes, vivent dans des caves et couchent avec n’importe qui, mais Gallienne trouve l’amour devant le coucher de soleil avec une amie de sa meilleure amie rencontrée au spa, elle avait pris les massages avec l’allemande qui fait peur elle aussi, quelle étourdie ! Que l’on se rassure, cet homme ne refera jamais de film. Mais d’autres, si. En effet, si le cinéma est un loisir, autant qu’il serve à quelque chose, qu’il condamne ce qui ne va pas aujourd’hui. Et qu’est-ce qui ne va pas ? L’intolérance et le racisme, les fléaux du pays des Lumières, ces comédies à la française se proposant d’être la réponse républicaine avec en prime Monsieur le Ministre qui a adoré. Le rire permet d’appuyer là où ça fait mal, l’intolérance ne passera pas, non, non, quelle infamie celle-là ! Et Clavier te le ressortira en conférence de presse : « Je suis un sarkozyste repenti, non au racisme ! ». Ce rire est le pire, c’est celui du diablotin qui agit de façon détournée : le rire promet de combattre le racisme mais s’y vautre lui-même en usant du fameux cliché renversé ce qui revient à dire que le cliché est peut-être exact à la base. Ou bien alors, le rire qui naît de la confrontation schématique et balourde de deux personnes que tout oppose. Au choix : l’arabe avocat de Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? ou Omar Sy et François Cluzet dans Intouchables.
Il y a de maigres exceptions. Le regard échangé entre Cera et Hill à la fin de Supergrave contient toute la mélancolie d’un âge révolu : l’adolescence, cet intermède glorieux de rires et de larmes, est maintenant terminé. Betbeder, Triet ou Peretjatko sont eux animés par un désir de liberté filmique et leur honnêteté est contagieuse. Mais à l’heure du succès des Youtubeurs Norman and co qui s’arrogent le droit de faire du cinéma, la comédie n’est pas prête d’aller dans ce sens espéré. La défiance envers le cinéma et envers tout ce qui pourrait être emmerdant, fait que les producteurs vont continuer à prendre les spectateurs pour des cons et pire, vont édicter de nouvelles normes « artistiques ». Le pauvre clown au nez rouge devra repartir avec son cirque itinérant vers des lieux plus cléments. Alors du coup, on repense à Chaplin, Keaton, Linder, LLoyd ou Tati. Incompris ou honnis, ils auront eu de leur vivant peu ou prou de succès. Peut-être parce qu’avec eux, la chape d’ombre se retirait un peu du monde.
Tous ces artistes étaient à l’heure. Ils étaient dans le monde, suffisamment modernes pour faire la critique de ce qu’ils voyaient en riant. Ils étaient les plus beaux et les plus forts, imposaient leurs corps en première ligne et se prenaient la misère, les trains, les destructions en pleine face, les regardaient et riaient de façon si tonitruante que cela se transformait en un puissant chant d’espoir et de liberté.
Illustré par Alison McCauley.