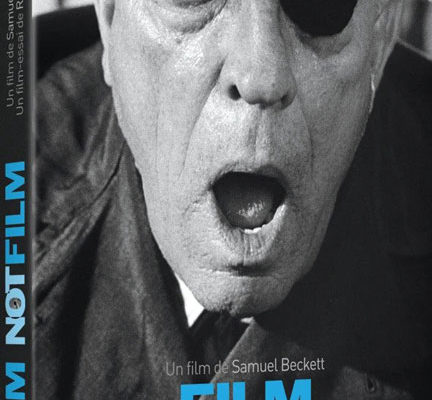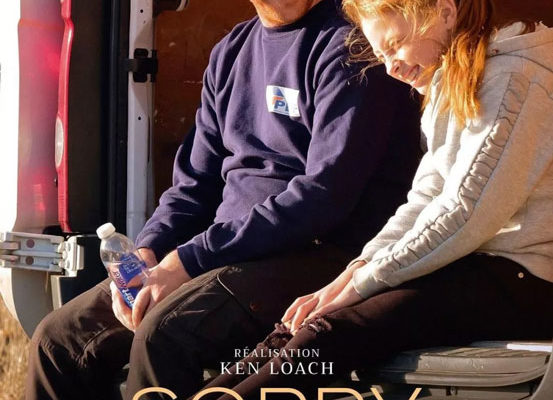une fabrique de fantômes ?
Art du mouvement, l’art cinématographique est-il un art du corps ? Le mouvement de la pellicule, ou plutôt des pixels (le 35 mm disparaît officiellement fin 2013) est-il le lieu du corps ? N’en déplaise à notre cher André Bazin*, le corps au cinéma est une série de lambeaux marqués dans la pellicule, qui traînent derrière eux les fantômes de leurs acteurs et actrices. Pensons à l’éternel « exemplum » du cinéma: Vertigo d’Alfred Hitchcock, tiré du roman policier D’entre les morts de Boileau- Narcejac dans lequel Judy (Kim Novak), qui jouait la fausse Madeleine dont le meurtre a été déguisé en suicide, revient à Scottie (James Stewart) sous une apparence troublante, entourée d’un halo vert lumineux. Scottie, qui a perdu la femme qu’il aimait, demande en effet à Judy qu’il ne connaît pas sous sa vraie identité, de se transformer en Madeleine (éternel mouvement du film et obsession de Scottie) – celle-ci sort de la salle de bains sous la forme attendue. Un chignon et un costume et la voilà redevenue la morte Madeleine, la voilà qui craque le linceul scellant la mort à la morte.
Tous ces corps nous hantent…
N’est-ce pas ici, pour nous spectateurs qui regardons des films d’il y a plus de cinquante ans, une façon de voir avec encore plus d’évidence que nos pères cette apparition spectrale du corps de Kim Novak ? Il semble que l’épaisseur du temps ait donné à ce corps en mouvement une plus forte présence. Oui. Sur la pellicule, le corps est corps lorsque son fantôme cristallise à jamais (tant que sa forme traverse les générations) son image. C’est peut-être à travers les filtres que s’opère une existence du corps au cinéma. Filtres dans le récit (Judy joue Judy qui jouait Madeleine), filtres à l’image (halo verdâtre, avancée lente de Judy vers Scottie), filtres dans le temps (le film à sa sortie en 1958, ses traces dans l’histoire du cinéma, notre regard contemporain etc.).
Hiroshima mon amour.
Le cinéma est hanté par les morts – les corps.
Des millions de corps qui transparaissent avec la même vigueur qu’ils le faisaient le jour où les rushs de ces images ont été regardés pour la première fois. Quels sont ces corps enlacés recouverts (de cendre, de sable, d’étoiles ?) qui ouvrent Hiroshima mon amour ? Ne sont-ils pas eux aussi des corps qui hantent l’esprit, qui titillent notre habitude de croire que ce qu’on voit à travers l’écran est du vivant ? Vivant qui meurt quelques heures après dans notre esprit tant la consistance de ces êtres se fond dans la banalité des images, de la mise en scène. Mais les corps d’Hiroshima ne nous laissent pas indemnes.Ils bougent et ne nous disent pas qui ils sont. Ils vivent et n’ont pas de visage. Mais ce ne sont pas des statues, ce sont bien des corps que l’on voit – sectionnés par le cadre, non reconnaissables, mais qui restent. Leur image flotte par l’imperceptibilité de leur ensemble (le corps en entier) elle questionne et dilate l’oubli.
La Reine Margot.
Le médium du cinéma qu’était la pellicule et qu’est l’image numérique ne peuvent pas figer comme le fait la peinture ou la sculpture, le mouvement du corps. Le cinéma, lui, doit créer sa propre immobilité, son propre arrêt du temps. Ainsi par son mouvement achevé (le temps d’un film) il fabrique le linceul des corps filmés. J’en profite pour ajouter une image de La Reine Margot de Patrice Chéreau qui intègre l’art pictural à son image, créant un effet « écrin » du temps d’autant plus subtil. Les corps blancs, saignants, fendus par les lames catholiques, sont touchants tant qu’ils vivent, explosent de révolte, voudraient percer l’écran de leur beauté baroque. Pourtant Chéreau continue d’accumuler les corps sur les charniers de la Saint Barthélémy, de les aligner dans les rues de Paris pour qu’ils prennent la poussière et finissent dans l’oubli – en attendant un autre massacre, un autre film. La peau éclatante des corps-amants de Margot et la Môle voulaient nous faire croire à une éternité de l’amour, étouffée par le pouvoir royal (le Roi, la Mère). La persistance de l’amour et de la mort nous montre des corps qui se vident de l’énergie demandée pour des amours déchirantes (avec amants, frères, mères) et un massacre.
Mulholland Drive.
Chez David Lynch, la présence des corps est de l’ordre du spectral. Il reprend dans Mulholland Drive l’esthétique des films classiques hollywoodiens, et leur façon de mettre en scène les stars par l’insistance du gros plan et d’une lumière voilée, douce, fantomatique. Dans le film, Lynch nous fait douter de l’existence véritable de Rita (Laura Harring) par la mise en scène. Apparaissant dans la maison de location à Hollywood de la jeune actrice Betty (Naomi Watts) après un accident de voiture où elle a perdu la mémoire, Rita devient l’objet de désir de Betty. Mais la façon dont ces deux jeunes femmes se lient est troublante puisque nous ne pouvons déterminer les étapes de leur relation. Dès lors, nous ne pouvons affirmer si Rita est une image idéalisée de Betty, et/ou son double intérieur (le film est un miroir brisé – équivoque illimitée). Ce double corps féminin de Betty collant aux idéaux de Hollywood (proportions parfaites, impersonnalité, sensualité, vide intérieur) est de fait un désir visuel. Repensons à la séquence où Betty met une perruque blonde à Rita et que celle-ci se déplace sans un mouvement pour se regarder dans le miroir. Elle est là, mais flotte dans l’image comme un spectre, devenant figure inatteignable. Rita vit à l’image avec plus de vigueur que Betty en tant qu’elle est objet de désir – à en mourir (cf. le suicide de Betty) – mais elle n’est pas vivante comme l’est Betty, qui elle, désire. C’est là toute la problématique de l’esthétique du film classique, et de celle de – comment filmer les corps -, que David Lynch confronte ici à la question du moi et des désirs inconscients. On retrouve ici l’envergure d’une Judith fantôme de Madeleine dans Vertigo avec toute l’intensité des autres thèmes abordés tels que l’appropriation par Hollywood des corps des stars, et la place de la sexualité comme prisme des fantasmes.
la place de la sexualité comme prisme des fantasmes
La Belle et la Bête.
Un dernier exemple me paraît essentiel en ce qui concerne les corps-fantômes au cinéma, ce sont les apparitions des personnages dans La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Comment oublier les avancées de Belle dans le couloir aux candélabres vivants (bras flottant sur un mur noir) ? Comment oublier le corps de la Bête, se dégradant de jour en jour – fumant de maladie – de mal être (d’amour) ? L’esthétique extrêmement travaillée de Jean Cocteau à travers ce film essentiel (une belle qui veut aimer, une bête qui ne peut pas l’être) rend compte de ce que les corps sont des outils formidables pour raconter des histoires. La Belle est belle alors que la Bête n’est pas d’une beauté humaine, ce sont des extrêmes générés par l’opposition de ces deux êtres au sein de la mise en scène. Pourtant Cocteau crée à l’écran une beauté baroque de la Bête, lui donnant une apparence princière, chevelure rayonnante et costumes de flanelle. Mais ce visage est le visage de l’horreur (pour le spectateur), du mal en soi-même – du sauvage qui rend fou cet être à demi. C’est cette infirmité interne qui crée le décalage. Nous ne pouvons regarder le visage d’une bête, l’aimer comme celui d’un autre que nous-mêmes.
Le corps de la Bête questionne notre vision du corps de l’autre – il brûle, irrite notre vision du Beau (le corps de l’athlète grec) tout en apparaissant à travers une esthétique du ‘Beau’ – de la volupté. Il fallait Jean Cocteau pour aligner, ou plutôt encastrer ces deux contraires.
Les corps au cinéma ne seraient-ils, en fin de compte, que des corps fantômes fixés par l’image ?
Leur mort, inhérente à chaque film, et même si elle n’est qu’un faux semblant, permet, en tous cas, à leurs spectres de vivre éternellement et de hanter à jamais nos mémoires.
* André Bazin (avril 1918 – novembre 1958) est un critique français de cinéma.
A la Libération, période intense pendant laquelle on veut amener «le peuple à la culture et la culture au peuple» et, fort de cette conviction, il s’engage à travers Travail et culture et Peuple et culture dans l’éducation populaire. Il fonde avec Jacques Doniol- Valcroze et Leonid Keigel, en avril 1951, les Cahiers du cinéma dans lequel écrit toute une génération de critiques et de futurs cinéastes qui feront partie de la «Nouvelle Vague». En mourant en 1958, un an avant le premier film de Truffaut, André Bazin n’a pas eu l’occasion de voir émerger la nouvelle génération de cinéastes qu’il a profondément marquée par son intelligence et son engagement.