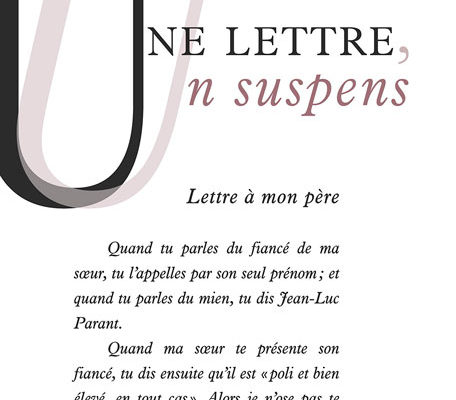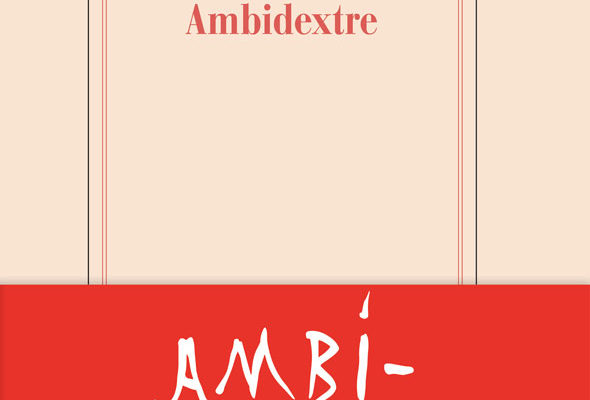Ma mère a fait partie des troupes de tirailleuses post-colonisation ; de vaillantes combattantes pour la liberté d’être des femmes libres. En ligne de front.
Sa vie durant, ma mère a travaillé comme femme de ménage. Quand elle a rejoint mon père en France, avec ses trois jeunes enfants sous les bras, elle a très vite commencé son nouveau, premier et unique métier. Sans diplôme et maîtrisant à peine le français, ma mère faisait partie de ce que l’on pourrait appeler « les troupes de tirailleuses post-coloniales ». De valeureuses combattantes, mais surtout des éclaireuses.
Parce qu’elle a aimé rendre les lieux habités propres et rangés, parce qu’elle a apprécié ses patrons, que ces derniers le lui ont bien rendu aussi, d’une façon ou d’une autre, ma mère a aimé son métier.
Au tout début, elle travaillait seulement l’été, elle suivait mon père qui se rendait sur les chantiers de la station balnéaire. Tous les deux sur la Vespa, ils partaient vers leurs champs de bataille. Pendant que mon père retrouvait les légions d’ouvriers étrangers, ma mère rejoignait le campement de base ; les appartements de location déjà livrés ou les chambres d’hôtel qu’il fallait rendre propres comme des sous neufs pour l’arrivée massive de vacanciers.
Très vite, grâce à sa gentillesse et à sa bonne humeur, elle a trouvé des patrons toute seule. Monsieur Cardi l’assureur, la dame du cinéma, Diana et Cornelius qui tenaient l’hôtel La Galiote et tant d’autres… Elle rentrait pour sa pause, vers 13 heures, épuisée, puis repartait, revenait parfois après 21 heures. Son emploi du temps était morcelé, ses allées et venues nombreuses ; toujours à pied puisqu’elle n’a jamais appris à conduire. Parfois, ses patrons lui apportaient des corbeilles de linge à la maison. Elle s’installait dans le salon et débutait sa deuxième session de travail, en regardant Santa Barbara.
Le samedi après-midi je l’accompagnais chez l’assureur, ma seule tâche consistait à vider les corbeilles, puis je traînais d’un bureau à un autre, dessinais, testais tous les stylos ou les machines à écrire…
C’était toujours nickel chez les autres alors que chez nous ce n’était pas vraiment le cas. Enfin, elle faisait comme elle pouvait car elle nous interdisait à ma sœur et moi de faire le ménage tant que les devoirs n’étaient pas terminés. Elle n’avait que ces mots à la bouche : « Vous avez fait les devoirs ? ». Cette question ponctuait ses allées et venues, comme si elle ne pensait qu’à cela, quand elle était toute acquise à sa tâche de ménage chez les autres. Le dimanche après-midi, elle repassait sur la table de la cuisine, pendant qu’à l’autre bout, je remplissais mes pages blanches ; les lignes étaient rythmées par les mouvements du fer. J’écrivais sans arrêt, alors que la pile de vêtements montait doucement et formait un rempart, derrière lequel, peu à peu, je me retranchais pour faire plaisir à mon éclaireuse de mère. Plus j’écrivais, plus j’apprenais, plus je rendais ma mère fière et heureuse.
Elle ne voulait pas faire de nous des tirailleuses, mais des futures travailleuses, des intellectuelles, des filles cultivées, qui sauraient répondre, dire les choses justes quand on entend des ordres absurdes. Grâce à l’école, on serait capable de se défendre, de faire la guerre aux idées reçues. Obtenir son bac, faire des études, voyager, devenir des femmes responsables et éclairées, c’était cela sa priorité absolue. Son ordre de mission.
Aujourd’hui, elle continue de faire mon ménage quand elle vient chez moi. Elle se régale, je le vois bien, elle est toute fière de me montrer mes placards avec des piles de vêtements que l’on croirait sortis d’un faux décor de chez But. Souvent, elle me réprimande car je ne fais pas assez attention aux affaires, que mes placards sont mal rangés, que mes lessives ne sont pas triées, que mes fenêtres ne sont pas nettoyées… Elle me dit : « Mais, enfin c’est pas possible, qu’est-ce que je t’ai appris ?! ».
Image à la Une © Lilia El Golli.