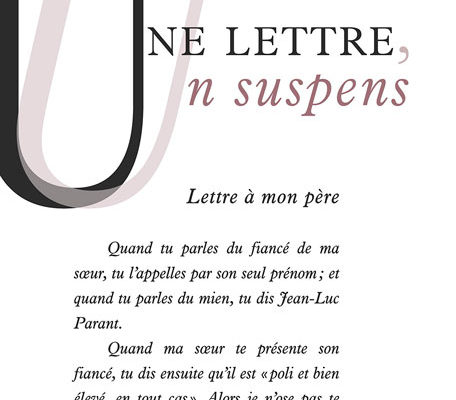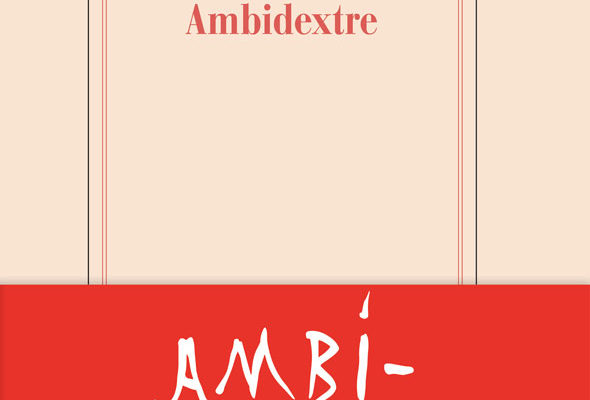« Perdre la raison ». « Devenir fou ». « Être cinglé ». Nous avons construit puis agencé des mots, tordu notre langue pour décrire l’indescriptible : cet instant où l’un d’entre nous quitte la mer-matrice, et entre dans l’air chaud et sec de la douleur sans fond ni forme. La folie est d’abord séparation.
Je me souviens encore de certains plans de la séquence. Le moment où le père descend dans le cellier qui abrite la réserve de viande. Des femmes et des hommes entièrement nus, entassés, certains ayant encore la force de bouger un membre. Vu leur état de crasse, cela doit faire plusieurs semaines qu’ils servent de nourriture aux braconniers qui ont investi la demeure abandonnée ; un petit groupe de femmes et d’hommes entièrement armés, commissures des lèvres tirées vers le bas, sourcils froncés, regard sans âme.
Ce fut une chance, m’a-t-on dit, d’avoir eu affaire à cette adaptation du best-seller La Route avant de le lire. Version discrète, posée, loin du tissu spectaculaire de tout bon film post-apocalyptique. Le réalisateur John Hillcoat avait, paraît-il, fait le pari d’abandonner les codes cinématographiques habituels, c’est-à-dire la distraction par stimuli, au profit d’une véritable interrogation du spectateur sur son humanité et son sens de la vie. Car après tout, rien n’a jamais dit qu’un portrait de la survivance devait être cacophonique et agité de soubresauts. Il est même d’autant plus puissant qu’il est narré doucement. Version discrète, posée, « allégée » – Hillcoat l’a avoué plus tard – d’une scène encore plus insoutenable que celle du cellier et de ses hommes-provisions : la découverte d’un nouveau-né dépecé et rôti au-dessus d’un feu. La scène passait à peine à l’écrit, alors à l’écran… Mais je ne l’ai pas vu, ce bébé. Je n’ai pas pu lire l’histoire.
Le cellier visité au cinéma a hanté mes rêves plusieurs nuits durant. La perte progressive d’humanité chez le père ; l’irréfragable et affolante déréliction des hommes ; le combat sans fin pour espérer sauver l’espoir de pouvoir encore espérer. Un combat où chaque inspiration vaut une année de guerre. Pendant que je vous parle, le livre prend l’humidité contre un mur de pierre derrière mon lit, encore ceinturé de son bandeau vendeur. Cet objet-là – l’ouvrage non encore ouvert mais déjà dévoilé – ne renferme à mes yeux ni traversée, ni réflexion, ni langue. Seulement un petit groupe de femmes et d’hommes entièrement armés, commissures des lèvres tirées vers le bas, sourcils froncés, regard sans âme. Je dors près de ces monstres depuis 2008, année de la sortie du roman en France. Je sais qu’ils sont le contraire de moi, et inversement. Qu’ils sont fous et que je ne le suis pas, tout est parfaitement clair. Même si mon âme renferme le secret que mon corps, dans une situation hautement critique, n’aurait peut-être aucun seuil de tolérance et pourrait mâchouiller un morceau du ventre de ma mère – la partie de son corps la plus dodue, pour le moment je dis « plutôt crever ». J’ajoute que si en disant cela je me trompe, si une part de moi se ment à elle-même sans que je le sache, alors oui, j’ai de nombreuses chances de perdre un jour la raison. À l’instar des autorités tchétchènes qui persécutent puis torturent des êtres humains homosexuels dans des camps de concentration de l’an 2000 – j’ai découvert cela hier. Ou que les passeurs en Libye vendant entre deux cents et trois cents dollars des centaines de migrants en provenance d’Afrique de l’Ouest – découvert ce matin. Des femmes et des hommes entièrement décapés de toute trace d’humanité, soumis au travail forcé et à l’exploitation sexuelle, là, dans des marchés aux esclaves.
Pour produire de telles atrocités, il faut être nombreux, ligués, et résistants – car contrairement à ce que l’on entend parfois, détruire la vie demande autant de travail et de patience que l’encenser. Mais pourquoi des individus capables, dans les grandes lignes, des mêmes atrocités se regroupent-ils ? En l’absence d’une étiquette arborée, d’un signe distinctif, comment se reconnaissent-ils ? D’où naît la complicité, aussi pratique que mentale, dans ce complet renversement de la morale ? Mettons de côté l’appât du gain et le soulagement plus ou moins conscientisé que procure un acte de barbarie à son auteur. Reste la volonté de se lier à ses semblables.
Aujourd’hui, en psychiatrie, la folie comme pathologie n’existe plus. On parle plus volontiers d’un manque d’outils de compréhension de notre part, à nous, les autres. Cette conséquente évolution de pensée signifie deux choses : est fou celui qui est incompris ; est souffrant celui qui est fou. Souffrant, c’est-à-dire accablé d’une douleur morale extrême. De fait, inimaginable. Si l’on étend cette nouvelle perception à l’acception sociétale du terme, le « fou » serait donc, malgré les apparences, celui qui a trop souffert, qui ne peut désormais habiter que le trop-plein du monde, et surtout, dont nul n’a reconnu la souffrance. On sait par ailleurs qu’en physique quantique, une particule mise en mouvement ne se comporte pas de la même façon selon qu’elle est observée ou non. C’est-à-dire que, pour une raison encore mystérieuse à ce jour – et que d’aucuns appelleront Dieu –, elle est influencée par le regard que l’on porte sur elle. Transposé à l’échelle des hommes, ce principe n’est pas moins valable. Il semblerait que quelque chose dans le regard du passeur, au moment de fourguer les humains au marchand sur la place, contacte tout ce qui, en ce dernier, a été défiguré, pour lui dire « je sais », catalysant par ricochet sa déshumanisation qui n’était encore qu’un potentiel enfoui. Il en va de même pour tous les autres.
Dans La Route, les cannibales sont aussi colocataires ; c’est ensemble qu’ils capturent, entreposent, rôtissent et dégustent – voire font l’amour ensuite, une fois la caméra éteinte. Les tortionnaires tchétchènes, eux, se confient peut-être en ce moment-même des souvenirs d’enfance noirs, entre deux hurlements d’agonie parcourant les couloirs. Peut-être que si chacun d’entre eux s’adonne à une telle cruauté, c’est parce que les autres, par une fibre fraternelle insondable, l’y autorisent. Oui, peut-être que pris isolément, beaucoup parmi nous que l’on pourrait qualifier de « fous » ne le seront jamais ; que c’est seulement dans un bain collectif que leur folie validée s’affirmerait enfin, parce qu’elle serait objet de consolation. « Je sais que quelqu’un a tué ton âme. » « Je sais de quoi ton cœur a manqué » « Je sais qu’ils n’auraient pas dû te faire ça, mais il est trop tard. Viens plutôt célébrer avec moi l’absurdité de n’y pouvoir plus rien. » Voilà ce que j’entends, derrière la folie de ces femmes et de ces hommes. Derrière notre choc et notre dégoût primesautiers. Il est possible que mon exemplaire de La Route, là, contre son mur de pierre, n’attende pas vraiment d’être lu, et que ses cannibales passent encore de nombreuses et longues nuits à mon côté. Il est possible qu’en réalité ils soient là, comme les passeurs et les tortionnaires, pour nous rappeler, à nous les autres lointains de veiller chaque instant de chaque journée et de chaque nuitée, sur l’amour dans nos vies comme une mère sur son nourrisson.
Photographie à la Une © Grégory Dargent.