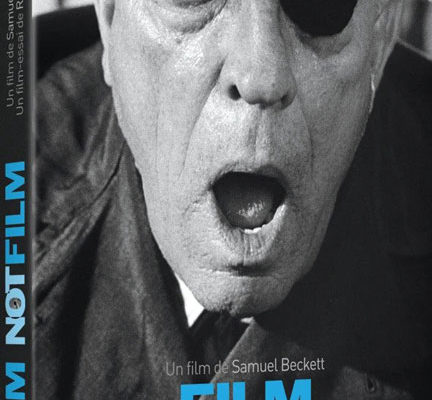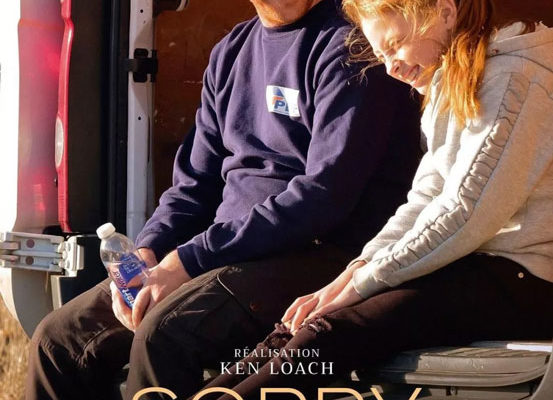« La célébrité, pour moi, ce n’est pas le bonheur… C’est très fugitif même pour une orpheline… Ça ne rassasie pas. C’est un peu comme le caviar, vous savez, c’est agréable d’en manger, mais pas à tous les repas… » – Marilyn Monroe.
Derrière le rire, il y a les larmes. Le bonheur n’est-il pas alors qu’un faux-semblant ? Le cinéma a compris depuis toujours qu’il fallait projeter sur nos écrans l’image du bien-être, de la joie de vivre, que c’était la meilleure façon de nous faire oublier un instant dans la salle obscure nos sombres pensées. Mais voilà, jetons un regard de l’autre coté de la toile et le bonheur disparaît comme par magie.
Le bonheur, pour divertir.
L’un des grands principes du cinéma a toujours été de faire rire et de divertir. C’est encore le cas aujourd’hui. Dès l’apparition des premiers films des frères Lumière tel que L’Arroseur arrosé en 1896, le cinéma s’est annoncé comme l’art du divertissement. Il s’agit ici de faire rire le spectateur, de lui apporter une bouffée d’air frais et hilarant, de lui faire oublier les soucis du quotidien. Ainsi le cinéma burlesque est né en utilisant le rire et la caricature comme des mécaniques implacables qui ne sont bien souvent que les répliques de celles qui existaient déjà au théâtre aussi bien dans les décors que la gestuelle des comédiens et qui font naître la bonne humeur. Le spectateur est alors atteint de soubresauts, éclate de rire voire de fou rire et finalement sort des premières projections heureux et ravi d’avoir assisté à un spectacle désopilant qui lui rappelle ce qu’il connaît et ce qu’il voit sur les planches mais sous l’emprise magique de l’écran qui s’illumine. Le cinéma muet restera donc longtemps le prolongement de la scène théâtrale où les comédiens déploient toutes les mimiques et les mouvements du corps souvent proches de la caricature. C’est ainsi que seront réalisés quelques chefs-d’œuvre du cinéma muet tels que L’Étroit Mousquetaire ou Sept ans de malheur de Max Linder, lui-même acteur de théâtre.
Par ailleurs, le fameux Voyage dans la Lune de Georges Méliès, réalisé en 1902, nous apporte toute sa fraîcheur et « son clin d’œil » dans une virevoltante magie qui distrait le spectateur de l’époque et vient rejoindre son engouement pour la comédie féérique. C’est aussi ce qu’on trouvait déjà en 1875 dans l’œuvre musicale à succès Voyage dans la Lune de Jacques Offenbach qui offrait aux mélomanes fraîcheur et insouciance. Cependant, derrière la face hilare du clown, le désespoir n’est jamais très loin. Charlie Chaplin l’a merveilleusement compris dans ses différentes œuvres. Passé entre les mains de Mack Sennett il inventa Charlot. Personnage hors norme qui passe de l’auguste au clown blanc, du bouffon au pathétique. C’est ainsi que l’on découvre Le Kid (1921) et surtout Les Lumières de la ville (1931), chef d’œuvre du réalisateur qui porte d’ailleurs le sous-titre révélateur de Comedy romance et nous fait passer constamment du rire aux larmes, du comique le plus pur au mélodrame le plus sombre et par là même, illustre cette phrase de l’auteur lui-même : « Le bonheur parfait est quelque chose de très proche de la tristesse ». Tout l’art du cinéma est là. Du bonheur va naître la tristesse et vice versa.
Le cinéma est le reflet de nos émotions humaines. Il nous renvoie à ce que nous sommes, à ce que nous éprouvons. Nous attendons d’ailleurs qu’il nous donne du bonheur en sachant qu’à tout moment, ce sentiment fragile et inconstant peut disparaître pour nous abandonner au plus grand désespoir.
Filmer la comédie du bonheur ou le drame existentiel ?
« Le bonheur est la chose la plus simple mais beaucoup s’échinent à la transformer en travaux forcés » disait François Truffaut. De nombreux réalisateurs ont essayé de définir le bonheur au cinéma, mais ce sentiment ineffable reste difficile à appréhender. Agnès Varda en réalisant Le Bonheur (1965) nous montre toute la difficulté de conserver pour toujours cette notion si fugace qui nous échappe au moment même où nous croyons l’apprivoiser. Et ici la réalisatrice rejoint Jean Renoir dans son film Partie de campagne (1936), pamphlet prophétique sur le bonheur à venir et avec lequel elle partage une certaine vision du bonheur naturaliste.

Sylvia Bataille dans Partie de campagne réalisé par Jean Renoir (1936).
Cependant, l’idée même du bonheur est très vite occultée par le fait que le personnage central choisit un chemin qui va le conduire vers l’amertume ou pire encore le malheur. Cela porte un nom : comédie dramatique. Et pourtant, l’un des plus beaux exemples de cette insouciance et d’une certaine drôlerie désinvolte revisitées, a été porté à l’écran par Jean-Luc Godard dans son film culte À bout de souffle (1960) qui rompt une fois pour toutes avec un cinéma étiqueté « comédie dramatique ». Le bonheur n’est donc au cinéma qu’une façon détournée de montrer l’envers du décor, c’est-à-dire le drame qui couve sous l’apparente joie pour nous montrer combien les genres se mélangent. C’est ainsi que le personnage central Michel Poiccard interprété par Jean-Paul Belmondo croit vivre à toute allure une parenthèse enchantée. Il va passer du plaisir de la désinvolture à l’inquiétude la plus noire. Rien n’est donc défini, le bonheur qui paraissait à portée de main voit naître aussitôt le drame et l’angoisse. Et le spectateur, qui a cru avec lui que sa romance folle avec Patricia Franchini interprétée par Jean Seberg pouvait donner droit un instant au bonheur, comprend que ce n’est qu’un leurre, une illusion, une utopie même. Car le crime préexiste et il ne pourra éviter la tragédie. Est-ce à dire que le cinéma ne nous donne qu’une vision parcellaire du bonheur ? Que le bonheur n’est qu’une illusion, une image éphémère de l’Eden ? Certainement lorsqu’on se plonge dans quelques films cultes comme Lola Montès (1955) de Max Ophüls où l’héroïne aspire à vivre un instant de bonheur mais ne peut échapper à un espace temps qui la rattrape et la ramène au monde factice qui l’entoure. C’est aussi le cas de nombreux films américains des années cinquante qui portaient à l’écran l’American way of life comme la seule voie qui donnait droit au bonheur. Le film de Douglas Sirk Mirages de la vie (1955) illustre cette philosophie en montrant avec éclat tous les artifices de la félicité. Les personnages féminins incarnés par Lana Turner et Juanita Moore aspirent pour l’une à la gloire, et l’autre à l’amour de sa fille, mais le mélodrame les rattrape et la chanson du générique nous dit en conclusion : « Sans amour tu vis seulement une imitation de la vie ».

West Side Story réalisé par Robert Wise et Jerome Robbins (1961).
Enfin, il nous faut parler aussi du genre de la comédie pure voire la comédie musicale. Celles qui nous montrent dans des mises en scène relevées, colorées, tonitruantes parfois, que la vie peut être joie de vivre et bonheur complet. Mais voilà que là aussi les masques tombent. Derrière ces scènes de rire et d’insouciance il y a tellement de douleur. Vincente Minnelli, Georges Cukor ou encore Billy Wilder en ont été les représentants les plus importants dans le cinéma américain des années cinquante. Il nous faut alors nous arrêter un instant sur l’actrice emblématique de cette époque et dire combien Marilyn Monroe en a été le phare. C’est l’actrice du bonheur projeté sur l’écran, la femme magnifiée dans des films comme Certains l’aiment chaud (1959) où Billy Wilder sature son film de moments hilarants, de scènes comiques à pleurer. Mais voilà, derrière cette image de la femme flamboyante il y a la détresse, l’image d’un bonheur inaccessible, le drame d’une vie fantasmée et à jamais perdue. Marilyn restera pour nous associée à un cinéma hollywoodien faussement heureux mais qui cachait des drames humains impossibles à représenter sur les écrans de cette époque. Et s’il faut enfin évoquer la comédie musicale le film West Side Story (1961) de Robert Wise et Jerome Robbins en est certainement la meilleure représentation puisqu’il mélange des chorégraphies réglées au millimètre sur la musique fastueuse et enlevée de Leonard Bernstein, une bande son qui nous transporte de joie tout en dénonçant les rejets les plus violents de l’Amérique des années cinquante, la noirceur des rapports humains. C’est alors que la comédie musicale se transforme en drame lyrique.
Filmer le bonheur collectif ou le bonheur individuel ?
À l’instar du roman d’Aldous Huxley, Le Meilleur des mondes, qui prône le bonheur total après la catastrophe, les régimes totalitaires ont érigé leur philosophie en humanisme anthropocentrique. L’homme au milieu de tout. Mais surtout il s’agit de standardiser l’être humain de lui proposer une société heureuse qui vit dans le bonheur et la paix. Il faut construire un pays neuf qui va vers le progrès, la modernité et l’élan patriotique. Le cinéma soviétique va s’emparer de cela pour mettre en scène ces différentes thématiques. D’ailleurs Lénine a déclaré : « Le cinéma est pour nous, de tous les arts, le plus important ». C’est alors que le cinéma de propagande est né et va servir d’arme formidable au régime soviétique. Ainsi voit-on fleurir de très nombreux films dès le début de la révolution russe. C’est le cas du film Octobre de Sergueï Eisenstein (1927) où le héros soldat magnifie le sentiment patriotique. Cependant, quelques autres œuvres réalisées une décennie plus tard sous Staline tel Le Bonheur (1935) du réalisateur Alexandre Medvedkine se penchent sur la condition paysanne en échappant au diktat des studios soviétiques pour nous montrer un petit peuple heureux. Medvedkine dit d’ailleurs : « Le cinéma est un formidable outil de réflexion et d’apprentissage pour améliorer le présent et imaginer le futur ». Mais l’envers du décor est là et nous dit combien ces paysans apparemment heureux vivent par ailleurs la tragédie d’un communisme dur et violent.
Depuis longtemps et encore récemment le cinéma italien s’est attaché à traiter du bonheur collectif dans la comédie des années cinquante à soixante-dix. Souvent doux-amers, ces films naviguaient entre le goût du bonheur simple et la tragi-comédie individuelle On se souvient de certaines grandes comédies politiquement incorrectes qui utilisaient l’ironie et la farce mais laissaient percer aussi l’amertume toujours avec bonne humeur. C’est alors qu’apparaissent de grands comédiens tels Totò, Alberto Sordi ou Vittorio Gassman qui vont créer des « types » de personnages universels, veules mais attachants dans lesquels le public va très vite s’identifier.
C’est par exemple le cas dans le film Le Pigeon (1958) de Mario Monicelli On assiste alors à la naissance d’un cinéma qui veut réagir au sacro-saint néoréalisme social bien trop noir des années précédentes. Il s’agit de rassembler autour d’une vision du monde plus heureuse. Et si la comédie italienne a vécu, il existe encore aujourd’hui des auteurs tels les frères Vittorio et Paolo Taviani pour réunir bonheur collectif et bonheur individuel dans une œuvre riche et en particulier dans leur dernier opus Contes italiens (Meraviglioso Boccaccio) situé dans la Florence du XIVe siècle qui reste un plaidoyer pour la jeunesse mais aussi une quête du bonheur à la fois collectif et individuel.
Le cinéma a exploré toutes les facettes du bonheur, a créé des moments que nous nommons rire, plaisir, douceur, évasion, oubli de soi. Nous nous installons alors devant l’écran pour y trouver un moment de joie et de béatitude. Et en même temps il nous entraîne bien souvent derrière la toile pour nous en montrer les limites, l’envers du décor.
Image à la Une © Charlie Chaplin et Jackie Coogan dans Le Kid réalisé par Charlie Chaplin (1921).