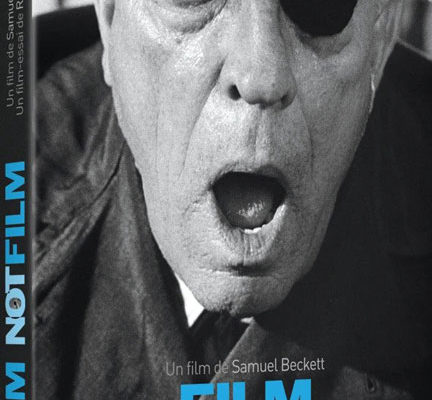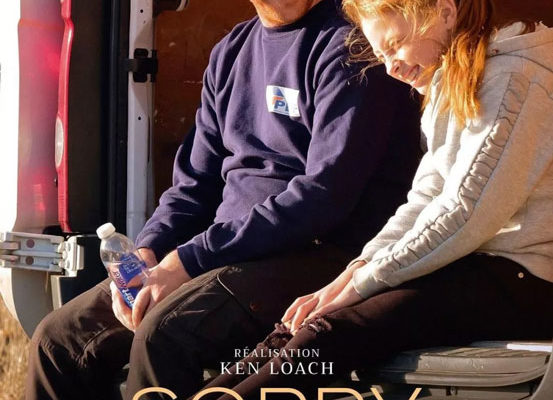« Je n’ai pas plusieurs identités, j’en ai une seule, faite de tous les éléments qui l’ont façonnée, selon un dosage particulier qui n’est jamais le même d’une personne à l’autre » – Amin Maalouf.
Tout en construisant sa propre identité, le cinéma nous a montré et nous montre encore toutes les diversités qu’elles soient culturelles, ethniques ou physiques voire professionnelles afin que chacun de nous puisse s’y reconnaître. Il nous les restitue comme le ferait un miroir pour nous révéler ce que nous sommes mais aussi ce que nous voudrions être. Mais le regard du cinéma est porté par celui qui filme, il est donc avant tout une forme de représentation des lieux et des personnes sur lesquels se porte ce regard.
Une originalité identitaire.
Le média cinématographique possède en lui sa propre identité. Il se reconnaît à ses codes : sa grammaire, son langage, son rythme (24 images/seconde), sa construction, ses genres, ses emblèmes. Ainsi lorsqu’apparaît sur l’écran aujourd’hui encore le lion rugissant de la Metro-Goldwyn-Mayer, nous savons que nous allons entrer dans un film américain de la même façon que le coq de Pathé nous disait que nous allions visionner un film français. La projection du générique nous dit aussi que l’on est au cinéma, elle nous donne des références, induit le genre, identifie les lieux. Par ailleurs, lorsque les plans ou les séquences s’enchaînent et que le film se déroule sous nos yeux, nous savons où nous sommes et ce que nous voyons, portés par la musique et les images. Ainsi une musique d’Ennio Morricone se reconnaît instantanément et de plus, si nous avons sous les yeux quelques cow-boys armés de pistolets, des chevaux et un décor de rue vide, le film sera forcément un western.

Le cinéma, parce qu’il est depuis longtemps présent dans nos esprits, qu’il y a laissé des empreintes indélébiles, est un art mémoriel qui sait (re)construire les identités depuis ses débuts. C’est d’abord un cinéma très national voire régional. Lorsque les frères Lumière filment La Sortie de l’usine Lumière à Lyon (1895) ou encore L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat (1896), ils ne filment pas par hasard ces lieux géographiques mais les mettent en scène dans un contexte régional mais également social. Ce sont des lieux où ils vivent et qu’ils connaissent parfaitement. Ils montrent une réalité et l’identifient à travers des mouvements de caméra, des personnages qui nous parlent encore aujourd’hui même s’ils datent de plus de cent ans.
Le cinéma est toujours le reflet d’une culture. Il a une identité nationale reconnaissable dès les premiers plans. Le cinéma indien et ses films Bollywood à la mise en scène kitsch et élaborée, le cinéma de l’Union soviétique où Sergueï Eisenstein transcendait l’histoire de son pays ou encore les films français pétris d’humanité et de passions individuelles. Il existe donc autant de pays que de cinématographies, autant d’auteurs que de genres de films, autant de personnages complexes et c’est cette richesse que le 7e art nous restitue sur les écrans comme des miroirs de nos propres identités.
D’une identité à une identification.
L’illusion est dans l’ADN du cinéma. Le changement identitaire des personnages hante bon nombre de films et souvent ce que nous croyons voir et que les personnages croient découvrir entre eux n’est aussi qu’un leurre. La Sirène du Mississipi (1969), réalisé par François Truffaut, en est l’un des exemples les plus représentatifs. Il débute par une tromperie sur l’identité de l’héroïne. Louis attend Julie à l’arrivée du bateau. En fait, l’héroïne s’appelle Marion mais peu importe car comme le déclarait le réalisateur : « La Sirène, c’est finalement l’histoire d’un type qui épouse une femme qui est exactement le contraire de ce qu’il voulait. Mais l’amour est apparu et il l’accepte telle qu’elle est ». Et nous, spectateurs, croyons à cette illusion, nous nous identifions aux personnages, nous acceptons cette tromperie parce qu’elle est le reflet même de nos propres vies. Le personnage cinématographique est lui-même une création qui sort du cerveau de son créateur qu’il a parfois transformé mais qui reste souvent son double. C’est le cas, une fois de plus, chez François Truffaut et son alter ego Antoine Doinel dans Les Quatre Cents Coups (1959) et cela peut aller jusqu’à ce que le visage du réalisateur se confonde avec celui de l’acteur. C’est ainsi que depuis Les Lumières de la ville (1931) jusqu’au Dictateur (1940) Charlie Chaplin joue lui-même son propre rôle mais joue aussi avec les sosies qui lui ont permis de poursuivre sur la voie de l’opposition entre cinéma muet et cinéma parlant.
Le cinéma est par ailleurs une représentation, un spectacle d’identification et en même temps de projection d’ailleurs souvent influencé par la psychanalyse. Il projette ce qu’il y a en nous de plus mystérieux et de plus profond qu’il s’agisse du spectateur ou du réalisateur. Il a même quelque chose à voir avec une forme de voyeurisme, une pulsion qui prend l’autre comme objet. C’est pour cela que le spectateur se retrouve bien souvent au milieu d’une confusion intellectuelle prise entre le fantasme et la réalité. Le cinéma joue alors le rôle d’un miroir qui nous manipule entre notre propre identité et celle du personnage projeté sur l’écran. Et c’est ce jeu narcissique que nous propose justement Alfred Hitchcock dans nombre de ses films mais particulièrement dans son chef d’œuvre Psychose (1960). Nous avons là un concentré de toutes les obsessions du maître de l’épouvante : alliance du désir et de la culpabilité, double maléfique, mère toute puissante. Et ce que nous croyons voir nous entraîne dans un trouble dont nous ne sortons pas intacts. Lorsque nous suivons Marion l’héroïne dans Bates Motel nous nous identifions à elle, nous entendons la voix de la mère de Norman morte sur les lèvres de son fils qui la fait revivre. L’illusion est alors totale. Mais au-delà du trouble, c’est la peur qu’Hitchcock instille progressivement dans notre cerveau dont l’acmé intervient avec la scène anthologique de la douche quand apparaît une forme féminine que l’on croit être la mère de Norman et qui poignarde Marion. Mais en la lacérant, c’est l’écran même qu’il lacère pour atteindre le spectateur.
À l’instar de la psyché, le cinéma reste donc un jeu de miroirs qui se superposent y mêlant les différentes identités, parfois fantasmées, à la fois celles des personnages, du réalisateur et des spectateurs. Il est l’art de l’identification par excellence. Aucun art, autre que lui, ne permet une telle force d’identification. C’est l’image qui définit un rapport de l’homme au monde qui est aussi un rapport à soi.
Une mémoire collective.
Le cinéma permet aussi la transmission d’une mémoire collective. Il représente à la fois le temps présent et le temps passé. Il est un véritable kaléidoscope de nos existences. Cependant, c’est d’abord par une mémoire individuelle qu’il va s’exprimer : celle du créateur qui va puiser dans nos sociétés et dans nos vies la substance de ses œuvres cinématographiques pour nous en restituer les moments tragiques ou heureux et c’est cette dimension universelle qui crée à partir de chaque protagoniste un type de personnage.
Le cinéma italien des années 50 en est certainement le représentant le plus fidèle. Le néoréalisme porte en lui toute la dimension introspective et existentielle de nos vies. Il s’inscrit totalement dans la situation socioculturelle de l’Italie de cette époque. De Vittorio De Sica avec Le voleur de bicyclette (1948) jusqu’à Federico Fellini avec La strada (1954), le cinéma italien nous offre une représentation à la fois objective parce qu’il s’ancre dans le vécu et subjective parce qu’il transfigure nos identifications. Nous voyons donc projeté sur l’écran ce que nous sommes ou ce que nous pourrions être et nous passons ainsi d’une représentation individuelle à une représentation collective voire universelle. Le cinéma est un art des foules qui s’est construit pour donner du plaisir au plus grand nombre. Il lui faut donc prendre en compte toute notre diversité humaine qu’elle soit sociale, ethnique, culturelle ou politique.
Lorsque nous entrons dans une salle de cinéma nous avons, caché au fond de nous, le désir de nous identifier à ce qui nous sera proposé à l’écran, et bien que nous formions des publics de plus en plus différents, spécifiques, nous avons envie d’entrer en empathie avec les protagonistes qui nous sont proposés. Ainsi, lorsque Spike Lee nous propose son dernier opus BlacKkKlansman (2018), il le fait en renouvelant la représentation de la communauté noire aux États-Unis et il va bien au-delà de cette communauté en repoussant dans les ultimes retranchements de la farce tous les curseurs de la problématique identitaire. Il rejoint alors la comédie policière, le buddy movie, la satire sociale auxquels nous adhérons et auxquels nous nous identifions.

Depuis longtemps le cinéma joue également avec tous les signes de l’identité sexuelle : hétérosexuel, lesbien, gay, transgenre, queer ou intersexe, il ouvre et élargit notre champ de vision, il lutte contre l’ostracisme pour nous montrer la richesse des minorités sexuelles, le but étant de redéfinir les frontières entre le masculin et le féminin et dire qu’il existe entre les deux un continuum avec une infinité de possibilités. De nombreux films ces dernières années ont abordé la thématique de l’orientation sexuelle et contribué à changer les mentalités. Ce fut le cas avec Tomboy (2011) de Céline Sciamma qui traitait d’une manière subtile la recherche de l’identité sexuelle chez une préadolescente et dans le film très émouvant de Xavier Dolan Laurence Anyways (2012) où un homme marié découvrait peu à peu son goût pour le travestissement et son désir de devenir femme. Enfin plus près de nous encore, la quête identitaire a trouvé en 2018 une de ses plus grandes réussites avec le film Girl de Lukas Dhont qui suit la transformation organique et la lutte d’un jeune danseur pour devenir fille. Le cinéma a donc besoin d’une identité collective liée à une remise en cause des références du passé et de celles à venir. Il est un puissant révélateur des tendances parcourant la société de même qu’un outil de transformation et de questionnements politiques et sociaux. C’est aussi un discours, un récit sur l’identité, un moyen de projection de l’identité collective.

Enfin, le cinéma est le domaine de l’imaginaire et de spectacle imaginaire, le cinéma a vite fait de dériver en spectacle d’identification. Ce n’est pas pour rien qu’un film s’appelle une projection, c’est lié à quelque chose de fondamental et d’archaïque pour tout un chacun.
Image à la Une © Tomboy réalisé par Céline Sciamma (2011) © Pyramide Distribution.