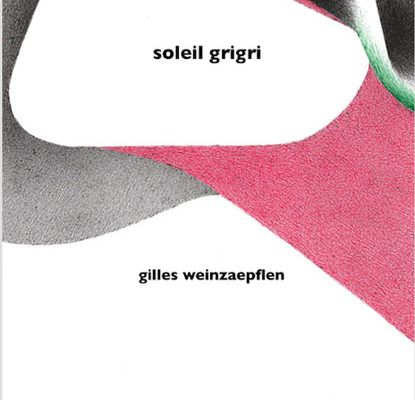Les distances s’étirent devant moi, creusent l’horizon immobile veiné de lambeaux de sable et de poussière ; des lambeaux de chairs ocres. La chaleur est étouffante. Cela ne présage rien de bon pour notre cargaison. J’essaie de distinguer cette odeur typique d’amande mais ne sens rien, et rabats alors mon attention sur le paysage morne qui passe dans l’encadrement de la fenêtre laissée entrouverte. De chaque côté de la route – étendue comme un serpent mort derrière la saleté du pare-brise – des rocs solitaires et quelques arbustes rachitiques tournent leur silhouette vers le ciel brûlé. Rien ne semble pouvoir vivre ici, et je fixe depuis plusieurs heures un point imaginaire, un point de fuite où les perspectives se confondent, où l’asphalte seul semble respirer. Il se tord, se fond et s’évapore en un mirage huileux, planant à la manière d’un spectre sur ce paysage désertique. L’espace. Des étendues infranchissables, brunes, des miles à parcourir. Le temps. Des heures immobiles, silencieuses, scellées par les rayons mortels du soleil. L’espace, puis le temps. Tous ces repères physiques que je cherche, ces représentations, ces calculs, et toutes les autres mesures censées me donner un indice, m’éclairer de leur vérité quantique ; le désert s’en moque. Tout ces repères s’estompent et l’impression d’évoluer sur un tapis roulant immuable persiste dans mes chairs. Nous pourrions aussi bien être ici, roulant dans la veille Plymouth Duster 1972, en plein Kansas, ou au beau milieu d’un cratère, dérivant telles des ombres à la surface de la lune. La voiture s’ébranle, cahote sur une aspérité du bitume et mes lunettes de soleil posées sur le tableau de bord glissent sur le sol. L’intérieur est en cuir souple, teinte verte métallisée, ou plutôt « Amber Sherwood », comme le stipulait la plaquette du concessionnaire. La sellerie et la carrosserie assorties donnent au véhicule l’allure d’un insecte à la carapace luisante, avalant la distance qui nous sépare d’Oklahoma City à la manière d’un animal vorace. Nous roulons depuis l’aube, départ Philadelphie, une brève halte au niveau de Colombus et voilà maintenant près de dix-sept heures que nous errons à travers les États-Unis. La tempête annoncée n’est finalement pas venue. J’aurais dû louer une décapotable. Il nous reste encore trois heures, deux-cent sept miles à parcourir avant d’atteindre l’Americas Value Hôtel, notre point de chute. Une suite nous attend là-bas. Ce sera mon dernier congrès, le dernier rassemblement avant notre aller simple pour Jonestown en Guyane.
Morgantown, Pakersburg, Dayton, Richmond, Greenwood, St Louis… Les noms des villes que nous avons traversées défilent dans mon esprit, se superposent, s’entrecroisent, s’impriment comme le fantôme d’une carte trop manipulée sur ma rétine, alors que je me plonge dans l’examen circonspect de mon reflet sur la vitre. Je connais ce visage par cœur, dans ses moindres recoins, dans ses moindres défauts. Les joues bouffantes, le front large, le menton fuyant, les arcades proéminentes et presque vides sous des sourcils blonds, transparents. Est-ce vraiment mon visage que je contemple, ou bien celui que les autres attendent ? Ce visage aux airs de prêcheur presbytérien, celui que mes disciples adulent, glorifient de manière aveugle. Ne leur ai-je pas déjà tout donné ? Ma voix, mes pensées, mes livres, ma vie. Ce visage ne m’appartient plus, ils se le sont approprié. Bien sûr, je les ai laissé faire. Je souris malgré moi à la vitre qui me renvoie l’image d’un homme fatigué, la peau dure, striée de rides comme celle d’un cuir tanné. Je me concentre et souris de nouveau. Voilà, je peux encore le faire, c’est ce masque que je dois porter. Bien plus accablant que ces séminaires, que ces voyages aux quatre coins du monde, plus pesant encore que ne l’est ma responsabilité de Père, que les regards embués d’admiration et d’espoir qui se posent sur moi, c’est ce masque qui me pèse, qui résonne au fond de moi et se transforme en une matière dure, tangible, qui m’entraîne avec elle au fond de ma vie intérieure. Je m’enfonce dans cette trappe et quand je regarde en haut, je ne vois aucune raison de remonter.
Il y a vingt ans, peut-être même dix, tout cela avait encore un sens ; mon œuvre, mon Église, mes prophètes. Mais désormais, enfermé dans cette boîte de métal louée à un prix exorbitant, expression banale et mortelle du désir matériel d’un vieil homme sur le déclin, je me sens terne, désillusionné par mes propres rêves. Des rêves j’en avais pourtant, et des grands. Construire, fédérer, inspirer. Je ne peux pas dire que je sois passé à côté, j’ai accompli beaucoup de choses, bien plus que la plupart des hommes. Mais aujourd’hui, alors que nous filons sur les routes d’un rêve plus ancien, sur ces routes immenses et sèches qui suggèrent l’infini, l’éternel, je perçois mon propre aboutissement, l’inéluctable contrainte de mon chemin, et je sais désormais que les jours qu’il me reste me condamnent à vivre en deçà de ce que j’ai été. Les instants de joie, de bonheur extatique que j’ai vécus se sont dissipés dans mon fluide cérébral, estompés par des années d’efforts, de travail, qui m’empêchent aujourd’hui de les considérer à leur juste valeur, de les ressentir autrement que comme quelque chose d’extérieur à moi-même. Je les sens pourtant réels, égarés quelque part dans la brume de mes souvenirs, lueurs vacillantes d’un phare que l’on distingue au loin, là-bas, sur le rivage. Je suis sur la proue d’un navire fantôme, un bâtiment imposant, glorieux, souverain même, mais dont la coque se fissure doucement et se laisse submerger par des vagues d’amertume. Je ne coule pas, je m’enlise. C’est la poussière de ce désert qui s’infiltre, une gangrène sèche et infertile. Mon regard glisse sur le montant de la portière, sur la vitre jaunie, il marche comme un vagabond lesté par le doute sur la surface bombée des compteurs ; nous roulons à un peu plus de cent-quarante kilomètres heure. Il continue son chemin et s’arrête quelques secondes sur les mains qui serrent convulsivement le volant, les mains blanches et fines de ma femme. Il ne s’attarde pas sur son cas, cela n’a plus aucun sens, plus aucun lien avec le réel. La réalité échappe d’ailleurs à ce balayage méthodique, presque mécanique, que mes yeux exercent sur l’environnement. Je ne vois pas les montagnes bleues et rondes qui se dessinent sur l’horizon, je ne vois pas le panneau en métal rouillé qui nous indique l’entrée de Baxter Springs, je ne vois pas le visage d’Élisabeth qui se tourne vers moi, un visage lui aussi usé, abîmé, reflet d’une beauté maintenant disparue. Ne s’apercevoir de rien. Être muré dans un carcan d’angoisse qui agit comme un écran opaque face à la certitude physique des choses. Oui, les existences peuvent parfois s’asphyxier, se résorber sur elles-mêmes, c’est du moins ce qu’il s’est passé pour moi. Il n’en fut pas toujours ainsi. Je me rappelle qu’à l’époque, du temps où je jaugeais d’un œil enthousiaste ce que l’avenir me promettait, l’allégresse pouvait éclore dans mon cœur avec la rapidité d’un bourgeon baigné par les premiers rayons chauds de printemps. Ces rayons étaient pourtant minces, des caresses fébriles et mirifiques de possibilités, vapeurs inconsistantes d’espoir, de projets balbutiants qui se muaient en un éclair – et par ma seule volonté de projection – en incendies créateurs. Quelque chose de flamboyant. Lorsque l’on me demandait ce à quoi je voulais devenir, je répondais : le monde. Il suffisait en réalité que j’imagine un moment heureux. Moins qu’une promesse, il suffisait que l’impalpable prophétie de l’existence murmure les bons mots à mon cœur pour balayer les angoisses que l’impossibilité faisait naître. Une nouvelle rencontre, un nouveau disciple, une maîtresse, à peine le contour d’une idée. J’y croyais ardemment, je parvenais à être heureux, comme un amoureux qui espère voir prochainement son élue, même si c’est encore trop tôt, même si ça ne durera pas. Je me complaisais dans l’espérance, dans une espérance sourde et aveugle, privée de sens, et, bien entendu, comme je le constate aujourd’hui un peu trop tardivement, cela a fini par asphyxier mon existence.
La suffocation des sens. Elle semble se propager dans l’habitacle, se fondre avec cette tiédeur étouffante qui nous poursuit depuis près de dix-huit heures. Sursauts de torpeur, bruits creux d’hésitation, la Plymouth Duster commence elle aussi à s’encombrer et émet quelques crissements plaintifs. « Nous sommes en plein milieu du désert, nous allons bientôt tomber en panne d’essence » me fait alors remarquer Élisabeth d’une voix lointaine. Cette phrase me réveille un peu et je me redresse difficilement, abandonnant avec une certaine réticence la saleté de la vitre sur la surface de laquelle mes réflexions post-existentielles se projetaient ; une salissure dans laquelle se confondait si bien mon âme. Nous traversons des rues vides, balayés par un vent fait de souffre et de microscopiques grains de silice virevoltant, acérés. Le balai brunâtre, quasi inconsistant que provoque le passage de la voiture, insuffle à ces lames de rasoirs invisibles un mouvement organique, une valse avide de chairs qui se déchaîne dans notre sillage. Ce vent corrosif semble d’ailleurs racler le paysage, éroder les façades des maisons jaunes et grises, rouges et blanches, grandes et abandonnées, et façonne ainsi depuis des années la silhouette de cette ville fantôme, délaissée de toute vie, comme autant de carcasses évidées que laissa derrière elle la dévastatrice Ruée vers l’Or. Ce vent, ce souffle brûlant je le sais, je le ressens, aimerait ronger notre viande. Après plusieurs aller-retours dans ces rues désertes, nous tombons enfin sur un panneau indiquant la seule station-service de Baxter Springs, à la sortie de la ville. Agonisante, la voiture finit sa course à quelques mètres de la station, et je suis obligé de sortir pour pousser le monstre rutilant jusqu’aux bornes d’essence. Élisabeth souhaite acheter quelque chose à manger. Elle est épuisée me souffle-t-elle. Une main sur la poignée de la porte côté passager, je me propose de la relayer et de faire le plein. « Non, non, chéri. Tu dois te reposer, tu as une journée importante demain, la plus importante de ta… vie », finit-elle par articuler hésitante. « Je t’en prie, fais-moi plaisir, repose-toi », déclare-t-elle enfin avec plus d’assurance, son dévouement faisant vibrer de manière touchante le timbre cristallin de sa voix. Je hausse les épaules et m’enfonce dans le siège ; après tout, elle me suit depuis mes débuts, elle me pardonne tout et me protège des autres. Élisabeth était le bouclier dont tout homme de pouvoir a besoin. Un rempart froid et dur, dressé contre un monde qui me rejette désormais, elle essaie tant bien que mal de me préserver, de me préserver de moi-même.
Les muscles endoloris par ce long voyage, le ventre nauséeux, je cale de nouveau ma tête contre la vitre et essaie de faire le vide. Ce n’est pas difficile en fin de compte ; l’obscurité dans laquelle ma conscience s’est plongée en ressassant ainsi mes souvenirs, en faisant ressurgir à la manière d’un remous fétide les quelques résidus de doute et de peur qui subsistaient à la surface de mon esprit – comme ces introspections morbides et dégradantes que j’impose aux novices souhaitant rejoindre l’ordre – est finalement parvenue à m’anesthésier. Ivre de moi-même, je me laisse alors absorber sans grande difficulté dans la contemplation sans objet du goudron surchauffé. Il s’étale grassement de la portière jusqu’à la vitrine assombrie de la boutique où, telle une ombre bienveillante, Elisabeth choisit avec soin, selon mes goûts, les substances nutritives censées alléger mes peines. Son lointain mirage rassurant est alors brisé par le capot rouge d’une berline se garant à mes côtés. C’est la première voiture habitée par des êtres vivants que nous croisons depuis notre arrivée cahoteuse dans cette ville. Le chauffeur – un homme corpulent affublé d’un chapeau de cow-boy ridicule et portant d’une manière non moins grotesque une énorme moustache blonde tombante – sort de la voiture et déplace paresseusement son gros corps adipeux hors de mon champ de vision. C’est à cet instant que je la vois apparaître. Je ne vois d’abord qu’un mouvement, un flou charnel qui bouge. Puis ce mouvement se transforme en silhouette, cette silhouette en jambes fines et bronzées, ces jambes en une portion souple de corps battant la mesure d’une musique que je n’entends pas. Un pied, voluptueusement cambré, expose au soleil des orteils malmenés, un peu sales, où subsiste encore l’écaille d’un vernis rouge depuis longtemps émaillé. La cheville est souple, remue en décrivant de rapides arcs de cercle dans l’air. La malléole gauche que j’aperçois à travers la vitre roule gracieusement sous une peau élastique, parfaite. Le mollet se contracte, se relâche, et c’est toute la partie basse d’un corps incomplet qui se met à frémir, par secousses d’abord, puis par élans sismiques, suivant cet air inaudible que j’essaie de fredonner. Un mini-short en jean effilé s’inscrit dans le contour gauche de la portière, encercle comme un gant d’azur les jambes de la fillette assise dans l’autre voiture. Je lui donne dix, peut-être douze ans. De la transpiration se condense sous le pli inférieur de son genou, quelques gouttelettes seulement, un fluide à l’odeur saline, saveur de l’enfant infini que je sens presque, que je goûte bientôt dans le miasme de ma salive écumante. Je sens maintenant le parfum frais de son haleine, je perçois le bruit du tissu bleu qui s’enfonce dans l’ombre de ses cuisses, je sens la tiédeur de son sexe plus bas, plus ardent que ne l’a jamais été mon existence. Et ces jambes qui continuent de danser la valse silencieuse, cette rumeur qui s’élève, qui s’emporte, m’emporte avec elle dans l’aube d’un destin qui me survivra. Je fixe comme un damné le chant muet de ces membres bruns, courts et nonchalamment prostrés sur le tableau de bord poussiéreux. Je contemple l’avenir, la perdition de ma race, je vois le réel surgir, bien vivant dans ce décor d’apocalypse. Je vois tout. Plus de temps, plus d’espace, simplement le réel qui se présente à moi sous sa forme la plus belle ; cruelle indolence du désir, du désir de vivre, encore un peu, loin de cette merde que l’on nomme existence. Voilà, c’est fait, je crois que je bande. C’est un sang nouveau qui irrigue les tissus spongieux de mon corps, un corps qui va bientôt disparaître. Ma main se crispe sur mon sexe, s’agrippe à la portière et je suis prêt à m’enfuir, à m’évanouir au sein de cette promesse palpitante. Je plaque mon crâne contre la vitre, mes globes oculaires sortent de leurs orbites, épousent chaque contour, chaque forme, chaque vibration. Je suis prêt maintenant, je peux encore succomber au pardon. Le pardon de ton corps, l’absolution de ton être, la promesse d’une ère nouvelle, comme celle que j’imaginais avant, bien des années avant ta naissance. Le pardon encore, ou bien la sentence de tes yeux noirs. Des yeux noirs qui apparaissent subitement devant moi. Ils me scrutent, surpris, jeunes, beaux, essentiels. Ils me scrutent et comprennent brusquement, avant de disparaître et de figer mortellement ma réalité. Je ne vois plus rien. Immobilité de ma main, suspension de mon cœur, gel subitement glacial et distant de la danse. La voiture démarre, s’éloigne et laisse un vide entre moi et le goudron, toujours bouillant, toujours graisseux. L’épilogue de ma vie qui file entre mes doigts humides, mes phalanges blanchies qui se crispent dans l’air, qui ne saisissent rien, qui soupèsent ma désillusion et le poids de son vertige au creux de ma main.
Elisabeth n’est toujours pas réapparue, je n’esquisse aucun geste. Les dix kilos de cyanure de potassium stockés dans le coffre depuis le début de notre périple commencent à diffuser une odeur d’amande amère dans l’habitacle. C’était une erreur de faire ce voyage en voiture. Il ne faut pourtant pas laisser les erreurs anéantir le rêve. Ce que je m’apprête à faire est une simple correction. Je dois rectifier les trajectoires, la mienne surtout, et une centaine d’autres par la même occasion.
Je m’appelle Jim Jones ; pasteur, prêcheur hors pair, prestidigitateur du moi, père fondateur de l’Ordre du Temple du Peuple. Je m’appelle Jim Jones, je suis le créateur d’une société parfaite et en cette veille du 18 novembre 1978, je m’apprête à organiser le plus grand suicide collectif de l’Histoire. Je m’appelle Jim Jones, et j’aurais voulu épargner à cette enfant le souvenir de mon visage.