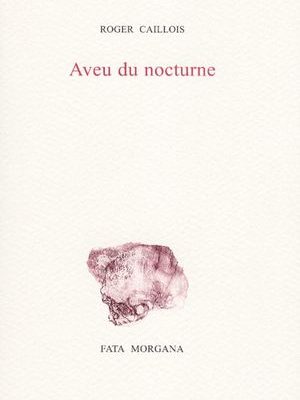Dimanche de pluie chez ma grand-mère maternelle qui s’est absentée. Je cherche une feuille afin de noter des pensées. Dans le secrétaire en bois de merisier, j’extirpe une lettre écrite en gros caractères d’enfant : « Madame Y., merci d’être venue dans notre école, nous expliquer ce que c’était que d’être juive pendant la guerre ». La colère me barre le front. Ma grand-mère a toujours refusé d’évoquer avec moi non seulement cette trouble période, mais aussi son héritage judaïque à tel point que son nom de jeune fille, aux consonances ashkénazes, ne m’avait été donné qu’une fois, par ma mère tremblante et chuchotante.
Je range le papier honteux, témoin de ma curiosité aussi bien que de mon ignorance. Des mois passent, je ne dis mot. Mais un jour, c’est trop gros, je n’en peux plus, je pose d’une voix calme ma demande. Peut-on enfin me parler ? Qui es-tu ? Je suis une femme qui a vécu la guerre, et le fait d’être juive n’a jamais fondé mon identité, seulement l’image d’une identité qui m’a faite souffrir.
Alors j’apprends : la rencontre de Mosheh — Moïse — et de Clara, tous deux juifs polonais exilés à Paris, à l’hôpital, leur amour raisonné, leur mariage serein, leurs deux filles bien élevées, le yiddish en déclin au profit du « bon français » au sein de la famille, la guerre, le nouvel exil, la peur, l’arrêt des études de ma grand-mère, l’usine, la peur, les départs éternels des uns, les au revoir douloureux, la peur, souvenirs encore flous dans le discours qui se veut prudent et modéré. Je ne t’ai rien dit parce que tu ne posais pas de questions. Si, j’en posais, mais pas assez.
Je reviens de cet entretien bouleversée par les histoires, j’ai envie de tout raconter, d’écrire un roman, non, un essai, non, un recueil. Par un étrange mystère, cette verve s’envole. Je n’en parle pas autour de moi et les souvenirs se tassent dans ma mémoire.
Nouvelle scène. Un soir de fête chez des amis philosophes. Rire, décoctions et élucubrations de théories fondamentales. Ma voix se perd dans la logorrhée collective, je n’ai pas grande part à tout cela car j’ai depuis longtemps laissé la philosophie à d’autres. J’écoute, ravie, bée, les quatre hommes présents se déchirer sur l’Être. La conversation dérive sur la puissance du peuple juif : l’un d’entre eux porte en lui une culpabilité quelque peu indécente, que personne ne réclamait, et qui le force à ramener chaque postulat à cela. Nous le savons, et cela nous intrigue tout autant que cela nous amuse. Ses arguments sont honnêtes — comme toujours — et le poussent à développer une longue pensée qui finit par mourir dans un silence. Et cela se produisit. Dans le secret de minuit, je ne sus rien dire d’autre que : « En fait, vous savez que je suis juive ? ». Et alors que jusque-là, la parole ne m’était donnée que par fragments, on me laisse le temps pour otage. J’étale la filiation par la mère, le nom de famille en -schneider, les différents exils. Tout se passe comme si cette judéité révélée donnait soudain de l’épaisseur à ma vie. Confidence ou tactique d’appropriation de l’espace masculin, je ne sais ce qui a conduit une telle révélation. On me harcèle de questions : « Et tu ne le savais pas avant ? », « Peux-tu être juive et athée ? », « Où est ta famille ? », « Que penses-tu d’Israël ? », « Dans quelle mesure Levinas a raison lorsqu’il énonce que… ? ». Je n’ai pas l’ENS mais je suis juive ! Lékhaim ! le grade est plus prestigieux encore dans ce monde d’intellectuels puisque le capital symbolique dépasse celui culturel.
En moi cependant, une tempête se joue : tout en ne voulant pas m’approprier ce qui ne m’appartient pas — soyons réalistes deux minutes, j’ai reçu un baptême bouddhique, mes parents sont divorcés, nous trempons le veau dans le lait et je ne connais même pas la durée de Hanouka —, j’utilise un passé fantasmé au profit d’une attention tournée vers moi.
L’acte, pourtant fondamentalement égoïste et révélateur d’une sorte d’étrange snobisme intellectuel, me paraît moins être un viatique à la mémoire religieuse qu’à celle historique. Tu sais, sur les monuments, ils en ont oublié tellement. Elle, elle n’est nulle part, lui non plus et elle encore moins. Je cherche parfois des traces, quand mon cœur n’est pas trop lourd. Mais la plupart du temps, je ne regarde pas, je ne veux pas. Je n’irai jamais à Auschwitz où ils ont disparu, je n’irai jamais en Israël car ce n’est pas mon foyer. On m’a arraché à tout ça et c’est tant mieux. Ma famille, maintenant, c’est L.O, je préfère encore la révolution à la préservation.
Les dures paroles m’atteignent. Je voudrais tout savoir, la questionner pendant des heures. Je voudrais parfois même, dans mes moments de doute, me convertir et me rapprocher de ces gens que je ne connaitrais jamais et dont il faut parler. Certes, la douleur de 39-45 est nourrie d’un imaginaire fécond mais ce n’est pas tant cela qui m’appelle. Je ne saurai encore le dire aujourd’hui alors, en attendant de comprendre ce qui se joue en moi, je compile les données et je rédige ici des pensées.
Image à la Une © Soleil d’automne par Egon Schiele (1912) © Leopold Museum, Vienne.