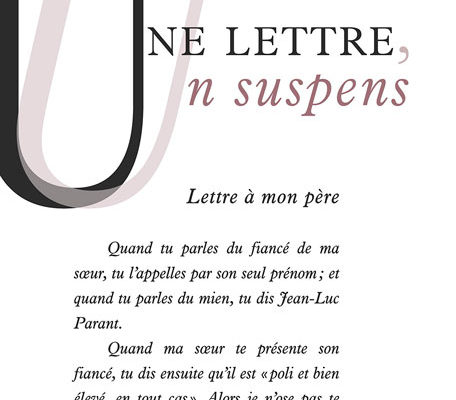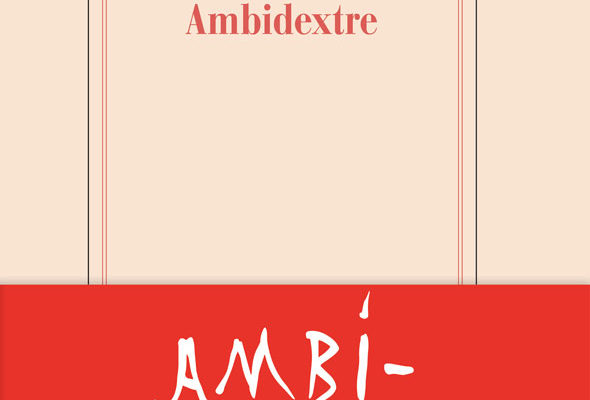Les clichés sur la beauté des langues ont la vie dure, parce qu’ils rassurent et rendent tabou la vraie question : comment parler beau ?
L’allemand est rugueux, réservé aux insultes et aux discours d’Hitler, l’italien et l’espagnol sont des langues chantantes, l’anglais sent la pluie tandis que le français est perçu, de l’étranger, comme une langue douce et paisible. Ce que l’on vit comme une évidence acoustique n’est pourtant qu’un a priori culturel forgé par des siècles de réception. Parce que sans aller jusqu’à reproduire l’expérience de Schrödinger, ce que l’on perçoit d’une langue est bien loin d’être ce qu’elle est, et dans le domaine esthétique la chose est encore moins certaine.
L’intuition des sons et leur connotation.
Sur la différenciation effective des langues se greffe une impressionnante quantité de connotations, dont certaines tiennent soi-disant à la langue elle-même, et d’autres à la culture qu’elle représente. Ainsi, la sensualité des langues italiennes ou espagnoles tient pour beaucoup à la symbolique du Sud, du soleil et de la Méditerranée. À l’opposé, les connotations d’agressivité que nombre de francophones perçoivent pour l’allemand tiennent principalement du vieux conflit qui oppose France et Prusse depuis les guerres de la fin du XIXème jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Dans chaque accent allemand que l’on moque, on se venge d’Hitler, et dans chaque accent italien qui nous séduit, c’est la chair et son plaisir qui nous parlent.
Ces facteurs culturels et psychanalytiques (vengeance, désir…) s’appuient sur de prétendues spécificités phonétiques : l’allemand serait empli de consonnes violentes, l’italien et l’espagnol seraient des langues chantantes parce que dotées d’un accent d’intensité sur chaque mot… Mais ces analyses ne tiennent pas : les consonnes de l’allemand ne peuvent être violentes que si on a décidé de les entendre ainsi ;
et si l’accent d’intensité de l’italien et de l’espagnol s’accompagne toujours d’une légère modification vers l’aigu de la hauteur de la voix, ça n’est en rien un chant. Et puis, la même caractéristique accentuelle se retrouve en français — non sur chaque mot mais, depuis la fin du Moyen Âge, sur chaque groupe syntaxique : la dernière syllabe en est légèrement plus forte et haute que les autres. Ainsi, le français, qui ne paraît pas particulièrement chantant aux francophones, est même doté d’une plus grande liberté mélodique que l’italien ou l’espagnol, dont l’accent est contraint par le mot — dans ces langues, chaque mot dispose d’un accent fixe, la plupart du temps sur son avant-dernière syllabe.
Ces clichés peuvent aussi être internes à la langue : dans certains cercles intellectuels, on prétend que c’est cette spécificité accentuelle qui est à l’origine de l’aptitude spécifique qu’aurait le français à la conversation. Comme si, parce que notre langue était plate — ce qui est faux, ses reliefs étant juste plus longs — on pouvait moins s’énerver et discuter plus calmement… Auto-diagnostic biaisé pour être flatteur, cette analyse ne prend sens que dans une visée nationaliste absurde : à chaque peuple sa langue, à chaque peuple sa beauté. Or le lien du peuple à la langue est une représentation, pas une réalité. Quoiqu’en disent les micro-nationalistes et autres chauvins patoisants qui déforment leur dialecte pour en forcer la spécificité, se servir de la langue comme d’un outil de définition essentialiste est une insulte à la diversité des hommes et des langues.

My Little Artelier © Jade.
La beauté dans le divers.
Au fond, ce qui plaît ou déplaît dans la langue de l’autre, c’est toujours la question de la différence. C’est l’autre qui est séduisant ou repoussant, en ce qu’on se voit en lui. Parce que si les représentations que l’on construit sur les traits objectifs des langues sont arbitraires, ce qui ne l’est pas c’est que nous sommes clairement sommés de prendre position. Il n’est pas possible de rester de marbre face à l’abîme de l’altérité, et c’est pour combler ce vertige qu’on choisit d’aimer ou de détester. Pourtant, une insulte en espagnol n’a rien d’aimable, tandis qu’un Ich liebe dich glissé à l’oreille y coule comme un poème.
Si chaque perception de la langue est unique, et répond à des lois qui tiennent de l’intériorité psychologique du sujet percevant et de la culture dans laquelle il baigne, chaque phrase, chaque texte a aussi sa singularité. Puisque c’est dans l’altérité que réside la possibilité du beau (le même n’est au mieux que satisfaisant, mais jamais beau), c’est dans la spécificité de chaque être que réside son pouvoir séducteur. Cette chanson étrangère que vous chantiez enfant, celle sur laquelle vous suiez adolescent, ce petit accent qu’un(e) amant(e) vous aura laissé au creux de l’oreille, ce ton rageur et faussement autoritaire qui vous aura marqué à vie lorsque vous serez rejeté… C’est dans l’incompréhensible étrangeté de l’autre que se trouve son pouvoir affectif et esthétique, puisque l’esthétique est affaire d’affectif.
Le bizarre et le poème.
Et ce n’est pas une surprise si la poésie, une fois libérée du formalisme qui la dominait jusqu’au XIXème siècle, répond précisément à ce critère d’étrangeté. C’est en brisant la normalité de l’écriture qu’advient le poème, en jouant à la fois sur le sentiment d’étrangeté (en ce sens la poésie est souvent perçue comme : ce qui ne tient pas du langage commun) et sur certains processus psychologiques précis. En sortant le lecteur ou l’auditeur de ses habitudes langagières, la langue poétique crée du bizarre sublime.
Parmi les outils qui sont à sa disposition, la poésie peut travailler sur la syntaxe ou sur le rythme pour créer sa spécificité, comme le fait Verlaine avec ce vers de « Lassitude », dans les Poèmes Saturniens, en créant un rythme particulièrement équilibré qui divise le vers en deux par le milieu, puis la deuxième partie en deux également, et qui, par son effet de cadence, procure à l’auditeur un sentiment de complétude : « Mais dans ton cher cœur d’or, me dis-tu, mon enfant ». Cette spécificité se marque vis-à-vis du langage du commun plus que vis-à-vis de la poésie classique et formaliste ; ailleurs, chez le même auteur, des idées esthétiquement plus subversives verront le jour. Si « le vers impair est soluble dans l’air », c’est précisément parce qu’il joue de sa claudication, de son incomplétude, et que cela crée une nouveauté étrange, douce et caractérisée comme en infraction à la règle classique d’équilibre. Pour surprendre l’habitude, la poésie peut aussi créer des images impossibles à représenter, ce dont abusent les surréalistes comme Éluard, « La terre est bleue comme une orange », faisant disjoncter le sens et imposant un doute poétique au lecteur. Elle peut enfin déconstruire des expressions figées, comme le montre cette traduction de l’Évangile de Jean qui contourne l’expression figée rendre l’âme pour réintroduire un surplus de sens et de beauté dans la phrase « tout est consommé ; puis, inclinant la tête, il rendit l’esprit ».
Si aujourd’hui les spécialistes s’accordent pour dire que la poésie n’est pas nécessairement isolée du langage du commun, on lui reconnaît néanmoins cette spécificité : c’est une exploitation précise et profonde de toutes les possibilités qu’offre la langue. C’est la différence entre un roman de gare et du Hugo, entre du rap commercial et du Bonnefoy : l’un se croit suffisant, l’autre, persuadé de son insuffisance, pousse son travail jusque dans les extrémités de ses possibilités. L’un est dans une logique d’efficacité, l’autre dans une logique de beauté. L’un rassure, parce qu’il ressemble, l’autre déstabilise parce qu’il fragmente le monde et anéantit la possibilité de son sens.

Test de Rorschach © Anila Grawal.
Les conditions du bizarre et l’impossible traduction.
Pourtant, si la beauté est dans la déconstruction de la langue et du message, cela rend impossible toute traduction. Comment, en effet, restituer l’effet du travail d’orfèvre du poète sans le dénaturer ou l’affaiblir ? S’il est facile de dire que tout traducteur se fait écrivain lui-même et que toute traduction est une nouvelle œuvre, le fait est que cela vaut spécifiquement pour la poésie (ou pour la prose poétique à la manière des romans d’Hugo). Lire la traduction d’un poème, ça n’a rien à voir avec lire ce poème. Toute la beauté est différente, diminuée ou renforcée, mais altérée.
Les arts vivants qui travaillent la langue disposent d’un outil merveilleux pour pallier ce problème : le sur-titrage. Bien loin d’être un calvaire pour le spectateur — la différence entre le divertissement pascalien et l’art tient pour partie de la mise en danger, de la perte du confort, et pour accéder à l’art il faut parfois s’accommoder des exigences d’un spectacle, fussent-elles inverses à votre détente — ils sont le seul medium apte à vous présenter une partie de la poésie d’origine (tous les jeux de sonorités et de rythme de la langue d’origine) tout en vous en donnant le sens de manière synchronisée. Si la question se pose moins souvent au cinéma, puisque rares sont les films dont les dialogues sont issus d’un travail poétique, le théâtre et l’opéra permettent de pénétrer intimement la poétique de l’autre, de s’approprier les longues séquences de « Cleopatra inspira… Antonio expira… » qui scandent la réécriture d’Antoine et Cléopâtre de Shakespeare par Tiago Rodriguez — pièce dont les multiples valeurs esthétiques reposent entièrement sur cette langue incroyablement déconstruite et étrange(re).
Il n’est jamais aisé d’accepter l’autre et ses spécificités, et, en langue comme partout, cette ouverture demande un effort — un abandon du confort. Accepter de se priver de ses certitudes rassurantes, d’être pris de vertige face au gouffre de ce qui nous dépasse et nous sera à jamais étranger, c’est la condition même de la poésie, et la condition de toute beauté. Il faut souffrir pour voir le beau.
Image à la Une Hands painted in different colors © Milan Ilic Photographer.