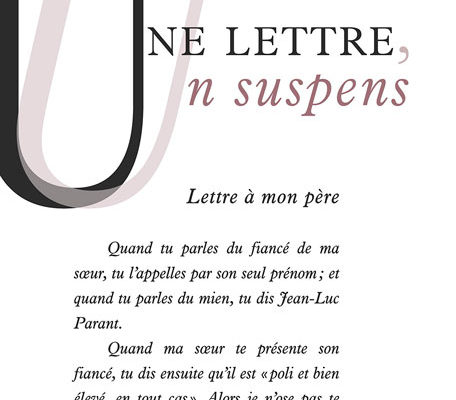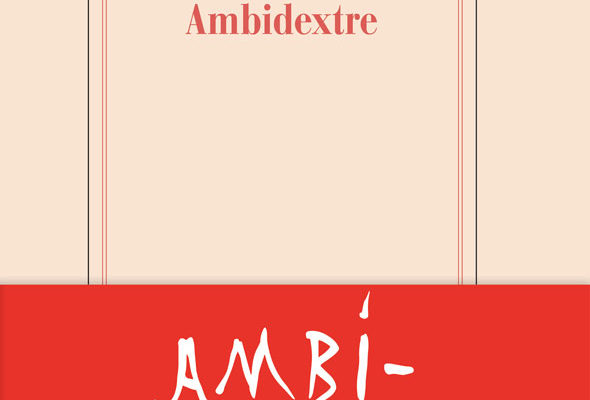En ce temps de crise Halliday, il est bon de se questionner sur l’héritage parental : puisque l’or n’est pas pérenne, puisque l’argent nous échappe, que nous lèguent réellement nos parents ? De Zola à Freud, la réponse est simple : des vices, des vices, des vices.
Et quelqu’un de dire : « Ha bah merci papa maman ». La phrase serait lâchée au détour d’une conversation profonde et sérieuse, légère et sémillante. Ce qui importe en elle, ce n’est pas tant sa signification que le geste qui l’accompagnerait alors : haussement de sourcil, sourire en coin, affaissement d’épaules. Le tort est révélé, la faute reconnue et les coupables nommés.
Nous voici pris au piège d’une topique de la reconnaissance identitaire où les parents, cette présence toujours absente en nous, seraient à la fois cause et conséquence de nos actes, de nos traits les plus sombres. En effet, dès lors que nous nous mettons à penser à nous-mêmes, ils – cette entité à la fois duelle et profondément scindée – constituent une sorte de point de retour, une origine à creuser, à retrouver. Toute déviance attestée par notre conscience y figure potentiellement. L’héritage parental est, depuis l’avènement de la psychanalyse, moins à chercher dans le matériel – qu’ont encore à nous léguer nos parents, si ce n’est un vieux téléphone portable vainqueur de l’obsolescence programmée, une souris de PC sous Windows 95 ou encore un bijou solide, immettable que l’on cachera au fond d’un tiroir ? – que dans le psychique, l’inconscient, le ça dominant. L’homme est ainsi déculpabilisé dans ses erreurs, dans sa perte du droit chemin, dans ses vicissitudes.
La naissance de nos vices aurait ainsi la même origine que la naissance de notre corps. Nos parents nous fourniraient d’un même coup la vie et tout un lot de perversions psychiques, pathologies, cliniques que nous retrouvons, retraçons, développons. L’appréhension de cette déviance est directement héritière de la pensée psychanalytique telle que Freud la met en place à la fin du XIXe siècle. Pourtant, l’idée n’est pas neuve et se trouve d’abord à lire, à s’imaginer avant que d’être pensée.
Le don physiologique : Zola en docteur des vices.
Si Zola n’est pas le premier à parler du vice et de ses origines, il est du moins le premier à en faire un principe de composition. Les Rougon-Macquart constituent en effet la plus grande saga du legs qui existe, le terme d’« hérédité », formulé dès la préface, recelant cette logique du don parental.
« Je veux expliquer comment une famille, un petit groupe d’êtres, se comporte dans une société, en s’épanouissant pour donner naissance à dix, à vingt individus, qui paraissent, au premier coup d’œil, profondément dissemblables, mais que l’analyse montre intimement liés les uns aux autres. L’hérédité a ses lois, comme la pesanteur ».
Dans cet extrait, Zola formule la pensée d’une continuité fondamentale entre les êtres et a fortiori entre les êtres d’une même famille. Tout se transmettrait par le sang, fluide vital qui constituerait une sorte de vecteur des choses cachées. Tout ? Non, puisque nous sommes chez Zola et que, malgré le grand élan positiviste qui le tient et sa ferme croyance dans le progrès, rien de bon ne semble naturel. Les parents vont en effet offrir une panoplie de vices à leurs enfants. Allons plus loin en disant que la vertu n’aurait pas grand-chose à voir avec nos géniteurs : l’honnêteté, la bonté, la candeur seraient des hapax quasi inexplicables, des failles dans la mécanique. L’homme, en effet, est synonyme du Mal et la littérature est là pour le dire. Zola, en bon naturaliste, prétendait à une totale objectivité, pourquoi ne pas le croire un instant et penser que si l’homme avait été bon, il l’aurait peint comme tel ? Tout étant que si l’on poursuit la lecture de la préface, on y trouve une nouvelle logique de la pensée héréditaire qui vient se surimprimer à la première : « Les Rougon-Macquart, le groupe, la famille que je me propose d’étudier, a pour caractéristique le débordement des appétits, le large soulèvement de notre âge, qui se rue aux jouissances. Physiologiquement, ils sont la lente succession des accidents nerveux et sanguins qui se déclarent dans une race, à la suite d’une première lésion organique […] ».
L’hérédité devient signe d’une transmission des tares entre les générations. Et Zola d’aller plus loin en promulguant l’existence d’une fêlure originelle, pas si éloignée de nous. Ce premier parmi les premiers vices se donnerait à lire ensuite comme une sorte d’écho propagé dans les corps des enfants devenus parents à leur tour. Dans le premier tome, La Fortune des Rougon, Antoine Macquart, fils d’Adélaïde (la grande fêlée originelle) et de « Macquart » développe un certain goût pour l’alcool qu’il consomme à outrance et à crédit dans les cafés de Plassans. Avec une certaine Fine, ils engendrent trois enfants dont Gervaise. Celle-ci, dès son apparition dans l’histoire, est le témoin vivant des ravages de l’hérédité : en effet, elle « était bancale de naissance. Conçue dans l’ivresse, sans doute, pendant une de ces nuits honteuses où les époux s’assommaient, elle avait la cuisse droite déviée et amaigrie, étrange reproduction héréditaire des brutalités que sa mère avait eu à endurer dans une heure de lutte et de saoulerie furieuse ».
La petite, quelque peu ravagée par les excès familiaux, est rapidement mise au régime commun, sirotant chaque soir un peu plus longtemps des verres de Suze afin d’oublier son malheur. Son goût immodéré pour cette douceur éthylique est immédiatement renvoyé aux vices parentaux : c’est bien parce que ceux-ci boivent qu’elle-même le fait et cette réalité dépend moins d’une vision sociologique que physiologique de la société puisque la tare est développée justement au moment même de sa conception. Le mal, ici incarné dans l’alcool, est un vice avant tout héréditaire. Il se donne même physiquement à lire, Gervaise accumulant les marques de la souillure sur son corps. S’en suivra une histoire tragique, sur fond de bar parisien, un certain Assommoir.
Le cas de Gervaise, multiplié et décliné à l’extrême dans la saga, peut servir à ce titre d’exemplum : chez Zola, les parents ne cessent d’offrir à leurs enfants des vices qu’ils ne peuvent contrôler ni corriger. Et c’est justement le point d’achoppement des principaux critiques de l’œuvre zolienne : rien ni personne ne peut être sauvé. Le vice transmis via le sang n’est pas l’occasion d’une réflexion mais bien d’une démonstration, aucun des protagonistes ne pouvant échapper à sa déviance. Mais de telles remarques naissent bien a posteriori de ces romans dans une période marquée par l’avènement de la pensée psychanalytique qui va, elle, trouver une solution à ce manquement. Le vice reste héréditaire mais change d’échelle, passant du corps à l’âme.

Sigmund Freud avec ses petits-enfants (vers 1923)
© Fondation privée Sigmund Freud.
La psychanalyse ou la rancune parentale.
La pensée de Freud ne développe pas une croyance en des lois purement héréditaires : les vices sont moins transmis par la physiologie que par un travail involontaire de la psyché. Celle-ci opèrerait un retour permanent vers nos origines et déterminerait nos comportements en fonction d’un legs parental plus inconscient que chez Zola.
La psychanalyse cherche à dérouler l’inconscient qui englobe, par définition, tout ce qui, contenus ou processus, échappe au sujet. Elle est définie comme la pensée du négatif : en effet, il y aurait des choses dont on n’aurait pas l’intuition, un envers obscur caractérisé par le manque et l’inconnu que l’on nomme inconscient. Tout le travail psychanalytique va être alors de faire parler cet inconscient. Cet acte est fondamentalement construit sur un mouvement de retour : retour sur les rêves, sur les blessures, sur les expériences, etc. Quoi de plus étonnant alors que cette opération conduise régulièrement à une appréhension du cadre familial ? Celui-ci constitue en effet, une espèce d’origine chronologique, les parents devenant alors les premiers créateurs de vice, non pas tant dans l’analogie (comme chez Zola), que dans la création de traumatismes qu’il va s’agir désormais d’énoncer et de soigner. Un violeur ne sera finalement que le reproducteur d’un schéma parental vicié, portant à l’excès la pratique de soumission de la femme. Son vice n’est que l’aboutissement d’une asymptote comportementale. Une telle affirmation a bien sûr ses défauts, la pérennité d’une telle pensée ne pouvant se faire qu’à l’aune de modalisations. Toutefois, ce schéma trouve encore une certaine résonance dans nos esprits contemporains.
Dans la série Big Little Lies de David E. Kelley sortie en 2017, on expliquera le comportement malsain d’un des jumeaux de Nicole Kidman par son habitude à voir ses parents commencer tout acte sexuel par une séance de lutte violente et acharnée. L’enfant, tout comme le violeur, porte le stigmate psychique des passions parentales. Le film La Mise à mort du cerf sacré de Yórgos Lánthimos propose lui aussi une lecture freudienne des vices adolescents. On y retrouve Nicole Kidman – mère indigne – en infirmière mariée à Colin Farrell, neurologue. Afin de lancer leurs ébats, le couple a mis en place une sorte de scénario morbide : la femme s’allonge et fait « comme si elle était sous anesthésie ». La scène, gênante au premier abord, devient cocasse lorsque la fille du couple, âgée d’une quinzaine d’années, tente la même technique pour persuader son petit ami de coucher avec elle. Le spectateur, cette fois-ci, s’amuse de la référence, renvoyant immédiatement cette parfaite illustration du lien privilégié qu’entretiennent mort et amour, Éros et Thanatos, aux pratiques parentales. Le vice de la jeune fille est ici tout à fait involontaire et extra-physiologique : l’acte n’est pas tant ancré dans ses gènes que dans son appréhension d’une pratique nouvelle via le schéma parental, observé en secret, étudié en rêves.
Si l’élan zolien condamnait tous les personnages, le rôle de la psychanalyse va être de tenter une sorte de sauvetage psycho-pathologique. En faisant rejaillir cette ultra-présence parentale, elle cherche à mettre au jour nombre de nos vices inconscients et à éclairer des déviances dont le rôle est simplement de nous lier profondément à nos géniteurs plus qu’à exprimer notre identité propre. L’émancipation des comportements parentaux passe par une réévaluation de soi, de notre conscience, de notre vertu possible.
La pensée freudienne a bien sûr largement été remise en question aux cours des années qui ont suivi sa théorisation. Reste que le mérite de Freud est celui d’avoir transmis la possibilité d’une pensée de soi hors du champ purement humaniste. Explorer sa vie devient un acte médical pleinement bénéfique.
Mais nos pauvres parents. Devons-nous les condamner à perpétuité pour nous avoir transmis, par le sang et par les sens, vices et déviances ? D’autres de crier que tout ce package ne vient que d’une contestation, justement, de l’héritage potentiel. Oui mais, encore une fois, n’est-il pas toujours question de legs ? S’inscrire contre ses parents, c’est bien encore et toujours s’y référer. Que faire alors ? Jouer sans cesse de cela ou imposer sa personne comme objet tout à fait unique, sans passé mais avec futur ?
Quoiqu’il en soit, prenons soin de nos vices, ils sont ce qui nous rattache à une histoire ancienne et nous font partir à la recherche d’une transcendance en attente de reconnaissance, à jamais nôtre.
Image à la Une © Collection Puaux-Bruneau, Émile Zola et ses enfants (1902).