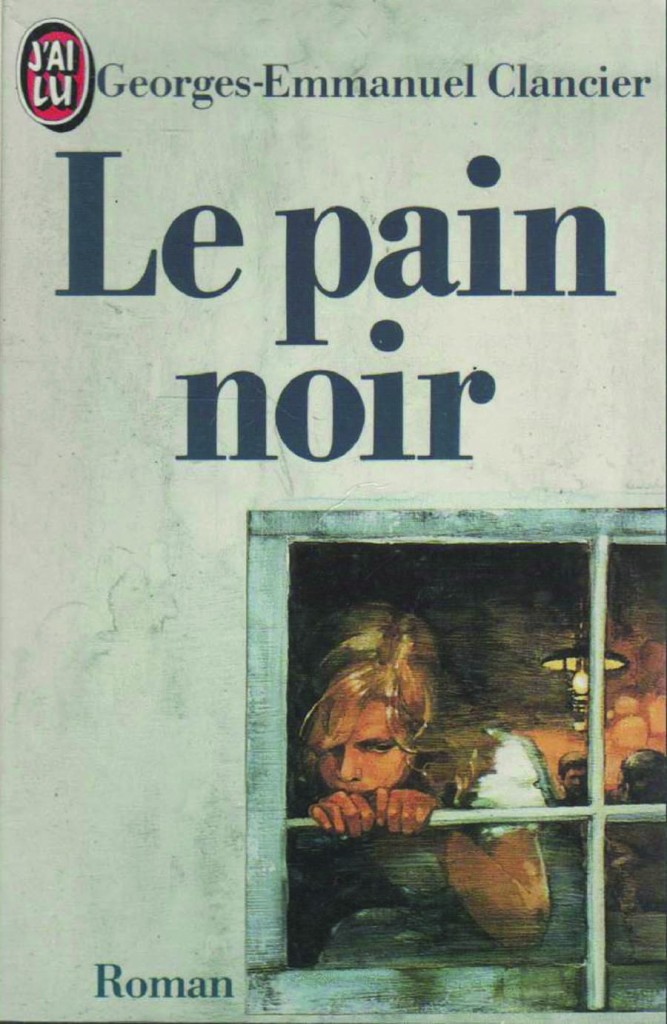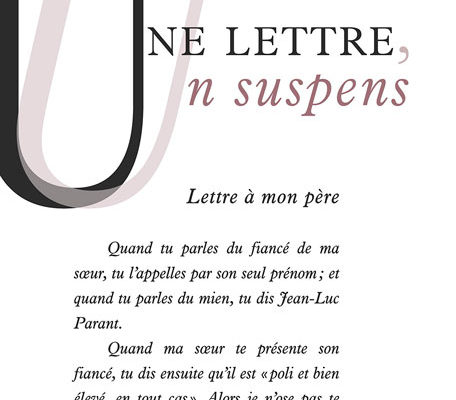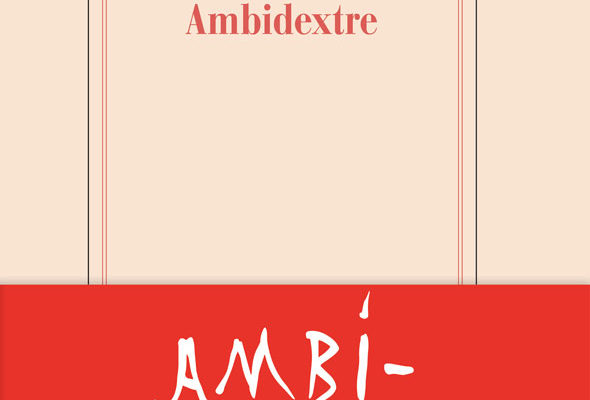Le sage.
L’art poétique et la littérature romanesque se livrent au travers d’une œuvre titanesque de plus d’un siècle. Une marche unique, essentielle pour cet homme, sur des itinéraires que la chair sonore et visuelle du langage trace, explorant toute la surface possible du langage comme parole totale.
Quelles études avez-vous suivies ?
J’ai eu des soucis de santé alors que j’aurais dû commencer mes études de philosophie. Je suis devenu un autodidacte, je dévorais aussi bien des recueils de poésie que des romans ou des livres de philosophie. En mars 1939, je me suis marié et ma femme passait alors sa thèse de médecine. Elle adorait les études et m’a encouragé à passer mon bac. Lorsque j’ai eu mon diplôme, elle m’a dit que je ne pouvais pas en rester là. J’ai donc commencé une licence de philosophie à l’université de Poitiers puis à celle de Toulouse. Officiellement, mon diplôme s’appelle licence de Lettres. Finalement c’est grâce à ma maladie, la tuberculose, que je suis devenu ce que je suis.
Parlez-nous de votre rencontre avec Raymond Queneau.
Dans les années 1940, j’ai lu Un Rude Hiver, roman que j’ai trouvé époustouflant, écrit d’une manière inhabituelle et très drôle. À cette période, j’écrivais dans Les Cahiers du Sud. Un jour Raymond Queneau, qui était alors secrétaire général chez Gallimard, a téléphoné chez moi et m’a demandé de passer à son hôtel. Il était très sympathique et j’avais grand plaisir à discuter avec lui car il avait une culture extraordinaire. C’était une encyclopédie, un personnage étonnant. Notre relation a très vite pris de l’importance sur le plan poétique et sur celui de la protestation contre la barbarie nazie.
Quels autres souvenirs avez-vous de vos débuts ?
Je suis à cheval sur deux siècles. Au début, j’écrivais par rapport à mes propres souvenirs qui se mélangeaient avec les souvenirs de mes parents. Je fréquentais aussi plusieurs comités. À celui de lettres, il y avait des écrivains et poètes qui disaient beaucoup de rosseries sur les uns et les autres, ils avaient la dent dure. Dans ma jeunesse, les grandes revues publiaient de nouveaux poètes à chaque numéro, ce qui était une très bonne chose car elles avaient le mérite de servir de tremplin et de comparatif. Elles jouaient donc un rôle assez formateur pour les jeunes écrivains.
Voyez-vous une concurrence entre les poètes ?
Les poètes sont des personnes comme les autres, je ne vois pas la concurrence. Quand ma fille avait une dizaine d’année, il y avait des poètes qui venaient à la maison et nous nous lisions nos dernières écritures, nous nous félicitions. Ma fille qui assistait à ces lectures me disait « mais papa, entre poètes, vous vous applaudissez entre vous ? ». Je lui répondais qu’un artiste avait besoin d’être reconnu par quelqu’un qu’il considère comme son égal.
En quoi le poème diffère-t-il du roman ?
Le poème s’écrit tout d’abord à travers le poète. La relation de l’écriture du poème avec le temps n’est pas la même que celle du roman. Le roman essaie de rendre le moment du temps qui s’en va alors que pour moi, le temps du poème – même si parfois l’origine n’est qu’un souvenir – est le temps de l’instant qui essaie d’être un instant d’éternité.
Quel est votre rapport actuel à la création poétique ?
Il y a quelques années, j’ai publié mon dernier livre de poèmes : Vivre fut l’aventure. Après cette publication, j’ai décidé que je n’écrirai plus de poèmes. C’est peut-être de la vanité mais tout ce que j’avais à dire poétiquement, je l’ai déjà dit. J’ai atteint le niveau que je rêvais d’atteindre mais maintenant il y a une certaine forme de crainte. En effet, la création poétique implique une relation avec le futur et à mon âge j’estime que mon futur ne peut être que du passé. Si je me projette c’est en arrière, même si inéluctablement, je suis amené à me projeter en avant.
La poésie dialogue-t-elle avec le temps ?
Dans chaque poème, la notion du temps présent est importante, tout comme l’inspiration, même si ce terme a été galvaudé. Les gens n’osent plus l’utiliser car il est lié à une sorte de mouvement que le poète possède à l’intérieur de lui-même – une sorte de poussée vers l’avenir, comme un défi au temps. Je pense qu’un poème essaie de capter l’instant avec une intensité maximale et que cette intensité, au-delà d’un certain âge, est peu probable. J’ai l’impression que tous mes poèmes sont un pas de plus en avant. J’ai fait tous les pas que je pouvais faire dans ma vie. Maintenant, c’est au tour des jeunes poètes de faire leurs propres pas.
Quel constat faites-vous sur la place accordée à la poésie aujourd’hui ?
Ma longue existence me permet de faire des constats extraordinaires. Il y a quinze ou vingt ans, lorsque l’on publiait un livre de poésie, tout le monde parlait de sa sortie. Aujourd’hui, seules les maisons d’édition comme Gallimard ou Flammarion publient encore de la poésie. À l’occasion de ses cent ans d’existence, Gallimard a édité une anthologie, Mon Beau Navire ô ma mémoire, Un siècle de poésie française. Il n’y a eu aucun article dans la presse pour parler de cet ouvrage, juste un petit article dans Le Figaro, six mois plus tard. Il y a de quoi décourager les jeunes poètes.
Est-ce que l’état de l’intégration de la poésie dans la société vous inquiète ?
Je dirais que la société est contre la poésie. Le problème n’est pas l’impression des recueils de poésie car ils sont généralement subventionnés, mais ce qui coûte le plus cher : le stockage. Les livres de poésie ne se vendent pas, c’est lamentable. Nous vivons dans une société qui parle toujours de formation continue, ce qui est très bien, mais personne ne parle de formation continue culturellement, poétiquement, plastiquement ; comme si tout cela n’existait pas, comme si l’homme n’était qu’un acteur économique et n’avait aucun rapport avec ce qui l’entoure, ce qui est pourtant primordial.
Quelles seraient les solutions pour sauver la poésie ?
Les jeunes doivent avoir conscience et dire hautement et fortement que la poésie n’est pas simplement de la distraction pour l’homme. La poésie, la musique et l’art constituent une dimension essentielle. La poésie est la fleur la plus suprême de la culture et elle est la plus menacée, la plus fragile. Une œuvre de qualité exige beaucoup de temps. Je ne comprends pas que certaines grandes maisons d’édition laissent mourir dans leurs placards des chefs-d’œuvre.