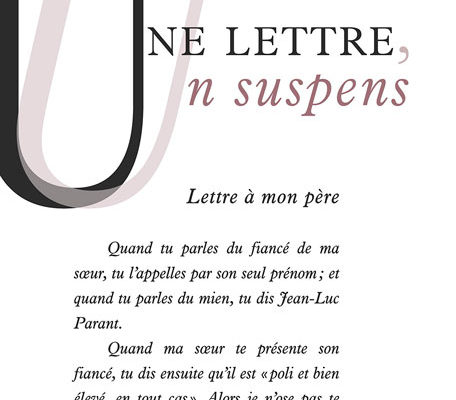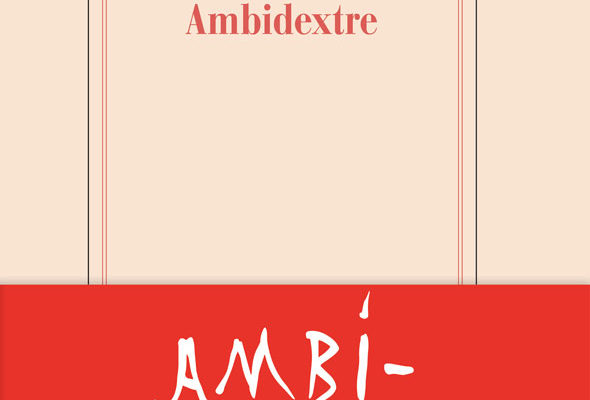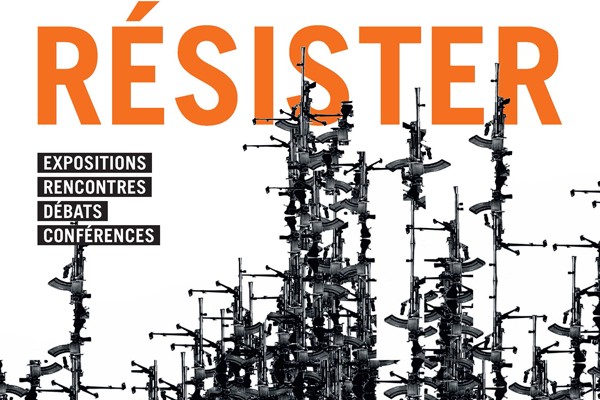Le tisseur.
Explorant les chemins de la mémoire, il est celui qui a le don de créer des liens, de passer des mots et de bâtir une œuvre en toute conscience. Malgré les violences et les tourments, il pose des jalons qui font entrevoir toute la beauté de notre monde.
Quel rôle joue la mémoire pour l’écrivain que vous êtes ?
J’essaie d’être le plus précis possible. J’ai fait un grand travail autour de la rébellion malgache de 1947 et des fois les gens ont tendance à réduire ma mémoire à 1947 ou à la question du colonialisme ou à celle de l’esclavage… mais ce travail est plutôt celui des mémoires partagées, tourmentées. Il y a cette conscience-là en Occident sur la colonisation, l’esclavage, mais j’ai d’autres mémoires plus apaisées qui ne sont, elles, pas toujours partagées par la littérature et/ou la culture française et européenne. Là, c’est une mémoire qui va être portée par l’oralité, ce n’est pas qu’une mémoire thématique, c’est aussi une mémoire qui a la manière de dire les choses et j’essaye de travailler ces divers aspects. Il y a l’objet de la transmission mais il y a aussi la manière de transmettre.
On a beaucoup de chance d’être au présent car il y a eu le passé. Je ne suis pas le premier à avoir écrit, à avoir transmis, mais je peux aussi apporter ma part sans donner un coup de pied sur ce qui a déjà existé. Il y a une transformation ou une fabrique un peu inconsciente, voire subie, et j’essaye d’avoir une certaine conscience de ce que je porte. Je ne peux pas me dire que la rencontre entre l’Occident et l’Afrique ne m’a rien fait, c’est impossible, je me mentirais. On ne peut pas revenir à l’avant, ça n’existe pas. L’Histoire est passée par là, on a été changé par elle ; la question juste à se poser est de savoir comment ne pas être aliéné par les charges de l’Histoire ? J’essaye d’être le plus lucide possible.
C’est comme le choix de la langue française. J’aurais pu dire : je n’écris pas en français. J’aurais pu trouver tout un tas de raisons car je maîtrise, et écris, les deux langues. À Madagascar, un certain nombre d’auteurs disent qu’ils n’écriront jamais en français parce que c’est un choix politique ou identitaire. Là, je pense qu’en dégageant cette langue ou la culture occidentale, c’est un peu comme si nous nous trahissions aussi, ce, malgré tout ce qu’il s’est passé. Pour ma part, je continue à écrire en malgache tout comme en français.
Comment ce travail sur la mémoire, qui semble être une nécessité, fait-il le lien entre Madagascar et l’Occident ? Est-ce une invitation à partager une culture commune ?
Pour moi, cela va plus loin que la question de la rencontre entre les cultures ; toute culture est le produit d’une rencontre. Je suis Malgache, je viens d’une île et on sait qu’une île est la convergence de beaucoup de cultures. Quand je travaille sur un personnage, je peux retrouver une partie de celui-ci en Inde, en Indonésie, en Malaisie ; il peut aussi avoir des traits africains. Cela est à l’image de Madagascar.
J’ai un projet de roman où je veux réécrire la mythologie malgache et pour lequel je suis en train de faire une sorte de répertoire de figures mythologiques. Des fois, je peux réinventer des traits à certains personnages qui peuvent être des prétextes dans des contes par exemple. Je pense notamment à Konantitra, cette vieille femme que l’on retrouve dans beaucoup de mes textes. En fait dans les contes et mythes à Madagascar, c’est un personnage qui sert le héros principal car il se met dans la peau de cette femme pour se déguiser et tromper les dieux ; ce personnage n’existe que pour cela. C’est intéressant de prendre cette femme et de développer tout un mythe autour d’elle. À ce moment-là dans l’écriture, je suis à un endroit où je peux dire que nous sommes des êtres humains dans des lieux différents et qui avons développé des choses multiples. Mais, dans ces différences, je crois que les fermetures ne sont qu’exceptionnelles, peut-être très violentes. C’est là aussi où je me dis que l’Histoire est étrange… Il y a cette expression qui m’interpelle toujours : « Si vous voulez la paix, préparez la guerre. ». La guerre est une chose qui arrive exceptionnellement mais en même temps, le monde est toujours en guerre. Si l’on regarde l’Histoire, est-ce qu’il y a toujours eu un désir des êtres humains à se faire la guerre ? Qui amène cela ? Est-ce qu’il n’y a pas toujours eu un désir d’aller vers l’autre, de marcher, de changer d’endroit ? Je pense que le fait de venir d’une île renforce beaucoup ces questions.

Que représentent l’île et l’océan ?
Je me rends compte que je vais très peu à la plage par exemple mais j’aime être proche de l’océan pour l’entendre. Mais à trop regarder l’océan ça donne le vertige, ça interroge sur la place que l’on a dans l’île. Il y a cette tendance à ignorer un peu l’océan parce qu’il est à la fois la fuite de l’horizon, l’ouverture et l’arrivée de quelque chose d’angoissant. L’Histoire nous a prouvé que la rencontre a toujours été broyée par cette arrivée-là. Ça aurait pu être une belle rencontre, mais c’est devenu une question de domination, de malentendu. C’est aussi une frontière qui engloutit, il y a l’eau, il faut un avion ou un bateau pour traverser l’océan, on ne peut pas juste marcher.
C’est en cela que nous sommes différents des continentaux où au fur et à mesure de la marche, on change. Pour nous îliens, la migration doit se faire dans l’immédiat et non dans la lenteur de la marche, il faut aller tout de suite de l’autre côté et il faut s’adapter. Nous n’avons pas le temps de l’évolution comme sur le continent africain par exemple. Nous, nous ne pouvons faire ça qu’avec Mayotte ; la Réunion est déjà trop française, trop politique. Si l’on va là-bas c’est comme si l’on était happé par la politique alors que si l’on est happé par la culture, ça se passe beaucoup mieux. Il n’y a pas de frein à l’intégration ou à la rencontre de l’autre.
L’océan représente aussi les origines. Tous les Malgaches savent qu’ils ne sortent pas uniquement du ventre de Madagascar. On sait que l’on vient d’ailleurs et cela se raconte dans les mythes, cela se voit dans les visages. La même mère peut mettre au monde un enfant noir et un enfant clair, un aux cheveux crépus et l’autre aux cheveux lisses. Même si l’on voit cela dans la vie de tous les jours, il y a une sorte d’amnésie du point de départ. Donc regarder l’océan, c’est aussi faire face à cette question de l’amnésie, de l’oubli ou même de mensonge sur les origines. Entre nous aussi on se ment sur les origines. Il y a toujours un grand débat sur Madagascar pour savoir si elle est asiatique ou africaine et là, c’est souvent l’idéologie ou le racisme qui vont parler. Par exemple, mes cheveux sont politiques. C’est pour dire : j’ai la peau claire mais regardez mes cheveux…
Peut-on vous qualifier de passeur de mots ?
Plus que passeur, je dirais tisseur. Ce qui m’intéresse avec le terme de tissage c’est qu’il peut à la fois être objet d’art et utilitaire. On peut tisser pour le plaisir ou pour habiller les gens et j’aime bien ces idées. Je suis toujours dans la question de la liberté d’interpréter, de bâtir autre chose. Pour cela, je prends ma part de mémoire mais je ne dis pas que c’est toute la mémoire. Le problème en ce moment pour la littérature malgache, c’est que l’on est trop peu nombreux. Il y a environ 25 millions de personnes à Madagascar et nous devons être trois à publier régulièrement. On ne peut donc pas porter toute la culture malgache. Il en va de même pour la littérature africaine car on a beau dire qu’elle se porte bien en ayant des auteurs qui remportent des prix, c’est un leurre, ils sont trop peu nombreux. Cela pose la question de la transmission car elle est de fait parcellaire. On est dans une situation de manque de passeurs où quelque part on nous demande trop. Est-ce qu’on a les épaules assez larges ? Est-ce qu’on a envie de porter le plus que l’on peut ? Lorsqu’on écrit, on n’a pas toujours le temps, on doit faire des choix sur les sujets. Madagascar brûle. D’ici cinq à dix ans il n’y aura plus de forêts primaires, si l’on continue comme ça, ce sera catastrophique. Je n’ai pas écrit un seul livre là-dessus même si beaucoup de Malgaches me l’ont demandé. Je ne me sens pas légitime à passer cette mémoire-là, ce n’est pas dans ma tradition personnelle.

Vous faites preuve d’une grande humilité, en quoi celle-ci serait-elle liée au savoir ?
L’humilité est différente du savoir par rapport à l’écrit et par rapport à l’œuvre. Pour faire œuvre, il ne faut pas que l’artiste soit plus grand qu’elle. J’aime trop mon métier d’écriture. Lorsqu’on est dans des questions de mises en avant de l’auteur ou de l’artiste, on est beaucoup sollicité. Les gens plaquent une idée sur vous et il est difficile d’entrer en contradiction car cela casserait le mythe. Je trouve que c’est très fatiguant et que ça m’éloigne du temps d’écriture.
La question de l’humilité peut aussi se poser ainsi : qu’est-ce que l’être humain face à tous les savoirs du monde ? Plus on est dans l’humilité, plus on en sait. Quelque part, on est un éternel étudiant et j’adore apprendre, j’ai faim de savoir. Quand je ne sais pas ce que je vais écrire, la feuille me donne toujours plus. Au début c’est dur mais quand ça arrive, ça foisonne, ça se pose. Je n’ai pas l’angoisse de la page blanche. J’ai plutôt l’angoisse de ce que peut provoquer l’écriture en moi. Des fois, je freine. Quand je veux rentrer dans la généalogie de mon père, je sais que c’est un peu toxique, c’est un peu plus complexe et je n’ai pas toujours envie de m’y confronter.
Au cours de l’écriture, est-ce que vous avez des regards extérieurs ?
Non, je vais trop vite. Ce ne sont pas des regards extérieurs mais plutôt des partages. Je peux devenir tyrannique dans les retours en voulant la réponse tout de suite. J’aime beaucoup raturer ou retoucher. À partir du moment où je sens que mes ratures affaiblissent ou détruisent l’œuvre, j’arrête. C’est cela qui est le plus difficile à mesurer car je vois les défauts. C’est important de changer la perception de mon texte et souvent c’est le lecteur qui intervient à cet endroit. C’est là aussi où il est intéressant de passer mes œuvres au théâtre car le comédien ou le metteur en scène va faire parler le texte autrement. Je redécouvre l’histoire, les personnages, les paysages posés. Ils sont transmis, ils continuent à vivre autrement.
J’ai changé ma façon d’écrire le théâtre, mon écriture passe maintenant sur le plateau. Je me pose des questions sur la signification de l’éphémère dans ce que je fais, de comment garder un souffle au théâtre. C’est peut-être un passage, peut-être que plus tard je reviendrai à une écriture plus classique en me disant que je suis à mon endroit d’écrivain dramaturge.
Image à la Une © Sonhary.