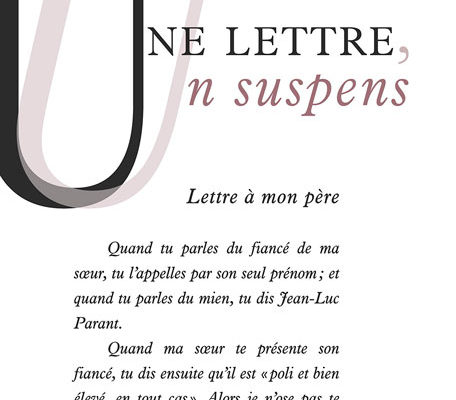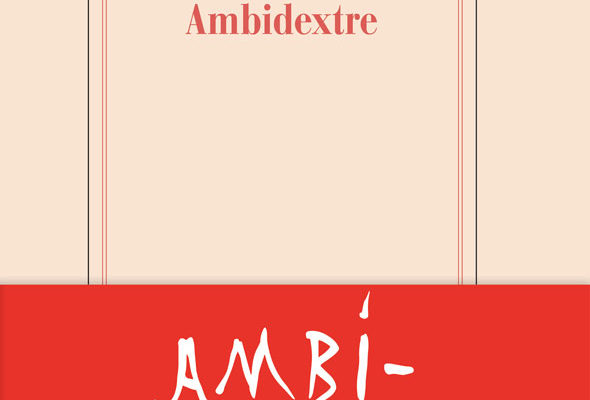Le juste.
Auteur malgré lui d’une Algérie contemporaine en perpétuelle construction, à l’image de son pays, marqué par des cicatrices de la révolution de l’indépendance ou des années noires de la guerre civile, il se revendique comme un artisan romantique du quotidien.
Dans votre parcours, qu’est-ce qui vous a mis sur la voie des mots ?
Le 5 octobre 1988, il y a eu un soulèvement populaire qui a conduit à la libération de la parole publique, à l’ouverture du champ médiatique. C’était notre printemps arabe bien avant celui de la Tunisie ou de l’Égypte. C’est cette ouverture qui m’a fait m’intéresser au journalisme. Pour autant, j’écris depuis que je suis tout petit et la littérature a toujours été au cœur de ma quête. C’était une manière pour moi de refaire la grammaire du monde. On se croit tout permis quand on est enfant et c’était pour moi un îlot où je pouvais m’enfermer pour refaire le monde. J’ai commencé par la destruction de la langue que je vivais comme dominante, le français. C’est la poésie qui m’a permis cela. Je me suis ensuite très vite intéressé aux écritures fictionnelles.
L’écriture de fiction et de poésie sont complètement opposées à celle journalistique ; quels liens faites-vous entre elles ?
Pendant longtemps, je vivais très mal cette opposition parce que le journalisme me prenait mon corps, mes neurones et mes émotions, ce n’est pas un métier que l’on peut faire à mi-temps. C’est aussi un métier qui sature la langue car on est en face d’un réel qui est assez chargé. J’avais toujours l’impression que le journaliste siphonnait toute la matière énergétique, passionnelle, émotionnelle et politique. Il y a toujours le risque de voir le réel rendre toutes fictions caduques mais en travaillant sur le métaphysique et sur le poétique ça rattrape un peu le coup. Il m’a fallu beaucoup de temps pour arriver à établir un cessez-le-feu entre le poète, l’écrivain et le journaliste. J’ai appris à faire la paix entre les deux registres d’écriture ; aujourd’hui le journaliste nourrit l’écrivain, il l’alimente. C’est grâce à toute la matière que je recueille au fil de mes enquêtes et de mes reportages journalistiques que je donne de l’authenticité à mes fictions. Il y a quelque chose qui est de l’ordre de l’urgence dans le journalisme alors que les choses sont transfigurées, défigurées, sublimées à travers la littérature. J’assume le fait d’être un journaliste artisanal et romantique.
Est-ce important de laisser une trace et de trouver du sens ?
Parler de la guerre – j’en ai parfaitement conscience –, ça ne va pas ramener les morts, ni consoler les familles. Si j’avais été médecin ou pompier j’aurais été plus utile. Il y a un ordre narratif dominant qui est là et nous, très modestement, on essaie d’apporter notre petite narration qui va permettre d’appréhender le monde autrement, de reconsidérer certaines vérités qui nous sont données comme étant intangibles. Cette intervention sur le symbolique n’est pas anodine. Ça me fait penser au « capital symbolique » de Bourdieu qui fait partie du patrimoine immatériel d’une collectivité, ça ne doit pas finir comme un tas de cendres. La réception est quelque chose qui se fait à deux. L’écrivain peut élaborer des stratégies et stratagèmes pour toucher le plus grand nombre, pour s’assurer la plus large audience possible mais la réception est aussi mystérieuse que le processus de l’écriture. La question de la trace reste de l’ordre de l’intraçable. Par exemple, aux États-Unis, le magazine Expressions maghrébines a publié 25 ans après sa sortie un texte poétique que j’ai écrit sur Tahar Djaout. Je suis tombé des nues quand j’ai appris ça, c’était assez troublant pour moi qui suis un auteur plutôt confidentiel. Ce n’est pas une question de célébration et de célébrité, c’est se sentir concerné. Je ne dirai jamais que l’art peut faire bouger le monde car je pense que l’on n’est pas juste en affirmant ça, on ne peut pas attendre des arts qu’ils prennent les armes. En revanche c’est quelque chose qui peut créer une perturbation dans le sens commun, faire bouger les lignes, surtout les grandes œuvres, ça peut soulever les cœurs et ramener une forme de compréhension des régions les plus reculées de l’âme humaine. Pour ma part, mon ambition est uniquement d’être au plus proche des zonards de l’histoire, les oubliés des « grands récits ». Les micro-récits : voilà ce qui m’intéresse.
Vous écrivez à la fois en français et en arabe. Quel est votre rapport à ces deux langues ?
J’écris essentiellement en français mais j’ai écrit en arabe des scènes pour des lectures publiques. De temps en temps j’introduis des petits textes comme ça, en arabe, dans mes romans ou mes poésies. Pour des considérations sociologiques, je suis un enfant de la langue française, j’ai grandi entre le kabyle et le français. Je me suis ensuite approprié l’arabe de la rue. J’ai essayé d’intégrer l’arabe littéraire que je trouve fascinant mais ce n’est pas facile. Ce n’est pas le fait de posséder l’appareil lexical, grammatical ou syntaxique d’une langue qui fait de toi un écrivain, ça va plus loin que cela. Pour pouvoir écrire, il faut être possédé par la langue bien plus que l’inverse.

Êtes-vous censuré en Algérie ?
Je n’ai pas de document administratif qui prouve une censure mais il existe une forme d’empêchement, d’entrave qui fait que mon théâtre n’est pas du tout visible dans mon pays. Ça fait presque vingt ans que je fais du théâtre mais je n’existe pas sur les plateaux en Algérie. Dans une certaine mesure, c’est moi qui ai cherché cette forme de solitude. Je ne vais pas crier à la censure car ce serait malhonnête de ma part, d’autant que mes romans sont assez dérangeants, ils ne sont pas faciles. Ils sont assez attentatoires à la bienséance mais ils sont disponibles en librairie.
J’ai fait des lectures de rue qui ont été empêchées par la police, j’avais une dimension activiste. C’était pour moi une manière d’essayer d’exister socialement. J’avais lancé un concept de lectures en espace public sous le titre : « Lectures Sauvages ». Une fois, j’ai donné rendez-vous à mes lecteurs à Tipaza pour une lecture d’une pièce qui s’appelle Les borgnes. Je me suis fait arrêter par la police et j’ai été soumis à un interrogatoire. Sans le vouloir les flics ont fait de moi un héros parce que suite à ça, j’ai publié une tribune qui s’intitulait « cherche flic pour lecture citoyenne à Tipaza ». Ça a fait grand bruit et du coup, partout en Algérie, on m’invitait pour faire des lectures. Je ne suis pas provocateur par nature. Je suis discret. Je ne cherche pas absolument à faire parler de moi. Je n’ai pas choisi l’engagement, c’est l’engagement qui est venu à moi. La moitié du chemin a été faite par les circonstances.
J’ai fait un livre sur le caricaturiste Ali Dilem, Dilem président. Biographie d’un émeutier. À la première lecture, l’éditeur m’a dit que ça ne pouvait pas passer. C’était une censure mais en le mettant sur internet, c’est devenu une bombe rhétorique. Finalement en censurant, on nous donne de l’importance. Je suis l’exemple emblématique de la « fabrique du héros » malgré lui. J’ai été enlevé par un groupe terroriste, des jeunes qui étaient dans la périphérie d’une violence monstrueuse ; j’ai échappé à un attentat contre le journal dans lequel je travaillais (Le Soir d’Algérie), ce qui était un peu l’équivalent de ce qui est arrivé à Charlie Hebdo. Cela dit, la vie n’était pas faite pour moi que de noir ou de blanc, ce n’était pas aussi manichéen. Il y a plusieurs formes de violence. Entre deux attentats, on vivait, il y avait beaucoup de courage et de dignité. Par ailleurs, la mise en mots aide à défaire les traumatismes.
Beaucoup d’intellectuels, de journalistes et d’écrivains sont partis d’Algérie durant les années noires de 90 et ne sont jamais revenus. Dans votre cas la question ne s’est jamais posée ?
Les personnes qui sont parties auraient pu constituer une voie, pour sortir de la bipolarité militaires-islamistes, il y avait cette dualité. Tous ces artistes, ces universitaires, ces intellectuels, toutes ces personnes qui essaient de raisonner et de nous apporter de la lucidité nous ont manqué pendant ces années-là et nous manquent encore aujourd’hui mais il serait malvenu de porter un jugement sur des gens qui n’ont fait que sauver leur peau.
Indépendamment de la position morale sur le devoir de rester au péril de sa vie, il faut tenir compte d’un élément très important qui est la mondialisation. L’un de ses effets c’est la mobilité des compétences. Il y a un réservoir de compétences incroyable chez ces personnes qui sont parties et leurs enfants. Beaucoup ont réussi à réactiver leur savoir de l’autre côté de la Méditerranée. Beaucoup parmi les gens qui sont partis viennent des classes populaires ou bien habitent des quartiers populaires. On sait que ces gens sont en première ligne de front, leur tête était mise à prix. Quand on voit le sort de certaines victimes qui ont été exécutées devant leurs enfants, on se dit que ceux qui sont partis ont pris la décision qu’il fallait.
Moi je suis resté en Algérie pour ma mère, ma famille, mes frères et sœurs, ma place était là. Non seulement en Algérie, mais surtout à Boufarik. C’était un bastion des islamistes, nous avions la guerre sous notre immeuble. Nous habitions dans une tour à la périphérie de la ville à côté d’un champ d’orangers qui était un véritable champ de bataille. Je ne me serais jamais pardonné de vivre ça loin de ma famille.
De quelle manière voyez-vous l’avenir en Algérie ?
J’ai coutume de dire : je ne crois pas à l’espoir mais à l’espoir planifié. Pour moi, l’avenir en soi ne veut strictement rien dire, l’avenir c’est ce que je vais faire demain. J’essaie de ne pas attendre qu’on me balise le terrain. Je revendique une forme d’autonomie et j’essaye d’inculquer cette autonomie à mes filles de façon à ce qu’elles soient « tout terrain ». Où que l’on vive, il faut trouver une forme d’autonomie. L’autonomie ne concerne pas seulement les pays où il y a une dictature très forte.
On voit qu’un peu partout dans le monde, on peut avoir à craindre pour sa vie, pour son corps, pour ses idées, pour les fondements mêmes des droits humains. Ils sont peu ou prou remis en cause par différents procédés, sous différentes formes. Donc partir d’un pays pour aller dans un autre où l’on est a priori plus en sécurité, où l’on ne peut pas véritablement s’exprimer, où l’on peut être discriminé, ça rime à quoi ? Et cette régression généralisée des libertés nous impose à tous une vigilance permanente.
Pour vous, la guerre c’est quoi ?
La guerre c’est une violence totale : physique, psychique, urbaine, culturelle, symbolique, ethnique… Cela dit, il y a plusieurs sortes de destructions de l’espace humain qui ne sont pas nécessairement militarisées. On est confronté à plusieurs violences sournoises au sein même de la modernité : dans l’humiliation, dans la précarisation, dans la destruction de notre environnement immédiat, dans la guerre faite aux migrants comme on l’a vu avec l’épisode de l’Aquarius. Voir les gens dormir dans la rue, pour moi, c’est une terrible injustice. Dans le cas de l’Algérie, c’est la preuve que la guerre que l’on a faite pour notre indépendance n’est pas achevée. L’objectif final n’était pas seulement de s’affranchir d’une autorité administrative. Quand on voit après toutes ces années qu’il y a encore une telle misère sociale, on se dit que ce n’est pas fini. Je ne remets pas en cause l’idéal révolutionnaire du FLN « canal historique ». Je voudrais trouver des modalités de transformation du réel sans violence, sans passer par la guerre, en privilégiant les actions civiles et civiques notamment par la culture, pour amadouer et adoucir le réel.
Image à la Une © Amina Menia.