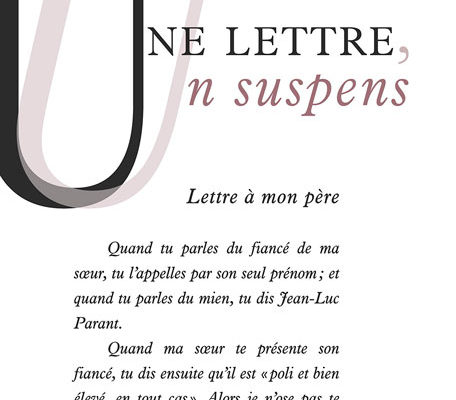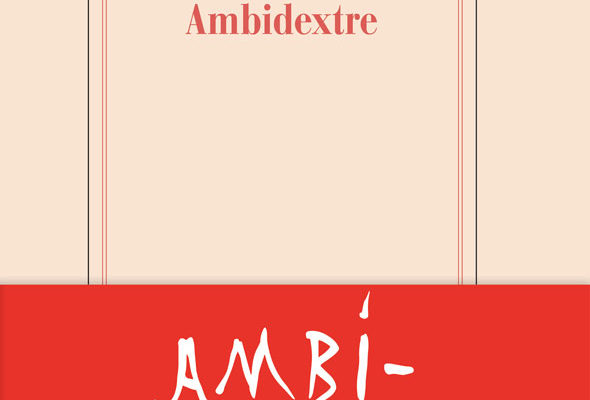Son image est encore fraîche dans ma mémoire, un souvenir vif qui illumine mes nuits lorsqu’il m’arrive, bien trop souvent, de revoir sa silhouette dans mes derniers songes.
Avec sa démarche craintive et son élégance toute féline, je la revois traverser comme si c’était hier, à sa manière souple et silencieuse, l’obscurité intime de ma chambre. Elle aimait se lover dans mon canapé défoncé, sur le cuir duquel elle exposait à mes yeux admiratifs, l’harmonie naturelle et animale de ses courbes. Plus d’une fois je me suis surpris à rester des heures durant, assis au fond de mon vieux fauteuil, épiant d’un oeil circonspect et avec une certaine envie, la façon à la fois innocente et méthodique qu’elle avait de s’occuper de sa toilette. Après son nettoyage minutieux, sentant sur elle peser mon regard, elle s’étirait langoureusement de tout son long entre les coussins et sombrait dans un sommeil lourd et profond. Je me levais alors et aussi silencieusement que mes vieux membres me le permettaient, m’asseyais auprès de son petit corps chaud, pour venir lui gratter d’un doigt hésitant la blancheur de son cou.
Bien que n’ayant jamais développé de réelle affection pour Ophéline, je remarquais qu’en dépit du snobisme caractéristique de sa race et de l’indifférence qu’elle affichait à mon égard, nous nous aimions d’une certaine manière. Lors de mes nombreuses errances nocturnes, quand je me plongeais avec une délectation honteuse dans les bas-fonds de mes réflexions, il m’arrivait souvent de m’interroger sur le sens de mon existence et d’inclure dans cette méditation
elle entrait souvent au cours de la nuit…
la place peut-être dérisoire qu’occupait Ophéline. Aussi, mes pensées convergeaient souvent vers cette conclusion en apparence si simple, que nos vies marginales étaient toutes deux vouées à un destin certes incompatible mais étrangement proche. Évoluant tous deux en-dehors de tout système établi, nos existences consistaient essentiellement à combler, à l’aide de nos carcasses frêles, l’immense vide de mon appartement.
Elle entrait souvent au cours de la nuit par ma fenêtre laissée entrouvert et mangeait discrètement, tel un rodeur noctambule, la maigre collation que je laissais à son attention dans la cuisine. Ce n’est que lorsque je me levais tôt le matin, voyant l’assiette vidée de son supposé contenu que j’étais informé de sa visite.
Il lui arrivait à de rares occasions, sans doute mue par un besoin feint ou non de contact social, de venir solliciter dans un appel aphasique mes caresses. Elle venait alors frotter ses chairs duveteuses sur mes cuisses pendant que j’écoutais à moitié somnolent une symphonie de Bach ou un concerto de Schubert. Prenant soudain conscience de sa présence et ressentant également ce besoin de communiquer avec autre chose que ma propre lassitude, je la prenais sur mes genoux et l’enlaçais affectueusement. Bien qu’éprouvant au fil de mes caresses un réel plaisir, je savais cette démonstration de tendresse éphémère car venait inévitablement le moment où, davantage lasse que rassasiée, elle décidait de se soustraire à mon étreinte et glissait sur la pointe des pieds son corps souple dans la nuit, hors de ma portée.
transposer mon âme fatiguée dans ses chairs tendres…
Ce n’est pas tant le contact de sa peau douce sous mes doigts, ou bien l’insolent rythme de ses déhanchés, ni-même la délicatesse de sa taille fine et étroite qui me plaisait chez cette jouvencelle farouche, mais bien plus la façon si mystérieuse et enviable qu’elle avait de fondre son être dans l’espace. Comme si le monde environnant, bien que sûrement inaccessible à sa perception, acceptait sans contraintes ni restrictions la totalité de son essence. Je m’amusais parfois de ses sautes d’humeur, de sa folie passagère, de ses disparitions subites et ses réapparitions plus surprenantes encore.
J’admirais, comme si elle utilisait sa substance sans en avoir réellement conscience, l’aisance presque désinvolte avec laquelle elle évoluait dans l’appartement, ou bien la manière dont ses yeux verts en amande se posaient sur moi lorsque je la surprenais en pleine nuit en train de jouer avec une innocente proie. Si la paresse et le goût d’indépendance étaient entre nous des traits de caractère communs, la comparaison s’arrête là. Bien entendu j’avais conscience, mais de plus en plus vaguement, des différences fondamentales qui existaient entre nos deux morphologies. Mais au-delà de l’aspect extérieur, la véritable différence résidait dans la pleine perception et maîtrise qu’elle avait de son corps, en contraste avec l’éloquente indifférence dont j’usais en laissant dépérir le mien.
Je souhaitais certaines nuits, alors que mes vieilles articulations me faisaient souffrir, transposer mon âme fatiguée dans ses chairs tendres et graciles afin de renouer avec la liberté. C’est avec répugnance, mais surtout envie, que je la voyais dans ses heures de chasse malmener, entre sa gueule acérée, ses victimes. Avec quelle souplesse elle bondissait autour d’elles, quelle jeunesse cruelle et naïve émanait de ses gestes vifs et charnels. Je m’interdisais d’intervenir dans ses moments intimes liés à son état de nature, mais j’enviais jalousement sa vitalité, sa fougue et sa rage, cette rage que j’avais perdue. Parfois je décelais dans ses ronronnements gourmands la faible consonance d’une tristesse, tristesse que je partageais. Et quand elle en avait fini avec son jouet disloqué, étendu tel un pantin désarticulé sur le canapé, elle furetait silencieusement jusque dans ma chambre.
D’un miaulement attristé elle me faisait partager la détresse de sa nature domestiquée.
Cette nature qu’elle tentait désespérément de retrouver, ne faisait que confirmer à mes yeux aigris l’extinction définitive de son instinct grégaire. Cette incapacité à recouvrer sa liberté originelle, à être de nouveau maîtresse de ses instincts, d’en atteindre la pleine possession, la rendait inévitablement dépendante de moi, de la même manière que l’impossibilité inaltérable de posséder son corps me rendait dépendant d’elle. Une dépendance réciproque que nos piètres tentatives pour exister en-dehors de l’autre ne faisaient qu’exacerber.
Mon corps était grinçant, le sien était vif ; sa liberté était contrainte, mon asservissement était conscient. Pourquoi, me demanderiez-vous, envier une telle existence ? Pourquoi renier le confort humain pour une liberté fantasmée ? Pour la simple raison que cette liberté tant désirée est une prison et que l’espoir déplacé en est geôlier. Réciproquement, mon esprit reste figé car mon corps l’entrave.
La vraie question est de comprendre pourquoi mon corps moribond, qui dans ses derniers spasmes m’inspire crainte et douleur, me fait subir ainsi les murmures confus de mes anciens désirs ? Pourquoi la possession physique de l’autre implique-t-elle l’abandon de ma propre personne ? Pourquoi Ophéline est Ophéline et que moi je ne le suis pas ?
Je suis peut-être original, dérangé, marginal ou sénile, mais appelons un chat un chat : je suis fou, d’un corps qui ne m’appartient pas.