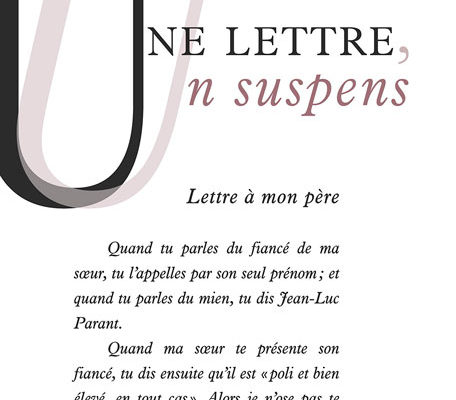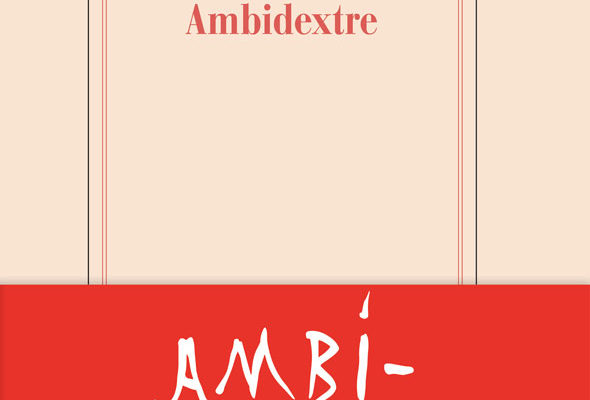théâtre d’une mémoire.
Cette note de piano qui revient incessante, le cri bref et aigu d’un manque qui me rappelle pourquoi je suis là, pourquoi je suis allongé dans l’ombre. Lights d’Archive bourdonne dans mes écouteurs. Je n’écoute pas réellement, je perçois simplement la présence de la musique, une présence familière qui m’accompagne avant chaque spectacle. C’est un refrain rassurant, une berceuse magnétique qui m’apaise, hypnotise mes sens, mes émotions et ma peur.
Le rythme se noie dans le fond sonore, presque imperceptible il devient la litanie de mon inconscience qui atteint alors une perception nouvelle. Au-delà d’elle, au-delà des murs qui me séparent de la scène, j’entends les craquements du parquet qui ploie, qui gémit, sous le pas lourd et anonyme du public entrant dans la salle. Je sens également les rainures de bois s’enfoncer dans mon dos, creuser ma chair devenue tendre et moite malgré le froid silencieux qui emplit difficilement l’immensité du salon. La lune se reflète dans les innombrables miroirs de la pyramide, son spectre blanc vient mourir à quelques centimètres de mon bras. Je la sais là, imposante, figée dans son éternel sourire glacé, pointant vers le ciel son nez mille fois contemplé. Je la sais là mais je ne la vois pas, tout comme je ne fais que deviner l’immense plafond qui me surplombe. C’est une voûte sombre qui se penche sur moi, prête à m’avaler. Je connais cet endroit par coeur, je connais cette musique par coeur, mais j’ignore encore ce que me réservent les prochaines heures. C’est une ignorance aveugle, douloureuse, qui semble frémir sur les toiles craquelées qui m’entourent. J’ignore également qui en sont les auteurs. Gauguin, Manet, Delacroix, Modigliani… D’innombrables noms de peintres illustres viennent se bousculer dans mon esprit, s’y accrochant un temps avec férocité, comme dans l’espoir de revendiquer une nouvelle fois la gloire qui leur est due, puis s’effaçant subitement devant l’opacité de mes pensées. Je n’ai jamais vraiment aimé la peinture. Je suis un homme de mouvement, de geste et d’action, je ne suis pas figé. Je ne suis pas ces couleurs muettes que le monde contemple avec cette stupéfaction béate et imbécile. Je suis une œuvre qui bat. Je ne suis pas de ces peintres au visage terreux, je suis un comédien brillant. Je ne suis pas un homme de musée, je suis un enfant du théâtre. Et puis, contrairement à tous ces peintres dont les noms prisonniers de leurs plaques dorées s’oxydent doucement à mesure que le temps passe, je ne m’oxyde pas, je ne suis pas mort. Je suis ici, bien vivant, attendant de rentrer dans l’arène. Je suis un gladiateur des temps modernes et bien sûr que le risque est grand, bien sûr que je pourrais y laisser la vie, puisque jouer n’est pas une réponse à quoique ce soit, mais une question de vie ou de mort. Les raisons importent peu. Même si cette pièce est née d’un autre, d’un homme brillant qui, désormais, a lui aussi sa plaque dorée ; je ne m’en soucie pas. Je suis ici à cause d’un mort ; mais qui ne l’est pas ?
Je suis allongé, je suis torse nu, un pantalon blanc comme unique costume. La clarté lunaire réfléchie par la pyramide rampe sur le sol, elle avance doucement en direction de mon coude. Il sera bientôt l’heure. Sentir le temps qui passe aussi brièvement qu’une brise mais sentir aussi son poids écrasant qui s’abat sur vous… C’est ce sentiment qui domine tous les autres. Écrasant est le bon mot, mais il n’est pas assez précis pour décrire l’étendue de cette attente, les remous qui font en ce moment vaciller mon âme. Je joue à l’endroit même où il a grandi, où il a pris goût à l’art, au beau et au sublime, autrement dit, à l’endroit où il est vraiment né. Je ne crois pas aux coïncidences, ni même au destin, seulement aux caprices du hasard et peut-être un peu à la chance, même si je la provoque davantage que je ne la subis. Rien de prophétique là-dedans, je joue ce soir en son honneur, au mien aussi bien sûr. La chose qui me trouble le plus est ce lieu. Il semble vivre en moi, à travers moi, car ma dernière représentation dans un endroit aussi atypique et improbable qu’un musée remonte à une dizaine d’années, à l’époque à laquelle je suis devenu metteur en scène, comme lui. Comme lui je joue pour m’amuser un peu, pour rappeler à ceux qui l’ignorent encore que je peux moi aussi, si le coeur m’y prend – et c’est uniquement une question de coeur si je joue ce soir – monter sur scène et les éblouir de ma présence. Sans doute pour me prouver que je vis, pour ne pas finir comme lui, en grand mentor éploré.
Je voudrais être lui mais différemment. Je suis déjà l’homme blessé, l’homme aimé, l’amant désiré, frustré aussi, l’artiste drogué, camé, infecté par l’amour de soi et des autres. Je suis le vent, le fantôme de ces allées. Éternelles gardiennes de la mémoire, elles deviendront ce soir le théâtre du présent. Elles seront le caisson où résonnera mon avenir, elles crieront ma révolte et celle de toute une génération, elles raconteront une histoire, parce que ce genre d’histoires « peut contenir le monde, ça peut nous contenir, nous et les problèmes qu’on a à affronter, et la façon dont on est au monde ». Ce n’est pas de moi, c’est
je suis déjà l’homme blessé
de lui. Si je sens le sol du Louvre vibrer c’est aussi à cause de lui. Ils sont venus ce soir pour le voir à travers moi, pour voir si je peux supporter son héritage et faire tomber sur moi leurs sentences. Ils sont tous là à attendre à quelques mètres de moi.
Je les imagine se tasser les uns contre les autres, s’asseoir sur les bancs inconfortables – « Le théâtre occidental a sacrifié le sacré au confort », Pippo Delbono – je les imagine et cette pensée m’amuse. Je me fous de ce qu’ils pensent, de leurs regards, de leurs jugements. Catherine Tasca, Alain Crombecque, Richard Peduzzi, ils sont tous là. Pauvre Richard… Il doit se sentir mal à l’aise en voyant que j’ai abandonné l’idée des décors. Je suis sûr qu’en ce moment il cherche avec détresse le moindre indice qui pourrait lui suggérer la présence, aussi infime soit-elle, d’une quelconque mise en scène. Cet indice je le lui ai donné ; un briquet en métal, solitaire, trône debout sur le sol, posé là entre Le Sacre de Napoléon et Le Serment des Horaces… Je ne m’en servirai pas. Je m’amuse, je suis libre, je me sens fort, intouchable et pourtant, je n’ai jamais eu aussi peur.
Le doute n’existe pas, c’est le manque qui me vrille l’estomac. Drogué par ses œuvres, par ces visages et ces corps solitaires tordus de désirs qu’il savait si génialement mettre en scène. Ma solitude propre, aussi, qu’il a brisé, remodelé, pour en faire quelque chose de beau. J’ai peur car je sens aujourd’hui ma solitude abandonnée, prise en étau entre ce qu’elle était et ce qu’elle deviendra après, après cette pièce, après ce soir, après cette nuit sombre et pleine qui fait vibrer à l’unisson mon
âme, la sienne et celle du Louvre.
La note de piano recommence. C’est la troisième fois. Ils l’ont assez entendue et moi aussi. Je regarde la fenêtre, suit du regard son ombre blanchâtre qui caresse le sol et qui vient mourir sur mon ventre. C’est ici que réside le mal. Je me lève, étire mes muscles raidis et jette un dernier regard à la pyramide. Elle brille chaque soir, je la vois maintenant et comprends que c’est mon tour.
À Patrice Chéreau.