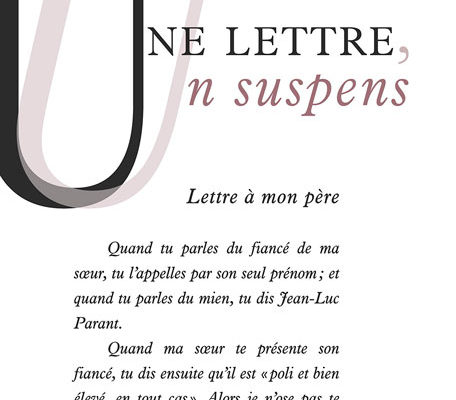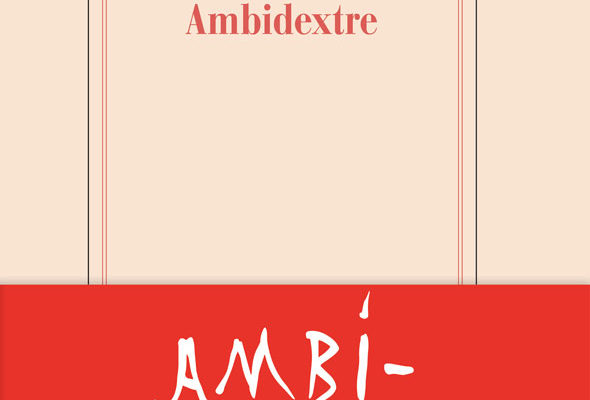La route traversait le village dans toute sa longueur. Les chiens nous regardaient passer, haletants, couchés à l’ombre des maisons basses et bâties dans un amalgame de métaux, de crépi, de bois, couvertes de tôle ondulée qui ressemblait à des lames de soleil. Un troupeau de vaches maigres arrivait en face, encerclant l’automobile, avec leurs yeux énormes et des meuglements rauques. En suspension, la poussière ocre soulevée par les bovins enveloppait un bâtiment soviétique, tout de parpaings, tombé en désuétude, tandis que la mosquée pointait son étroit minaret d’argent vers le ciel. La voix éraillée du muezzin courait au-dessus des toitures. Dans l’air flottait une odeur de feu de bois. Les femmes au visage drapé dans des châles semblaient veiller sur le village. On vit quelques enfants. Aucun homme.
On laissa derrière nous la dernière habitation pour s’enfoncer dans le silence désertique de la steppe, progressant à allure réduite sur une route criblée d’ornières avec, de part et d’autre, des touffes de buissons secs, des fougères et des peupliers esseulés. Les dégradés de vert pâle et de gris s’assombrissaient à mesure que l’étendue rejoignait l’horizon, dérivant ensuite vers un bleu nuit mêlé à des teintes violacées, et de grandes plaques mauves délimitant comme une frontière tragique la terre du firmament. On eût dit que la steppe voulait imiter le ciel, se faire plus immense que lui. S’y fondre. Rien ne s’écrasait ici. Hormis quelques faibles reliefs, quelques vallons pathétiques, tout n’était que prolongements et sensations d’infinis. Une platitude en épousait une autre. Le vent n’avait aucun obstacle, de même que le regard. Des corbeaux à terre ressemblaient à de petits cailloux noirs, tandis que d’autres volaient en cercle, plus loin, dans le ciel métallique.
Les déchets plastique clairsemaient le bord de la route. Bouteilles, bidons, tuyaux, sacs déjà en voie de décomposition, la civilisation humaine — la civilisation du plastique — dégurgitait ce qu’elle ne parvenait à éliminer. On roulait sur la route ligneuse et difficile, qui s’effaçait dans la lumière trouble d’une fin d’hiver. Le printemps, c’est le bon moment pour mourir, avait-il dit, au téléphone, pour me demander si je voulais venir le voir, une dernière fois… Pas chez moi, pas dans les montagnes, ailleurs. Je te dirai où on se retrouvera. Bifurquant à droite sur une piste en terre, Vassili accéléra en s’énervant. « — Y a rien ici ! s’écria-t-il. Rien ! Il t’a raconté des conneries, le vieux… Tu vois bien qu’il y a rien ! — Da, da… il n’y a rien, répondis-je. Il n’y a rien… — Et on va rouler comme ça, dans le rien, pendant encore longtemps ? — On va rouler jusqu’à ce qu’on le trouve. — Jusqu’à ce qu’on le trouve ? On va manquer d’essence si on continue, oui ! Oh, Gaspadi… Tout ça pour un vieux fou qui raconte des conneries… — Da, Vassia, da… et qui en plus est bientôt mort… — Da ! et qui en plus est bientôt mort ! Oh, Gaspadi… » Et Vassili pestait, décrivant plutôt bien l’homme qu’on allait voir : un vieux fou qui racontait des conneries. Au bout d’un long moment, assommé par les cahots de la route, je vis au loin les tâches blanches qui formaient comme des éclats d’écume dans la steppe. Les cerisiers en fleurs.
Je fis signe à Vassili de s’arrêter sur le bord de la route, puis de m’attendre ; je me dirigeai seul vers les arbres. À plusieurs centaines de mètres, sur un léger relief, se dressaient les mausolées de briques et de terres d’un cimetière kirghiz. Et assis dans l’herbe, le vieux fumait. Son visage paraissait petit sous son kalpak ; il chantait en faisant semblant de ne pas m’avoir vu. Près de lui, deux chevaux broutaient l’herbe rêche au sortir de l’hiver. En revoyant ce visage osseux et buriné, cette barbe blanche, ces mains calleuses et marbrées de plaques noires, une violente tendresse m’a serré le cœur… Beaucoup de choses ressurgissaient, du ciel descendait l’oiseau Karakouch aux ailes si vastes qu’il ombrageait des pays entiers, des hommes se transformaient en bouquetins ou en mouflons ; et des arbres, dont les racines allaient si loin qu’elles s’accrochaient de l’autre côté de la Terre, accueillaient sur leurs branches des yourtes, des chevaux ailés, des aigles à tête de loup, tandis qu’à leur pied des djiguites en tenue blanche — cavaliers qui vont si vite qu’ils essoufflent les tempêtes — affrontaient les djinn ou les armées d’un khan tyrannique, chassant les argalis qui bondissaient de cimes en cimes dans le dédale des Monts Célestes, leurs cornes torsadées déchirant les nuages ; et je les revois, s’abreuvant dans des rivières d’azur, là où des jeunes filles aux cheveux couleur de charbon, des yeux noirs en amande, se baignent nues, avec leurs tresses coiffées de fleurs aux corolles ensorcelées pour lesquelles des rois meurent ; et, sur les berges, des bergers vendent leurs rêves à des sultans en capes rouges, alors que des poissons aux écailles d’or servent de voiliers… toutes ces images hypertrophiées que le vieil homme avait soigneusement semées dans ma mémoire, lorsqu’il m’avait accueilli chez lui, dans les montagnes au-dessus de Gorno-Serafimovka… On se salua chaleureusement, main sur le cœur, le regard perçant. Le vieux conteur m’annonça que la mort serait clairsemée d’histoires, c’était sûr, ce serait des histoires incroyables… Et quand j’ai demandé ce qu’il ferait s’il n’y avait pas de récits, dans l’au-delà, il a répondu : « J’en connais assez pour ne pas m’ennuyer. »
Nous avons parlé à voix basse, comme si nous ne voulions pas troubler le chant du vent sur la steppe. Derrière nous, loin au sud, se dressaient les sommets enneigés des Tien-Shan. J’étais étonné que le vieil homme me donne rendez-vous ici, dans la steppe, près de la frontière avec le Kazakhstan… Peut-être était-ce parce qu’il n’était plus très loin d’une autre frontière, ai-je pensé… ou parce que c’est la steppe qui donne sa valeur aux montagnes.
Il me désigna deux sacoches au cuir craquelé, posées dans l’herbe. De vieilles sacoches soviétiques dont les lanières s’enroulaient au sol comme des serpents. « Tout ce que j’ai écrit, c’est là, a-t-il dit, là-dedans, il y a toutes mes histoires, tous mes contes, toutes mes lettres, des poèmes aussi, des récits jamais terminés… tout ce qui est né de ma main, et de mon âme, c’est là-dedans… On m’a donné ces sacoches quand je travaillais au kolkhoze. Tu sais, je devais me cacher pour écrire, parce qu’ils n’aimaient pas trop ça. Mais j’ai compris qu’on écrivait mieux en cachette, à l’abri des regards. »
On décida de marcher un peu, vers un orme aux ramures encore à nu, qui bientôt brandirait ses feuilles dans le printemps. J’ai dit que je me souvenais d’une histoire que j’avais profondément aimée — qui m’accompagnait encore aujourd’hui ; celle d’un homme appelé Tchinarbaï, amoureux d’une jeune femme qui avait le pouvoir de se dérober à lui en s’envolant grâce à sa robe. Je ne me souvenais plus des détails, seulement du fait que Tchinarbaï avait attendu longtemps, très longtemps, fou de désir. Puis, un jour que la jeune femme dormait dans un champ, il enroula ses longues nattes autour de sa taille — il en fit même cinq fois le tour — et lorsque la femme se réveilla, puis décida de s’envoler, elle entraina Tchinarbaï attaché à ses cheveux. Ils montèrent haut dans le ciel, où finalement ils se déclarèrent leur amour. Le vieux conteur eut un sourire. « Heureusement que les cheveux des femmes sont résistants ! dit-il. Surtout chez nous. Tu as vu ici, ils sont comme du crin au toucher. »
À mesure qu’il claudilauquait vers les cerisiers, la démarche du vieil homme se faisait pénible. La présence des deux chevaux m’interpellait. « Celui au poil clair, il est très jeune et farouche. Il a un sale caractère ! mais il est robuste… Il fera un merveilleux étalon. Je vais lui rendre sa liberté. L’autre, celui-ci, c’est mon vieux cheval de montagne, sa cage thoracique est plus large, tu vois, pour pouvoir respirer en altitude. Je suis monté haut dans les cols de montagnes avec lui… »
Le vieil homme me demanda de lui tendre les sacoches ; ses mains peinaient à les porter, tremblaient atrocement, puis il s’empara d’une corde qu’il noua autour des lanières. Je l’observais. Il approcha du jeune cheval à la robe aubère, qui se déporta de quelques mètres avant de se laisser prendre la bride. L’homme lui caressa l’encolure, passa la corde sur son dos, de sorte que les deux sacoches pendirent comme des étriers sur chaque flanc de l’animal. Il retira la bride, passa sa main dans la crinière. Longuement. Et brusquement, avec une grande violence, il gifla la croupe du cheval qui partit au galop. Les deux sacoches secouées sur ses flancs laissèrent échapper des feuillets et des pages de mythes qui virevoltèrent… les lanières ne résisteraient pas longtemps, me suis-je dit… On scruta cette fuite… Dans le regard du vieil homme brillait l’éclat d’une douce amertume, du même éclat fragile et douloureux que celui du ciel au-dessus de la steppe. Sur son visage aux mille rides est redescendu le calme, tout semblait se défaire, se délier, avec une espèce d’insouciance — un grand relâchement, une dépossession, un dépouillement peut-être — qui le faisait presque sourire. La bête filait. Elle galopait furieusement sur la steppe, vers un horizon de bleu et de mauve. Elle s’éloignait en soulevant un nuage de poussière qui, dans un rayon de soleil, arborait des reflets de cendre.
Pour Armelle D.
Photographie à la Une © Loïc Mazalrey.