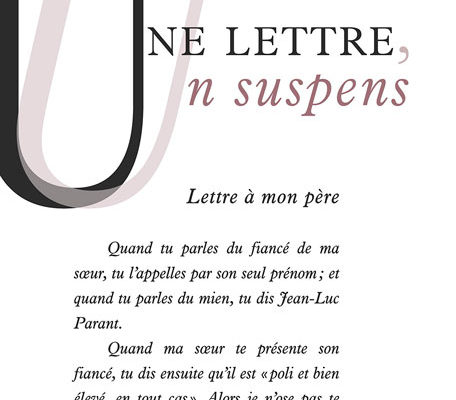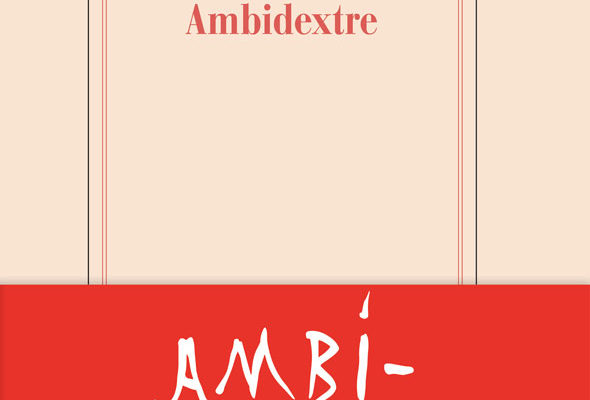Je m’appelle Thomas. J’ai trente-quatre ans et je suis psychologue, spécialisé dans la petite enfance. Je travaille régulièrement avec les services sociaux et les associations, pour aider de jeunes réfugiés en souffrance. Voici l’histoire de Fayaz, six ans.
Fayaz est arrivé l’an dernier en France. Après un long, très long périple depuis Farsi, un village perché à 2 276 mètres d’altitude, il a franchi, comme un symbole, la frontière dans les Alpes. Arrivé frigorifié avec son oncle, sa mère et sa petite sœur, il a été orienté vers le centre d’accueil pour lequel j’interviens. La loi oblige les enfants étrangers à être scolarisés, et Fayaz s’est donc très vite retrouvé dans une classe. Avec son teint hâlé, sa petite bouille ronde, ses cheveux noirs de jais et ses grands yeux verts, il ne passait clairement pas inaperçu. Je me souviens que son oncle avait essayé de faire comprendre dans un anglais approximatif que le petit garçon ne parlait plus depuis leur arrivée sept mois auparavant où ils fuyaient la guerre et la désolation. Avant très bavard, il n’avait plus au fond de ses prunelles, cette étincelle de vie qui anime tous les enfants. Il paraissait éteint, semblait évoluer dans une réalité éthérée. Sa famille avait été décimée, victimes collatérales des bombardements de la coalition, des raids des talibans et d’autres factions. Vu d’ici, la géopolitique nous échappe, mais sur le terrain, elle s’applique de manière concrète et brutale.
Fayaz a rapidement appris le français. Il l’écrivait assez mal, mais les progrès en vocabulaire étaient fulgurants, mais il ne décrochait toujours pas un mot. De centre d’intérêt numéro un pour ses camarades de classe, il avait rapidement été délaissé. Seule une, Sophie, avait continué un temps à lui proposer son goûter à la récréation et s’asseyait parfois en silence à ses côtés durant le quart d’heure dévolu au jeu. Elle aussi a fini par se lasser, peut-être plus par la pression exercée par ses camarades que d’une manière volontaire. Au bout de plusieurs semaines, l’école à fini par demander de l’aide au centre d’accueil, et c’est là que j’ai fait sa rencontre.
Je m’en souviendrai toute ma vie. C’était dans le bureau de la directrice. Habillé de vêtements un peu trop grands pour lui, il semblait absent. Pourtant son air concentré m’a frappé d’entrée. Il était évident qu’il écoutait tout ce qu’il se disait, mais aussi qu’il comprenait une bonne partie des mots utilisés. On me parlait d’un enfant intelligent mais mutique, isolé, en retrait des autres et fuyant le contact humain, pleurant parfois sans raison apparente. Alors que l’on me montrait les nombreux dessins qu’il faisait pendant la classe, sa tête s’est redressée et il fixait les feuilles colorées dans mes mains. Colorées, c’est le mot, mais elles n’avaient rien de joyeuses. J’avais devant moi des scènes représentant systématiquement des personnages coupés en deux ou en plusieurs morceaux. Des pieds, des mains, des jambes et des têtes, le tout barbouillé de rouge. Dans ses représentations chaotiques, le ciel était toujours noir. Je voyais Fayaz une bonne heure chaque vendredi, à l’heure où les autres étaient déjà dans leurs familles, prêts pour le week-end. Il continuait inlassablement à dessiner les mêmes scènes avec application. Quand je lui parlais, il me regardait, puis replongeait dans son dessin. Je n’avais jusqu’ici jamais eu droit à un quelconque signe extérieur de communication, comme un hochement de tête, ou un mouvement de ses traits.
Un jour, j’ai tenté un autre angle d’attaque. Je lui ai parlé de mon grand-père, qui a vécu la Seconde Guerre Mondiale dans la terreur. La faim, les morts, les bombes, les camarades affublés d’une étoile et qu’il n’a plus jamais vus un matin alors qu’il jouait encore aux billes avec eux la veille. Je tentai de faire comprendre à ce petit bonhomme aux grands yeux tristes que ce qui lui arrivait pouvait aussi arriver ailleurs. Qu’il n’était pas le seul condamné à porter ce lourd fardeau qu’est l’injustice de la vie. Quand j’ai eu fini ce grand exposé, un long silence s’est installé. Toujours appliqué à retranscrire par le dessin les terreurs sombres rodant dans son esprit, Fayaz, m’écoutait attentivement. Il a alors rebouché lentement son feutre noir, l’a posé délicatement en travers de la feuille et m’a regardé droit dans les yeux. Depuis le début de nos séances je lui demande ce qu’il dessine et Fayaz a alors prononcé, du haut de ses six ans, ces mots gravés à jamais en moi : « C’est mon histoire ».
Image à la Une © Augusto De Luca, Polaroid (conservé à la Collection Internationale Polaroid aux États-Unis et au Musée de la Photographie de Charleroi en Belgique).