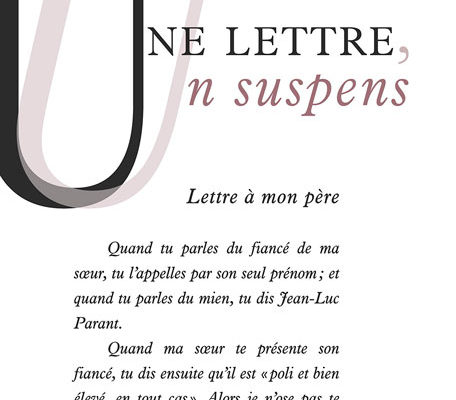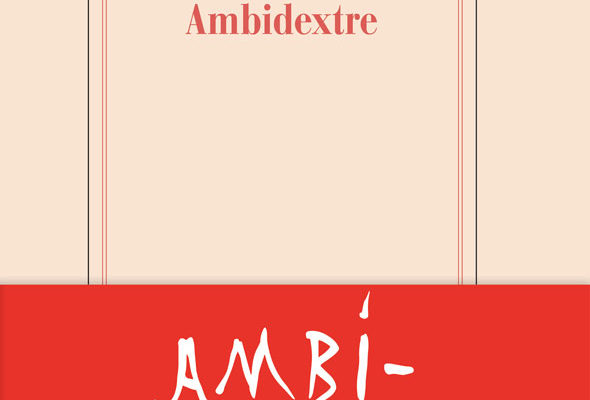De Gide à Barrès, des Chinooks aux Papous, le don ne saurait être désintéressé et oblige celui qui le reçoit. La transmission des idées, des valeurs, l’héritage où s’ensemence notre identité, comporte également une forme de violence.
Toute société ne tient que parce que des rituels en assurent la cohésion, et assurent la continuité de cette cohésion. Les échanges économiques appartiennent à ces rituels, et parmi eux le don ne fait pas exception : son caractère désintéressé n’est qu’une façade. Tout don entraîne un contre-don, et des forces dans le champ social s’assurent que ce contrat de réciprocité soit bien rempli. De là, tout ce qu’on nous lègue nous entrave, nous oblige, nous emprisonne.
De l’intérêt du don.
Dans son Essai sur le don de 1925, l’anthropologue Marcel Mauss envisageait l’échange économique comme un lieu social, un lieu d’existence des individus, et non simplement d’échange d’objets ou de monnaies. En étudiant des sociétés « archaïques », parmi lesquelles les amérindiens Chinooks et les Papous en Océanie, Mauss met en lumière que le don et les échanges économiques partagent cette même logique. À savoir que, si la dimension économique (chiffrable en monnaie) de l’échange n’est pas toujours évidente, tout don impose un contre-don, fût-il symbolique. Les médiévaux avaient même un mot pour cela : le guerredon. Si le mot n’a aucun rapport linguistique avec la guerre, il participe en revanche à son évitement. Si l’on te fait un cadeau, tu devras nécessairement faire un cadeau en retour. Et de cet aller-retour sans fin naît un lien social : les agents sont forcés à l’interaction, et cette interaction est positive. Plutôt que de se faire la guerre, on s’offre des cadeaux. Le don n’est donc jamais désintéressé : il engage l’autre à répondre avec un présent de valeur équivalente, et, se faisant, relie les solitudes.
Mais, en créant un corps social entre les individus ou les sociétés, le don les oblige. Le règlement implicite entre celui qui donne et celui qui reçoit ne saurait souffrir d’être malmené, et une telle infraction ouvrirait au conflit. Combien d’amitiés, combien d’amours sont mortes d’un déséquilibre entre le donné et le reçu ? Dans toute situation d’interaction sociale, on s’assure que celle-ci est équitable, ou du moins conforme à un régime d’iniquité socialement admis. Ainsi, si le travail d’une femme lui rapporte moins que le travail de son équivalent masculin, ce n’est pas une infraction à l’économie des dons, puisqu’il est socialement admis que le travail d’une femme, sans avoir moins de valeur utilitaire que celui d’un homme, impose néanmoins un contre-don inférieur. À lire entre les lignes, le don – contre-don comme moyen d’éviter les conflits n’est pas un régime égalitaire. Juste un régime de perpétuation du monde tel qu’il est. Il est admis qu’une personne dont la situation sociale est supérieure à la vôtre règle votre café dans certaines circonstances – le contre-don est alors la reconnaissance de cette supériorité de votre part. C’est le sens non-économique en apparence mais finalement économique en profondeur de certains des rituels étudiés par Mauss. Il s’agit de donner de façon matériellement désintéressée mais socialement intéressée : en donnant plus que l’autre, on affirme son statut social.
De l’autorité du don.
Si le don oblige, cela sous-entend qu’il existe une autorité à même de vérifier la présence et la conformité du contre-don. Cette autorité peut prendre de multiples formes : si elle loge dans les tribunaux et dans les pouvoirs de police pour les échanges économiques au sens habituel du terme, elle loge aussi en chacun d’entre nous. Dans le regard que nous portons sur nous-mêmes, que nous portons sur les autres et, chose terrible, que les autres portent sur nous.
Ce qu’il y a de terrible dans le don, c’est que le don est un contrat qui nous est imposé. Refuser un cadeau n’est que difficilement acceptable dans bien des situations sociales. Quand un proche vous offre un objet, que celui-ci vous plaise ou non, vous souriez poliment et remerciez – mais en réalité, une part de votre Sur-Moi calcule déjà à quoi cela vous engage. Si les présents lient d’amitié, ce n’est pas tant par ce qu’ils apportent de plaisir que par ce qu’ils obligent à la réciprocité. C’est somme toute assez équivalent à ces démarcheurs téléphoniques qui cherchent à vous imposer une vente dont vous ne voulez pas. Tout don est une violence.
Ces dons qui nous entravent.
Il est des dons plus insidieux que d’autres. Si certains ne demandent que l’achat d’un objet de valeur symbolique et/ou économique égale, d’autres travaillent notre comportement quotidien. Parce que la logique contractuelle des dons ne s’arrête pas au régime des choses matérielles ou des gestes. On donne aussi bien d’autres choses : on donne des pensées, on donne des valeurs, on donne des religions – on donne des maladies.
L’héritage, en ce sens, ne saurait se limiter aux biens meubles et immeubles que l’on transmet à sa mort. La chair de l’héritage, là où il est le plus fort, le plus important, est dans la continuité des personnalités. Nos parents nous donnent non seulement des biens matériels, de la flore intestinale et des chaussettes, mais ils nous donnent aussi des représentations du monde, avec lesquelles il faut s’efforcer de vivre.
L’un des rôles de l’école républicaine, sans cesse réinvesti et ré-invoqué, est de donner à tous les enfants de la nation une base de représentations du monde qui leur soit commune. Il s’agit de contrer l’héritage idéologique familial lorsqu’il est minoritaire. Il fallait, il y a un siècle, former de petits républicains. Il faut, désormais, former de petits égalitaristes. Lorsque l’école aborde la question du genre, ce n’est que pour proposer aux enfants un rapport à l’identité alternatif, leur proposer de ne pas se limiter à l’horizon que dessinent leurs parents. Pas étonnant, dès lors, que des parents politiquement à droite se soient offusqués d’outils comme les Abécédaires de l’égalité, supposés diffuser des valeurs contraires à celles qu’ils souhaitaient transmettre à leurs enfants. Dont cette fictive théorie du genre – objet qui n’a jamais existé que dans l’esprit de ses détracteurs, mais qui cristallise et démontre à merveille le genre de réactions outrées qu’on peut obtenir lorsque l’école tente de court-circuiter l’héritage idéologique de la famille, prise en tant que « cellule sociale ». Ma réaction ne serait pas différente si, demain, l’école proposait à mes enfants la lecture d’Abécédaires de l’inégalité, ou du moins, à défaut d’inégalité assumée, des manuels de l’assignation des rôles sociaux en fonction du sexe déclaré à la naissance.

Karl Marx © Eisbaarchen.
Barrès vs. Gide : l’héritage, une question politique.
« La famille…, cette cellule sociale » : l’expression est de Paul Bourget, écrivain antinaturaliste, antidreyfusard, monarchiste, catholique et lié à l’Action Française – il a naturellement rencontré un certain succès au début du XXe siècle. L’expression est reprise dans le journal d’Édouard, personnage romancier des faux-monnayeurs d’André Gide, qui la détourne et en livre l’analyse suivante : la cellule organique, biologique, devient une geôle qui formate l’enfant malgré lui, malgré son naturel. « L’avenir appartient aux bâtards. – Quelle signification dans ce mot : « Un enfant naturel ! » Seul le bâtard a droit au naturel. »
S’il faut se méfier du naturel qu’invoque Édouard, il faut en revanche convenir que toute transmission familiale se fait avec une certaine violence, et qu’elle contraint l’identité de l’enfant en formation. Parce qu’au fond, si comme le scande Léo Ferré dans sa préface à Poète… vos papiers !, « ce qu’il y a d’encombrant dans la Morale, c’est que c’est toujours la Morale des autres », rien n’est plus violent qu’une morale qu’on nous donne comme étant nôtre. Qu’un morceau d’altérité qu’on nous oblige à faire nôtre. Face à cette violence, à cette éducation qui encombre, on en viendrait presque à se souhaiter « orphelin, fils unique, célibataire et sans enfants », comme le héros idéal qu’imagine Gide dans le Journal des faux-monnayeurs (pas celui d’Édouard, son personnage romancier, mais le sien propre cette fois). On se voudrait « déraciné ».
Maurice Barrès, autre grande figure de la droite nationaliste de la première moitié du XXe siècle, en a même fait un roman : Les Déracinés. Il entend, à l’inverse de Gide, y démontrer l’importance capitale de l’attachement de chaque être à sa terre et à ses ancêtres, auxquels une forme de vénération est due. Son roman présente la façon dont sept jeunes lorrains, en voulant élargir leur horizon et ne pas se limiter à leur terre originelle, vont se perdre dans le vice et l’isolement à Paris. Tu quittes ta terre et ta cellule familiale, et c’est la déchéance. Tu ne respectes pas ce qu’on t’a donné, et c’est la turpitude. Briser la logique du don – contre-don a une conséquence terrible : la ruine morale.
La question est, au fond, une question politique. À droite, on sanctifie la transmission morale et matérielle, et ce qu’elle a d’aristocratique : l’héritage permet aux fils des dominants de naître dominants. À gauche, on aime les droits de succession, qui permettent une redistribution partielle de cette fortune indue – dans une visée méritocratique, l’argent de nos parents n’est pas un argent justifié. L’idée d’abolir le principe même de l’héritage a d’ailleurs été émise durant la révolution française. Marx, parmi d’autres, reprit cette idée dans son Manifeste du parti communiste de 1848. Étant politique, la question est aussi morale. Pour Gide, il faut pouvoir refuser une partie de l’héritage qui nous est transmis ; pour Barrès, il faut épouser les valeurs traditionnelles dans lesquelles on grandit.
On aurait tort, à ce titre, de ranger Gide au côté des abolitionnistes révolutionnaires. Sa vision est bien plus complexe. À la fin de ses faux-monnayeurs, le suicide d’un des orphelins du roman vient nuancer l’analyse de son rapport à la transmission familiale : devenir orphelin est certes une libération, mais celle-ci est dangereuse. Privé de référentiel stable, le petit Boris était face à trop d’alternatives. Il a finalement épousé une voie instable, et de cette instabilité est née sa perte. De même, le roman se conclut sur le retour de Bernard chez ses parents – il s’était volontairement fait orphelin en quittant le foyer où il avait grandi. La critique radicale de Gide, mue par un rejet des valeurs bourgeoises et de leur transmission familiale, s’enrichit d’une complexité supplémentaire en reconnaissant, comme par réalisme, que l’absence de cadre idéologique familial peut être néfaste.
De même que les révolutionnaires n’ont pas été jusqu’à abolir tout héritage et se sont contentés d’établir l’égalité des héritiers face à la distribution des biens, Gide ne plaide pas pour une abolition totale des valeurs familiales. Il semble plutôt insister sur la façon dont il faut sublimer cette « cellule », pour en faire un lieu d’amour non contradictoire avec l’émancipation. Apprenant que son vieux père « n’allait pas bien, Bernard n’a plus écouté que son cœur ». Mais s’il a acquis la capacité d’aimer cette famille, c’est grâce à sa période de solitude. Il lui a fallu sortir de sa cellule-geôle pour pouvoir y retourner et en faire une cellule fonctionnelle, un lieu de vie et d’interactions positives.
Lieu de violence, la transmission familiale peut devenir lieu d’affection dès lors que l’héritier a acquis assez d’indépendance. L’émancipation permet de réinvestir le don – contre-don, de le faire renouer avec sa fonction première : être un lieu d’échange social. L’émancipation transforme la violence en douceur.
Image à la Une © Selengkapnya, Les bras de la liberté par Hector Charpentier, sculpture en bronze (2002), le Prêcheur (Martinique).