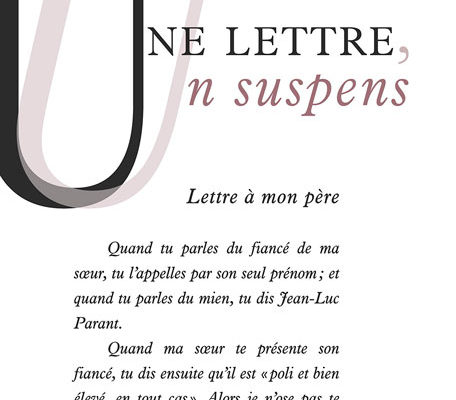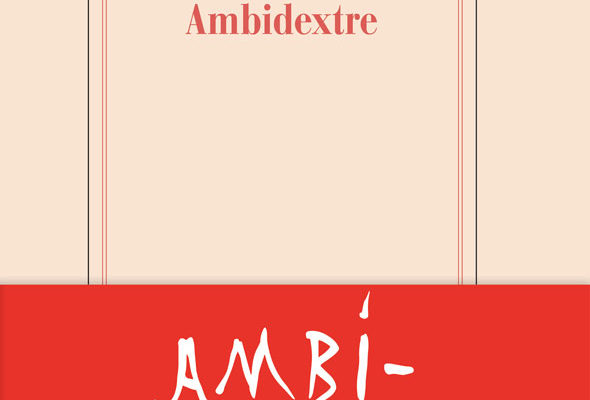J’ai fait de mon mieux. Faire de son mieux, c’est se débattre dans des limites conceptuelles arbitrairement fixées sur le terrain fangeux de sa psyché par le vieillard en soi, mais je vous assure que j’ai fait de mon mieux.
Il n’a pas été question de me comporter comme si rien n’avait eu lieu. Au contraire, j’ai embrassé chaque composante de ce pan de vie, lui ai attribué un nom, quelques adjectifs pour rendre hommage à ses nuances de gris et de bleu et, bien entendu, une fonction. « Écouter cette tristesse pour qu’elle parte gentiment en laissant quelque chose », j’ai entendu, une fois. Je suppose que ce quelque chose était censé avoir une certaine valeur. Restait à l’identifier. Alors j’ai écouté tout ce qui se présentait à moi. La fange, oui, mais aussi les bourrasques, les avalanches, les inévitables traversées d’abîmes, les coquetteries désespérantes des astres qui se cachent encore au commencement de l’été ; le vacarme continu des marteaux-piqueurs qui remodèlent la ville chaque jour ; le rire gras des meutes de touristes sur des places qui sont sublimes, vides ; et même quand on a tenté de me distraire, pour mon bien, parce que c’étaient des compagnons de route qui parlaient, j’ai osé pleurer. Parfois intérieurement, certes, mais ce n’était pas moins courageux. Ils me racontaient que le corps avait lui aussi ses raisons ; que toute émotion était l’une de ses confidences, et qu’une confidence du moins s’écoute. Alors oui, j’ai écouté.
Sur le trajet jusqu’ici, j’ai même identifié qu’en réalité on ne subit rien. Ça ne vous plaira pas, mais le coup porté n’est violent que par le souvenir tenace d’avoir été frappé, voilà la vérité. J’ai entendu aussi : « Mais qu’est-ce que tu racontes ? Perdre un enfant, un proche, voir ta famille mourir, par exemple… C’est pas subir, ça ? Comment peux-tu dire une chose pareille ?! ». Je disais une chose pareille parce que je connaissais, moi, le pouvoir de la conscience qui se rend si disponible à se cloîtrer dans un trou. Ne pas subir la chose ne signifiait pas y résister, mais la laisser être, l’accompagner comme on accompagne un camarade – trouvez-moi une tâche plus ardue que celle-là et je ferme ma gueule sur-le-champ. Je pensais y être parvenu.
Lorsqu’elle quitta la maison, je ne cherchai pas à la rattraper. Ni elle, ni les inverses ravissants de la solitude qu’elle m’avait offerts. J’avais compris. Nous étions arrivés à une fin. Les jours suivants, il est vrai, j’en oubliai que la fin est une invention occidentale, tant elle était dure à traverser.
Mais assez rapidement, je me consolai au contact de la Beauté, puis de la beauté de la Beauté, due à sa fascinante insolence d’être malgré tout. Le vertige en devint vertueux, prometteur, productif. Je me remis en selle, enfin ; multipliai les nouvelles conquêtes, les destinations inédites ; prévins la levée des vents ; emménageai dans un nouvel appartement que je meublai à mon goût ; orchestrai des repas familiaux ; et me forgeai une armure à la mesure de mes ambitions : guérir et réussir. J’étais fier, résistant, avide, drôle, doux, ma séduction scintillait, mon magnétisme se prolongeait en nuées chauffantes ; je fus promu, au travail comme au bar. Cela donna quelques bonnes années de galopades, durant lesquelles j’avais suivi le cours du long fleuve, éradiquant toute contradiction, évitant bravement de me cloîtrer dans le trou comme je vous l’ai dit, découvrant des reflets insoupçonnables de ma vie qui, jusque-là, il faut bien le reconnaître, avait été affreusement limitée. Et me voilà pourtant à la même station. Celle de « la fin qui n’en finit pas d’en finir ». L’Orient en moi ne comprend pas. Le fleuve n’aurait-il été qu’une mare ? Les joyeusetés dans l’enceinte de ma chambre, une illusion ? Mes succès, les grâces cessibles, les désordres fort souhaitables lorsqu’il faut rompre avec l’inertie… En ai-je trop fait ou pas assez ? Je ne crois pas avoir menti, à qui que ce fût, lorsque je disais que j’escortais volontiers tout ce qui m’escortait. Maintenant, mon armure est posée sur la table, et je demande : est-elle trop petite ? Trop grande ? Obsolète ? Et personne n’est foutu de répondre, les joyeusetés s’en sont allées, attirées par des charismes plus stables. Les deux cornes d’abondance qui ornaient mon heaume se sont rabattues. Mon lieu de vie n’attend plus rien de moi, ses murs dressés me contemplent gentiment. Oui, voilà, tout est profondément gentil. Nous y sommes, c’était peut-être à cela que je devais en venir, cela que la tristesse tentait désespérément de me laisser.
Moi-même. Le formidable moi-même ! Moi-même qui vais, dans ce cas, dessiner les plans d’un néovillage, prendre des cours de langue morte, exhorter la rébellion politique des mous, tous quartiers confondus de la capitale, et sans doute déménager dans un autre pays, pour refuser une dernière fois le dépouillement. Maintenant, veuillez tourner cette putain de page, s’il vous plaît. J’ai habituellement de l’humour, je crée des jeux de mots plus idiots les uns que les autres et cela fonctionne plutôt bien, je manie finement l’ironie, mais nous verrons cela plus tard.
Photographie à la Une © Julien Chevallier.